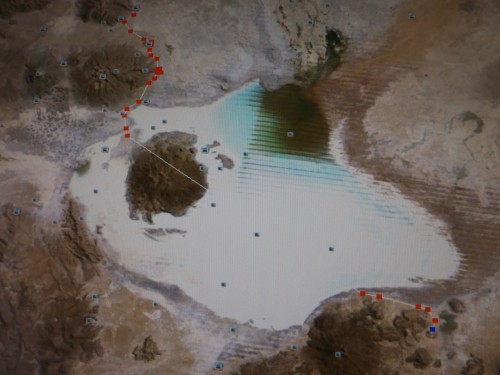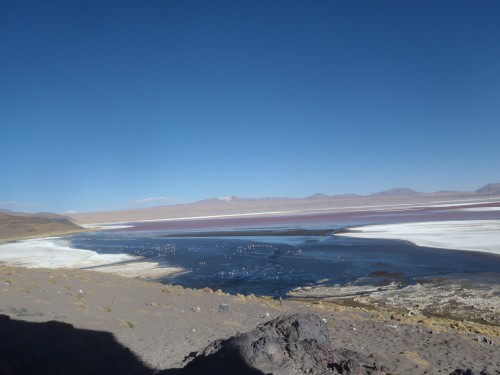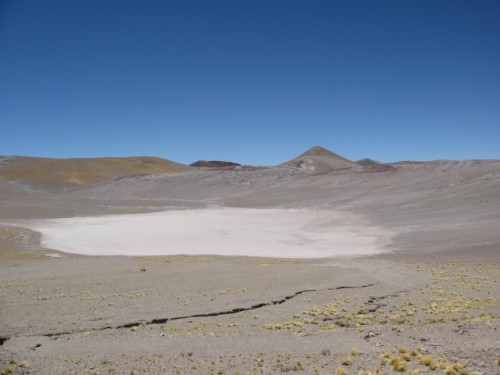08/01/2015
Traversée de l'Atacama à vélo
Un voyage de deux mois à vélo à travers le désert de l'Atacama de Arica au nord du Chili jusqu'à Santiago sa capitale, en passant par la Bolivie et l'Argentine sur une distance d'à peu près 3600 kilomètres, à travers l'une des plus arides régions du monde, est un projet enthousiasmant que nous nous apprêtons à entreprendre à partir du 16 octobre, sur une période de deux mois Flora et moi.
Pour celles et ceux qui ne prendraient pas le temps de suivre ce voyage dans les détails, je rajoute une synthèse de 5 minutes de ces 40 jours sur la planète Mars:
https://www.youtube.com/watch?v=CvVUzUv-gDw
Elle est suissesse, elle a la grosse pêche physique et comme moi est fascinée par ce coin de la planète. Elle a renoncé à son projet initial, le parcourir en véhicule 4X4, choisissant de l'affronter à la loyale à la force des mollets et au moral, les deux étant intimement liés. Partir de cette façon sans se connaître, ayant simplement communiqué par le net et avoir déjeuné ensemble un jour dans la magnifique ville d'Annecy peut apparaître un peu comme un jeu de roulette russe. Mais il ne faut pas longtemps pour se jauger et juger de la motivation de l'autre. Le challenge lorsque la barre est assez haute se charge de vite souder l'équipe, chacun tendu vers le but à atteindre, sachant que l'entraide devient un besoin vital. Si la fin du chemin en elle-même ne représente rien de particulier, les efforts deux mois durant en vue d'y parvenir devraient créer l'esprit du chemin de l'aventure à laquelle nous aspirons.
Le vélo dans ces coins reculés rend à la planète sa dimension. Se soumettre de cette façon aux caprices du temps, du vent, du froid, du sable et peut-être de la neige sans savoir où l'on va pouvoir s'arrêter et poser sa tente si possible à l'abri de bourrasques furieuses et subir les aléas du ravitaillement tout particulièrement sur les mille premiers kilomètres, cela crée les conditions qui nous attirent irrésistiblement, mais qui nous inquiètent aussi un peu. Ne pas se perdre, assurer dans tous les cas le minimum en particulier l'eau, bien prendre garde aux longues nuits durant lesquelles la température descend en-dessous de moins dix et bien d'autres choses.
Dans quinze jours l'aventure démarre. J'ai un peu de mal à l'imaginer, bien au chaud dans mon salon.
Dans un premier temps la préparation de l'itinéraire permet de rêver sur des cartes absolument extraordinaires dévoilées par Google earth. Cette région d'Amérique du Sud vue du ciel ressemble à la lune voire à la planète Mars, que l'on appelle aussi la planète Rouge.
Je me donne encore une semaine de vacances dans les Vosges entre cueillette des cèpes et pêche à la truite dans le dernier lac encore ouvert à cette activité après le 15 septembre, le lac des Corbeaux. En fin de semaine prochaine, retour à Lyon et préparation du matériel, du vélo et de quoi réparer la casse; les habits, le couchage, la tente, le réchaud et les gamelles, les appareils photo, l'intégration des données dans le GPS et plein d'autre choses. Les bagages devront être le moins lourds possibles, mais ce sera autour des 25 kilogrammes.

Sur cette première photo notre itinéraire est matérialisé en rouge, et se développe sur 3500 km. On constate que nous allons rester pratiquement tout le long dans des zones désertiques. Juste au nord de la trace rouge on distingue une tache bleue allongée, il s'agit du lac Titicaca, à la frontière du Pérou et de la Bolivie.
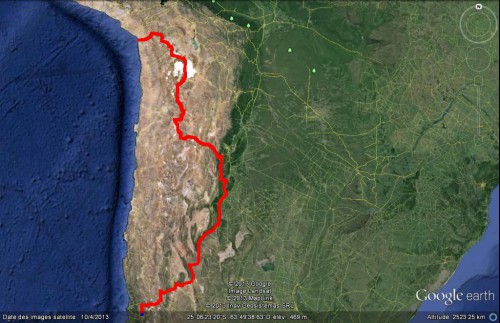
L'itinéraire complet plus en détail

Le trajet de Arica à San Pedro de Atacama qui se développe sur plus de mille kilomètres dont 800 de piste et de sel. Il est détaillé sur les trois vues suivantes.
Cette première partie devrait nous prendre trois semaines. Elle représente la plus difficile, par le fait que nous serons en permanence en altitude(à part le début de la montée partant de la mer et nous conduisant à 4500m) au-dessus de 3600 mètres, et souvent au-dessus de 4000, et parfois frisant ou dépassant de peu les 5000 en particulier dans le sud Lipez. La difficulté sera aussi directement liée à la quasi-absence de route goudronnée et parfois à la disparition de la piste dans le sable et les pierres. Le ravitaillement devra être étudié avec minutie car les quelques villages traversés ne seront pas en mesure de nous proposer un réel choix d'aliments. Nous allons compter sur un stock de pâtes et de riz. Cependant nous espérons rencontrer de loin en loin dans ce nul part des petits restaurants improbables où nous pourrons manger à l'abri du vent, et éventuellement trouver un toit afin d'éviter de dormir dehors.

La première partie du trajet d'Arica au salar de Coipasa sur une distance d'à peu près 500 km dont plus de la moitié hors route goudronnée.

La seconde partie du voyage, sans doute la plus étonnante sans être la plus difficile. Entièrement en dehors des routes, uniquement sur pistes ou directement sur le sel des deux salars de Coipasa et Uyuni, sur une distance de 300 km. L'altitude des salars est de 3600 mètres.

La troisième partie de notre périple, le sud Lipez, passage de 400 km; à part l'arrivée à San Pedro de Atacama par route goudronnée, nous serons sur des pistes sableuses où parfois il faudra pousser les vélos, l'altitude rapidement après avoir quitté le salar d'Uyuni se situe entre 4000 et 5000 mètres, avec un court passage au-dessus de cette dernière altitude.

La quatrième partie de notre voyage de San Pedro de Atacama à Salta nous fera passer par le paso Sico la frontière du Chili et de l'Argentine. Nous retrouverons des pistes et peut-être des routes goudronnées!
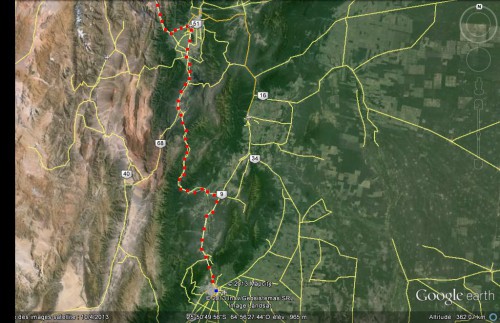
La cinquième partie de Salta à San Miguel de Tucuma 300km
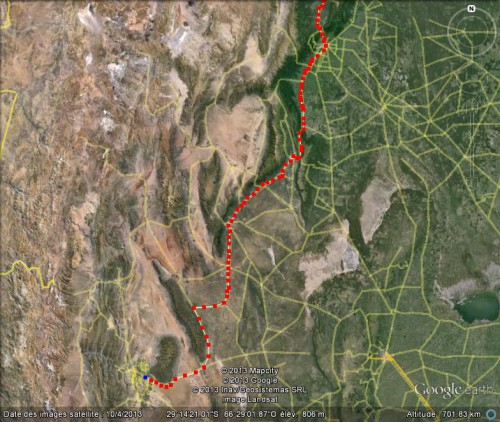
La sixième partie de San Miguel de Tucuma à San Juan 700 km

Dernière partie de la Rioja à Santiago du Chili
Je reviens plus précisément sur la partie de notre voyage qui a trait aux salars de Coipasa et d'Uyuni, ainsi que sur la région du sud Lipez.

Les traits jaunes matérialisent les frontières entre le Chili à gauche, la Bolivie en haut et l'Argentine à droite et en bas.

Au centre de la vue ci-dessus les deux taches blanches sont les salars de Coipasa et d'Uyuni, celui du haut le plus petit a une superficie de 2500 km2 et une largeur de soixante kilomètres et le second Uyuni s'étend sur 12000 km2 et dans sa grande largeur dépasse les 150km.
Ci-dessus le salar de Coipasa d'une superficie de 2500 km2 et de soixante kilomètres de large.
La zone entre les deux salas de Coipasa et de Uyuni, le chemin matérialisé est d'environ 70 kilomètres.

La Laguna Colorada
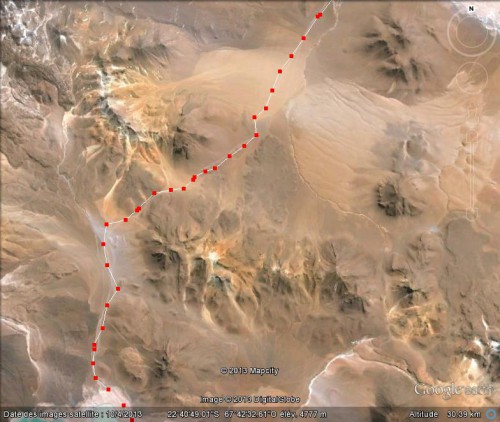
Désert de Dali

La Laguna Verde et le volcan Licancabur qui frôle les 6000m, ce sera la fin du sud Lipez. la route en bas de l'image est goudronnée et en 2000 mètres de dénivelé elle conduit à San Pedro de Atacama
Ci-dessus différentes vues de la région la plus envoûtante que nous allons traverser, le sud Lipez. 400 km de piste et de sable entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Le rêve de tout cyclo-rando. Ceux qui en reviennent en parlent comme d'une expérience unique dans le vent le froid l'altitude, les pistes instables, mais l'incroyable beauté de l'une des régions les plus sauvages de notre planète.Terre perdue semée de lacs salés aux couleurs changeantes, du vert au rouge en passant par le bleu et le jaune, parmi lesquels jaillissent des volcans pour certains actifs et qui montent jusqu'à 6000 mètres. Dans cet enfer subsistent les flamants roses et les Vigognes, ainsi qu'un drôle de gros lapin à la queue en tire-bouchon, la viscache. Au cours de mes périples à vélo, lorsque j'ai rencontré des cyclistes lancés dans un tour du monde, le coin qui les a le plus fortement marqués c'est justement ce bout de Bolivie perché à la frontière chilienne. Tous, sans exception, cette traversée ils en parlent comme d'une révélation, et l'on comprend que c'est la plus forte expérience à vélo qui les a marqués de façon indélébile.
J-2 lundi 14 octobre
Les sacs sont pratiquement bouclés. J'ai mis mon vélo en carton. C'est toujours une opération qui demande du temps, car dans les transports aériens les bagages sont malmenés, et les vélos sont des engins fragiles. Notre parcours aérien va nous mener de Lyon à Madrid puis à Santiago du Chili et enfin à Arica près de la frontière péruvienne. Cela fait trois transferts, ce qui augmente d'autant les risques de casse. En confectionnant mon paquet j'ai à l'esprit toutes les manipulations que cela va nécessiter. Il ne faut pas trop y penser!
Ensuite j'ai préparé mon sac avec le matériel pour cette aventure, de quoi camper par grand froid, les habits, le matériel de réparation du vélo et le reste. Cela fait un peu moins de vingt kilos. En route, il faudra selon les tronçons ajouter jusqu'à 10 kilogrammes entre l'eau et la nourriture. Donc une addition rapide me permet d'évaluer le poids de ma monture avec moi dessus à 110 kilogrammes.
L'élément le plus lourd, la tente représente 3,1 kilos. Mais cet abri sera essentiel dans la réalisation de notre aventure. En effet, il faut s'attendre à des températures basses en-dessous de -10 et des vents violents. Donc ,une tente adaptée aux conditions très difficiles (en particulier résistance au vent) est essentielle afin d'assurer des conditions de sécurité minimales.
Le vélo comme moyen de voyager laisse libre cours à tous les espoirs d'aventure, en nous permettant une vraie confrontation avec la nature. Cela me rappelle mes lectures, en particulier les fabuleux écrits d'Ella Maillart, "croisières et caravanes" et "oasis interdites", pour n'en citer que deux. Dans les années trente elle arpentait les grands déserts d'Asie à pied et à dos de chameau. Elle narre cela de façon remarquable. En hiver, durant de longues semaines elle dormait en se protégeant du froid et des intempéries en se collant au corps de son chameau. Ces récits m'ont fortement marqué et cette envie de traverser de grands déserts, comme nous allons le faire, je la dois en partie à cette Suissesse, qui représente l'une des plus grandes exploratrices de tous les temps. Les déserts attirent par les conditions extrêmes qui y règnent. Ce qui m'interpelle et me fascine aussi, ce sont les noms qu'ils portent. Les plus grands sont largement pourvus en a, Sahara, d'Ad Dahna, Atacama, Taklamakan, respectivement situés en Afrique, dans la péninsule arabique, en Asie et Amérique du sud. Je me souviens d'une époque où je partais pour une mission de plusieurs mois en Arabie. Je m' y étais rendu à bord d'un avion militaire Hercule. Il ne volait pas très haut et nous avons traversé toute la péninsule arabique de la mer Rouge jusqu'au golfe Persique. J'étais resté fasciné, le front collé au hublot assis sur un missile, des heures à regarder défiler ces terres mystérieuses comme n'appartenant pas à notre planète. Cette expérience m'a aussi fortement marqué et sans doute l'envie de me plonger dans ces régions "hors de notre Terre" n'y est pas étrangère.
J
Ce matin je suis allé chercher Flora à la gare de la Part Dieu. Puis nous avons mis son vélo en carton. Le voisin nous a donné un bon coup de main pour desserrer ses pédales, en s'aidant d'un bras de levier d'un bon mètre. A 14h les vélos étaient sur le toit de la voiture et mon frère nous emmenait à l'aéroport. Sans problème nous avons pu les faire embarquer.
J+1
Nous sommes en transit à Santiago après un long voyage de 13 heures et nous avons 12 heures d'attente avant de faire la dernière partie de notre trajet en avion pour notre mise en place à Arica; Les bagages et les vélos à la consignes, quand même 40 euros pour deux, nous sommes partis faire un tour au centre ville où nous sommes en train de déjeuner dans un petit restaurant. On a profité de l'occasion pour faire du change en monnaies chilienne et argentine, mais pas de possibilité d'avoir des bolivaros. On espère à Arica, car à la frontière à Parinacota, il ne faut pas y compter. Nous avons aussi prospecter pour voir les possibilités de trouver de quoi emballer les vélos lors de notre retour, certain pour moi par Santiago et possible pour Flora. Les vélos procurent un moyen de voyager fabuleux mais procurent aussi beaucoup de soucis pour les faire accepter dans les avions.
Ce matin, la vision de l'avion alors que nous traversions le Andes pour passer d'Argentine au Chili était fabuleuse. Nous avons pu admirer l'Aconcagua dans toute son immensité. Bien entendu la première pensée qui vient à l'esprit c'est l'exploit moult fois répété par les pilotes de l’aéropostale, Guillaumet, Mermoz, Saint Ex et les autres, qui vers les années 1930 franchissaient cette immense barrière que je contemple bien au chaud dans notre boing 787. Eux, il leur arrivait de sortir à pied de la chaîne montagneuse, suite à un crash, après avoir bataillé des jours dans la neige, animés d'un farouche instinct de survie. il faut lire le "Mermoz" de Kessel.
Notre dernière partie du voyage s'est bien commencée sans problème pour l'embarquement de nos vélos.
J+2
Tout début de ce vendredi 19 nous arrivons à 0h15 à Arica. Pas de chance nos sacs étaient dans les derniers à sortir de l'avion, mais nos vélos dans les premiers et les cartons étaient en bon état, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été maltraités au cours de ces trois changements entre Lyon et Arica.
Par contre pour trouver un taxi voulant prendre ces volumineux paquets, nous avons bien cru que nous n'y arriverions pas. Il s'en est fallu de peu que nous nous mettions à les remonter dans la nuit afin de parcourir les 18 km qui nous séparent de la ville. Pas terrible, surtout qu'il s'agit sur une partie de la terrible panaméricaine que j'avais expérimentée sur 600 km en Équateur, expérience dont on se souvient, mais c'était de jour, j'imagine difficilement ce que cela donne à deux heures du matin.
Mais un chauffeur de taxi a eu pitié de nous et a téléphoné à un de ses copains qui est venu avec une camionnette, et voilà comment à deux heures du matin nous nous sommes retrouvés dans un lit après 33 heures de voyage.
Lever 7h15. Petit déjeuner sympa, mais nous n'avons pas vraiment faim. En effet, nos organismes n'ont pas encore bien pris en compte les six heures de décalage.
Ensuite, opération de remontage des vélos. Tout se déroule pour le mieux. Apparemment ils n'ont absolument pas souffert. Il faut reconnaître que nos grands cartons qui nous ont permis de ne pas démonter les roues arrières sont très pratiques même si pour le transport ils nous causent plus de soucis.
Premier contact avec la ville. Elle est vraiment dans le désert, qui la cerne de toutes parts. Par endroits, on a vraiment l'impression qu'il veut déferler à travers les rues. Notre première préoccupation, faire les réserves suffisantes pour la première partie de notre voyage, 1000 km au cours desquels les possibilités de ravitaillement risquent d'être faibles, même si nous espérons trouver de loin en loin des lieux improbables, où il sera possible de manger une platée de riz ou des pâtes.
Les commerces sont nombreux, nous trouvons des cartouches de gaz. Nous achetons trois kilos de riz et quelques sacs de pâtes ainsi que tout un assortiment de denrées, salées et sucrées. Sur les trois semaines à venir nous devrions passer la moitié des nuits dehors, donc notre fond de nourriture devrait nous permettre de tenir. En effet nous ne pouvons pas nous permettre de trop prendre car le poids est un ennemi redoutable. Nous allons chacun avoir des charges aux environs des 25 kilos, et la première côte fait deux cents kilomètres et 4600 mètres de dénivelé.
Nous sommes allés nous promener au bord du Pacifique regarder les pêcheurs qui tiraient leurs filets à partir de barques en tout point semblables aux pointus de Méditerranée. Je n'étais pas le seul intéressé. En effet des phoques suivaient les bateaux en attente d'un poisson rejeté.
Arica vue des hauteurs surplombant la mer
J+3 66 km 1550 mètres de dénivelé
Nous petit-déjeunons, les vélos sont chargés. L'aventure va commencer. On nous a mis en garde contre la difficulté de la route à venir du fait de l'interminable montée. Le propriétaire de l'auberge qui nous reçoit connaît remarquablement sa région. Il nous parle avec passion de tous les géoglyphes, ces immenses dessins à même la caillasse dans le désert. Il nous fait part de ses réflexions et de son expérience sur le mal des montagnes, la pouna. Elle n'est pas due simplement à l'altitude mais aussi aux forces telluriques du coin. Par exemple il nous affirme qu'à Putre, petite ville pas loin de la frontière avec la Bolivie, où nous passerons, bien que l'altitude ne soit que de 3500 mètres, il y ressent la pouna, alors que plus au sud au salar de Souriré à 4200 mètres il n'en ressent pas les effets! Nous verrons.
Nous commençons par longer l'océan Pacifique sur 12 kilomètres puis nous pénétrons dans le fameux désert de l'Atacama. La route est enserrée entre d'immenses dunes aux teintes multiples. Les 38 premiers kilomètres sont presque plats, 400 mètres de dénivelé. Un restaurant avant le début des grandes pentes. Nous nous y arrêtons, mais il n'est que 11H30, donc rien n'est cuit. On se contente d'un sandwich.
Nous reprenons notre route et de suite une immense rampe fait tomber la moyenne à 5 voire 4km/h. En effet, nous sommes très lourds, car nous avons une quinzaine de jours de nourriture en prévision des déserts boliviens. Mais il nous faut d'abord franchir ce premier obstacle avec un passage à 4600 mètres. Une montée de presque 200 km. On essaie de ne pas trop penser.
Une dizaine de kilomètres plus loin un autre restaurant. Il est 13H30, donc tout est cuit, et nous nous régalons. La patronne nous affirme que le prochain point de ravitaillement se trouve à 30 kilomètres. Nous partons donc pas très chargés en eau, avec l'intention de bivouaquer vers la moitié du trajet et demain vers les 10 heures pouvoir nous ravitailler. Mais l'information s'avérera fausse, le prochain point est à 62 kilomètres et 1700 mètres plus haut à 3200 mètres d'altitude.
Nous partons donc confiants dans des pentes gigantesques au milieu des camions. Mais les chauffeurs sont très courtois avec nous et nous gratifient de grands bonjours. Les bords de la chaussée sont très raides. Va-t-on trouver un endroit où poser la tente?
Vers les 19h, une petite gorge en amont. Je vais jeter un coup d’œil. A une centaine de mètres de la route une petite plage de sable, idéale pour notre tente.
Rapidement elle est montée, le camping gaz est mis en œuvre et nous mangeons une bonne platée de riz et sombrons dans le sommeil.
J+4 lieu de bivouac à Zapehuria altitude 3200, 45 Km 1800 mètres de dénivelé
Après une nuit longue et réparatrice nous attaquons confiants en direction de cette station à 14 km. Elle n’est pas là, nous faisons huit kilomètres supplémentaires. Sur le bord de la chaussée un 4X4 arrêté. Le propriétaire nous dit que le prochain point d’eau est à plus de vingt kilomètres. Nous n’avons plus une goutte d’eau, il fait plus de trente degré et la pente est très raide. Avec nos vélos lourdement chargés en matériel et nourriture en prévision des pistes désertes à venir, nous nous traînons à six à l’heure. Je lui demande de l’eau. Il n’en a pas. A ce moment un camping-car freine. Sa plaque d’immatriculation est française, le 83 montre que le couple qui est à l’intérieur vient du Var. Je réitère ma demande. Le véhicule vient se garer et voilà comment nous remplissons toutes nos bouteilles, ce qui fait plus de sept litres.
Nous discutons un peu avec ces gens qui sont sur la route depuis treize mois. Puis chacun reprend sa route, eux vers le bas et nous dans cette pente infernale. Et la chaleur de plus en plus terrible qui se concentre comme dans un four le long de ces parois claires. Rapidement nous faisons une pause et le réchaud est mis en action pour des pâtes. Mais la chaleur est tellement pénible que nous replions vite tout et reprenons notre ascension. Il est hors de question de pouvoir s'assoupir, on a vraiment l'impression de cuire.
Vers les 17h nous rencontrons un camion en panne. Le chauffeur me demande si j'ai de quoi réparer. Je sors tout ce que j'ai pour réparer un vélo. Mais un camion ce n'est pas un vélo! Cependant notre camionneur ne perd pas sa bonne humeur et la conversation va bon train. Pour lui expliquer qu'un homme et une femme qui voyagent ensemble ne vivent pas ensemble est presque mission impossible. Il nous raconte sa vie entre deux "ports" La Paz et Arica!
On l'abandonne à son sort. La pente faiblit. Nous sommes sur un immense plateau. Mais rien à l'horizon. Puis soudain derrière une bosse du terrain le havre salvateur se révèle .
Nous y trouvons une chambre et mangeons très bien. Puis nous nous enfonçons dans un long sommeil de 10 heures.
J+5 Zapehuria à Putré 32 km altitude 3400, dénivelé 732 mètres
Après les efforts des deux premiers jours nous décidons de faire une étape courte. En effet, commencer à tirer comme nous venons de le faire avec des charges de trente kilos, alors que nous sommes partis pour un voyage de deux mois ce n'est pas très bon.
La route s'humanise. Aux côtes pas très longues et pas toujours raides succèdent des parties plates et des descentes. Les grands volcans sont de plus en plus présents. Ils sont enneigés de frais.
On nous a dit que vers les 4000 il avait neigé la semaine dernière. Paradoxe de ces pays, un jour on étouffe et le lendemain il neige. Nous surplombons Putré en passant un col à l'altitude de 3550 mètres. D'un joli point de panorama nous contemplons la ville et le trajet qui nous mènera à la frontière 1000 mètres plus haut. Nous y rencontrons un motard australien qui parle couramment le français du fait de sa mère.
Arrivés à Putré un peu après midi nous trouvons une auberge "Hostal Cali" très accueillante. En plus elle est pleine de chats qui se vautrent partout et qui n'arrêtent pas de faire miaou-miaou.
Je crains que le prochain point de contact internet ne soit à San Pedro de Atacama après 900 km de piste et vingt jours. Mais il n'est pas impossible que nous ayons une bonne surprise demain à Tombo Quémado ou dans une semaine à Sabaya avant d'attaquer le salar de Coipasa. Mais je fais le max pour donner des nouvelles, mais pas de panique s'il y a un silence de vingt jours. Merci Bertrand et bises à tous.
Nous somme arrivés à San Pedro de Atacama
Bonjour nous venons de terminer la première partie de notre périple. 1000 km dont 800 de pistes dans des conditions parfois difficiles. On a poussé les vélos dans le sable et la caillasse volcanique entre 50 et 60 km.
Deux bivouacs d'anthologie entre 4600 et 5000 mètres d'altitude. Un passage dans une fournaise collés dans une espèce de talc avec 45 degrés du côté de Sacabaya. Un camion improbable nous a sortis de ce sale pas.
Le sud Lipez c'était vraiment la planète Mars sur 400 km. L'épreuve a été facilitée par deux qualités de Flora, un moral d'acier et une puissance digne d'un tracteur. Demain j'essaie de vous raconter ces vingt jours de folie et surtout de vous mettre de belles et surprenantes photos entre lagunes multicolores et mers de sel ou momies de plus de 5000 ans conservées dans ces montagnes les plus sèches du monde.
Je reprends le fil de notre aventure là où je l'avais laissé il y a 15 jours:
L’étape après Putré nous a conduits à passer un col à plus de 4600 mètres dans un décor magnifique, deux volcans à plus de 6000 mètres couronnés de neige. Le cumul du dénivelé depuis notre départ du niveau de la mer à Arica s’élève à plus de 5700 mètres. Le passage de frontière s’effectue sans difficulté. Notre arrivée à la tombée de la nuit dans la ville frontière bolivienne de Tombo Quemado dans un froid et un vent terribles est pour le moins patibulaire. Ces villes frontières fourmillent de personnes prêtes à vous arracher une sacoche ou plus. Les cyclos lourdement chargés sont particulièrement vulnérables. Mais à deux on s’organise, et mon expérience du vol quasiment à l’arrache, que j’ai subi il y a quatre ans au Pérou a été très formatrice. On détecte de ce fait plus facilement les individus qui ont l’intention de s’emparer de nos affaires. Je vais cependant y laisser mon compteur de vitesse pour un oubli de quelques minutes sur la table du «restaurant» où nous avons mangé une platée de riz. Ce qui m’a forcé à mieux utiliser mon GPS afin de connaître les kilométrages effectués.
Après une nuit fort médiocre nous dégarpissons au plus vite de cet endroit sordide. L’équipement des vélos se fait sous haute surveillance d’un voleur qui guette la moindre inattention de notre part pour s’enfuir avec une partie de nos affaires. Flora pige vite le processus d’action de ce sordide individu et elle le maintient à distance pendant que je descends les bagages.
Les vingt premiers kilomètres sont rapidement avalés sur une piste roulante bien qu’il nous faille un peu pousser les vélos dans les pentes trop raides pour nos charges importantes. Dans le deuxième village, nous recherchons un point d’eau. Le lieu semble désert. Cependant nous détectons un mouvement dans une cour. Nous demandons de l’eau. Gentiment un homme nous remplit nos bouteilles vides. Il en profite pour nous indiquer un chemin plus court. Enfin les vélos chargés nous prenons le large. Le premier point de mon GPS nous donne la direction des pistes plein sud que nous allons suivre durant 800 km. Il est toujours assez inquiétant de se lancer comme cela à travers des régions réputées les plus arides du monde, avec comme seules indications des points GPS «piochés» sur Google earth. Quant à la nourriture et à l’eau on ne peut que se fier à nos estimations pleines d’incertitude.
L’information s’avérera complètement erronée du fait de la confusion entre le village de Sacabaya et la laguna de Sacabaya. Après quelques kilomètres nous allons être piégés dans des sables inconsistants au milieu d’une immense plaine bordée de grands volcans, dont l’un émet de ses flancs des panaches de fumée blanches. La température devient infernale. Notre moral en prend un sacré coup. Comment imaginer que nous allons traverser 800 kilomètres dans cet enfer absolument pas adapté au vélo?
Un camion, le seul que nous verrons de la journée nous dépasse et nous met en garde quant au piège dans lequel nous nous enfermons. Dans un premier temps nous refusons son aide. Quelques kilomètres plus loin nous réalisons que nous n’aurons pas l’énergie de nous sortir de ce terrain mouvant, de plus terrassés par une chaleur accablante. Dans le lointain nous distinguons le camion à l’arrêt. Nous allons dans sa direction. Il se met en marche et vient vers nous. Nous l’arrêtons et acceptons son aide. Il nous conduit vers ce fameux village de Sacabaya, au milieu de nulle part, à travers un terrain totalement inconsistant de poussière blanche.
Ce village du bout du monde est incroyable. Il y a un petit poste militaire qui contrôle les mouvements improbables. La frontière chilienne n’est pas loin, et les deux pays ne sont pas amis, depuis qu’au 19 ème siècle la Bolivie au cours d’une guerre a perdu son accès à la mer entre le Pérou et le Chili.
Nous débarquons avec nos vélos dans ce lieu étrange écrasé d’une chaleur suffocante. Qu’allons nous faire? Les militaires et le chauffeur nous regardent comme des bêtes curieuses et pas très sensées. Après un moment d’attente, on nous propose un logement dans un hôtel fermé sans eau ni électricité qui n’a sans doute jamais vu un client.
Nous attendons devant la porte fermée à clef un improbable propriétaire. Alors que nous commençons à désespérer un femme s’approche et nous propose de la suivre. Elle va nous offrir le gîte et le couvert pour une somme modique. Un problème de résolu. Mais comment allons nous sortir de cet enfer de poussière inconsistante? Alors le chauffeur vient nous avertir qu’à 5 heures, c’est à dire dans deux heures il part pour Négrillos, justement notre itinéraire y passe. Nous acceptons avec empressement son aide. Alors que nous préparons nos bagages, il nous dit de ne pas nous presser, car son départ est différé, puis il nous annoncera dans la soirée qu’il partira le lendemain matin très tôt. Après une nuit à ruminer nos incertitudes et à douter de nos capacités à affronter le défi de l’Atacama, nous nous préparons au départ en camion. Mais rien ne vient. Nous partons aux renseignements. Nous apprenons par personne interposée que le départ est prévu pour midi, puis pour 14 heures.
Alors que nous commençons à douter sérieusement de la fiabilité du chauffeur, il nous annonce qu’il partira à 15 heures et cette fois en direction de Sabaya à proximité du salar de Coipasa. Nous n’hésitons pas et acceptons l’offre, cela nous recalera sur un terrain moins mouvant où nous pourrons décider de la suite de notre projet. Mais le moral n’est pas haut et nous pensons bien abandonner pour prendre la direction du bord de l’océan Pacifique et cela même quasiment avant d’avoir engagé le combat. Après un transport de plusieurs heures dans un décor dantesque, nous voilà à Sabaya. Le moral remonte un peu, et nous décidons sans réelle conviction de nous remettre dans le course. Nous faisons quelques provisions chez l’hôtelier épicier en prévision de la traversée des salars de Coipasa et d’Uyuni et du sud Lipez, ce qui représente une distance de plus de 600 kilomètres par des pistes réputées infernales. Je me dis que si cela se passe mal nous aurons la possibilité de nous échapper soit vers la ville d’Uyuni ou cent kilomètres plus loin en direction de la frontière chilienne.
Nous voilà donc partis lourdement chargés en direction de Villa Vitalinia petit village sur la route donnant accès au salar de Coipasa. Tout se passe pour le mieux, la vingtaine de kilomètres est effectuée rapidement sur une piste acceptable. Une fois en ce lieu, nous complétons nos réserves d’eau. Je suis toujours étonné de constater que dans ces villages en plein désert, à proximité d’une mer de sel on trouve des robinets qui délivrent une eau fraîche de bonne qualité, mystère de la nature. Des ouvriers en plein travail nous saluent. Ils nous indiquent un chemin direct pour le salar. Nous voilà mettant le cap plein sud vers ce premier miroir blanc de 50 km qui s’ouvre devant nous. Commence alors ce genre d’expérience qui reste gravée en soi pour la vie.
Les roues crissent sur cette surface de sel. Je sais que cette entrée se fait par une zone humide, mais l’assurance des ouvriers quant à la dureté du sol nous a enlevé toute hésitation. Effectivement, le sol ne se dérobe pas sous nos pneus, même si parfois nous traversons des flaques. Les vélos se couvrent de sel, qui s’accroche en gros conglomérats un peu partout. Nous louvoyons entre des mares parfois importantes sur une vingtaine de kilomètres. Puis toute trace d’eau disparaît et nous voilà sur un sol dur, tout accaparés par le plaisir fou de traverser un lieu aussi insolite. Nous sommes seuls, aucun mouvement de véhicule. La vue porte loin. Mon GPS indique qu’il reste plus de trente kilomètres pour atteindre la rive sud qui semble cependant si proche. Lentement elle se rapproche. Il est important de sortir par une zone stabilisée afin d’éviter des efforts surhumains de poussage, les roues enfoncées dans des alternances de sable et de sel, qui bordent les abords des déserts de sel. Nous rejoignons un chemin, sableux en bordure sud . La chaleur est forte. Un village, nous y entrons, il est désert. Sur la place centrale, en réalité sur la zone sableuse qui en tient lieu un robinet. Nous en profitons pour faire un peu de lessive et nous nettoyer ainsi que les vélos, couverts d’une gangue de sel. La chaleur est terrible. Mais où est donc le chemin du village de Luca que mon GPS donne dans le sud est pour vingt kilomètres? Il nous faut absolument une indication. Nous partons doucement à travers les rues ensablées. Un chapeau immobile dans la fournaise, il dépasse d’un mur. Y a-t-il une tête dessous? Je l’interpelle par un «per favor» dans ce silence troublé uniquement par le vent, qui comme chaque après-midi monte en puissance. Effectivement, mon appel a un effet. Le chapeau pivote puis s’élève et une tête tirée du sommeil dans la torpeur ambiante nous regarde et répond à nos questions. Il nous faut repartir en direction du salar. Nous voilà à nous battre contre le sable qui obstrue le chemin. Vers les 18 heures nous décidons de nous arrêter et de monter la tente dans une légère dépression creusée par les eaux lors des rares précipitations. La tente est spacieuse. Nous avons de bonnes réserves d’eau et de nourriture. Une belle platée de riz est vite préparée et aussi vite engloutie. Le moral remonte après cette journée où nous avons effectué plus de 80 kilomètres dont 47 sur le sel.
Assister à la venue de la nuit dans un lieu aussi insolite s’apparente plus à un rêve qu’à la réalité.
Bien que nous soyons bien installés, l’effet de l’altitude plus de 3600 mètres se fait ressentir sur la qualité de notre sommeil. Au matin dans un air immobile nous déjeunons rapidement et plions vite notre matériel et nous voilà en route pour Luca que mon GPS donne à 10 kilomètres. Nous y voilà. A la recherche d’eau, une femme nous donne une indication et nous nous présentons devant une cour. Un homme nous invite à entrer. Il nous offre un plein seau du liquide précieux. Nous en remplissons nos nombreuses bouteilles. Nous lui demandons si nous pouvons faire une lessive, car nos habits sont complètement imprégnés de
sel. Son épouse nous prête une bassine et nous voilà lancés à neuf heures du matin dans la plus improbable lessive de notre existence. On nous vend même deux bananes que nous dégustons avec grand plaisir.
A dix heures après des remerciements chaleureux nous reprenons notre route. Elle escalade les hauteurs au sud du village. Cependant une trace directe à travers un «golfe» en bordure de salar nous laisse envisager un raccourci possible. Alors la chance nous sourit, un véhicule s’arrête et nous voyant dans l’hésitation le chauffeur nous confirme que si nous suivons cette trace à travers cette zone de sel et de sable nous arriverons à Alcaya, le lieu que nous cherchons à rejoindre. Comme souvent dans ces bordures de salar les parties très roulantes et les parties ensablées alternent. Globalement nous avançons de façon satisfaisante. Mais la chaleur devient infernale. Vers midi nous quittons définitivement la zone du salar pour la terre ferme. Il fait horriblement chaud, mais rien pour s’abriter. Flora remarque une buse qui passe sous la piste. Il n’en faut pas plus et nous voilà allongés à l’intérieur à la recherche d’un peu d’ombre à nous faire cuire une gamelle de riz. La situation me fait penser au livre de Bernard Ollivier.
En effet, lors de sa traversée du désert de l’Atlamakan en Asie il recourt aussi aux buses sous la route à la recherche d’un peu d’ombre. Sous notre piste nous profitons de ce moment de répit. Un bruit de moteur. De toute évidence il s’agit d’un deux roues. Je sors de notre trou et monte sur la piste. Le véhicule s’arrête et nous engageons la conversation. Le conducteur m’indique que le village d’Alcaya se situe à quelques kilomètres. Nous décidons donc de nous y rendre malgré la terrible chaleur qui nous écrase. Effectivement deux kilomètres plus loin sur notre gauche apparaît l’un de ces villages typiques, figés dans la désolation et l’absence apparente de vie. Nous y entrons. Dans une cour je vois deux femmes. Nous nous rendons au centre, où de drôles de constructions attirent notre attention. Il s’agit du fameux musée précolombien, qui retrace l’histoire d’une civilisation disparue il y a cinq mille ans d’après ce l’on nous expliquera. Pour le moment personne, tout est fermé et j’ai mal à la tête en proie à un début d’insolation. Je pars à travers le village à la rencontre des deux femmes entraperçues. Gentiment l’une d’elles m’accompagne jusqu’à la maison du couple qui pour une période de deux semaines gère ce site. L’épouse nous fait visiter le musée qui recèle quelques restes de cette civilisation perdue, puis le mari nous propose une visite de la ville morte dans la montagne. Nous acceptons mais seulement à partir de 18 heures en espérant que la chaleur devienne supportable. Ils nous invitent à prendre une douche, et nous découvrons de ce fait qu’il y a de quoi loger deux fous égarés dans cette fournaise. Il ne nous en faut pas plus pour profiter de cette occasion inespérée qui nous évite un bivouac dans des conditions difficiles.
A 18 heures, après avoir savouré la délicieuse omelette confectionnée par la maîtresse des lieux nous partons pour une incroyable visite dans la montagne sur les traces d’une civilisation disparue. Le guide et Flora marchent allègrement, pour ma part j’ai du mal à avancer encore sous l'emprise d’un coup de chaleur. Ce que nous découvrons est tout simplement stupéfiant. Une ville étrange, immense toute de pierre à flanc de montagne. Les constructions ressemblent à de petites borilles semi-enterrées. Il n’y a pas de porte, seulement un orifice à section carrée d’une quarantaine de centimètres de côté qui permettait aux habitants de se glisser dans leurs habitations. Cela me semble effrayant et je ressens tout le poids de la claustrophobie à l’idée de me faufiler à l’intérieur. Mais le plus surprenant provient des sépultures qui recèlent des momies conservées dans des conditions étonnantes de par les millénaires. Cela est dû à l’hygrométrie presque nulle de ces montagnes les plus arides de la planète. Absolument stupéfiant. Les images se passent de commentaires! Cette civilisation aurait été anéantie par la chute d’un météorite à quelques dizaines de kilomètres. On peut effectivement voir un cratère de belle taille pas très loin.
Le lendemain départ matinal malgré un quiproquo dû au fait que nous sommes restés à l’heure chilienne qui diffère de celle de Bolivie. La journée commence par un poussage des vélos sur une piste dure mais trop raide pour que nous restions sur nos montures très lourdes. Arrivés au col qui nous domine après une petite heure, devant nous se dévoile le salar d’Uyuni, le plus grand de la planète. Nous restons subjugués par le spectacle. La petite ville de Salinas est vite atteinte. Il s’agit d’une bourgade où le marché sur la place centrale donne une activité inhabituelle dans ces coins reculés.
Comment vous parler en quelques mots des cinq cents kilomètres suivants, parcourus en onze jours entre le plus grand salar du monde Uyuni et la traversée du sud Lipez haute terre entre 4000 et 5000 mètres, où le climat touche au paroxysme, grand froid la nuit, de la glace dans la tente, et des températures fortes la journée et puis ce vent terrible qui se lève systématiquement vers les onze heures pour ne s'apaiser qu'une heure après la venue de la nuit. Et encore ces poussages de vélos à l'infini dans le sable et les champs de lave. Un jour nous avons poussé 8 heures d'affilé dans la tourmente et une montée terrible avec un passage au-dessus de 4700 mètres presque jusqu'à la tombée de la nuit. Mais Flora indestructible ouvrait le chemin. Et puis ces rencontres de fous animés par la même envie de dépassement qui rigolent dans les pires situations. Une nature aux teintes inimaginables, on croirait qu'un spécialiste a retouché les couleurs des montagnes du ciel, des nuages et des lagunes. Les quelques photos ci-dessous vous donneront un bref aperçu de ce que furent ces jours de joie intense dans l'effort.
Sur cette dernière photo nous sommes Flora et moi avec Daniel un Allemand voyageant au long cours jusqu'à la Tierra del Fuego. Nous effectuons les derniers kilomètres presque à reculons tellement nous avons l'impression de terminer une expérience d'une rare intensité au milieu de ces hautes terres boliviennes.
Dans quelques kilomètres le goudron et après une descente de 47 kilomètres, 2200 mètres plus bas à 2400 mètres d'altitude la ville très touristique de San Pedro de Atacama. La prochaine étape le Passo Sico à plus de 4000 mètres va nous conduire en Argentine, à la découverte d'une autre partie de ces immensités désertiques de l'Amérique du Sud.
Sur le lien suivant vous pouvez lire le compte-rendu spécifique que j'ai fait concernant cette traversée de 10 jours du Sud Lipez:
Notre traversée du Sud Lipez à vélo
J'allais oublier: on a vu Moustaki
Donc après une journée et demie passée dans le village de San Pedro de Atacama, le Sud Lipez ne nous a pas calmés, mais au contraire notre envie de repartir dans ces grands déserts est plus forte que jamais et sur les 500 kilomètres à venir nous n'allons pas être déçus! L'aventure sera à la hauteur de ce que nous venons de vivre précédemment.
10 Novembre Départ pour le Paso Sico
Ce col va nous donner accès à l’Argentine. Depuis San Pedro de Atacama deux chemins sont possibles le Paso Jama et le Paso Sico. Les deux sont de redoutables obstacles. Nous choisissons ce second col car d’une part nous avons déjà parcouru les 42 derniers kilomètres du précédent à la sortie du sud Lipez, et d’autre part il est réputé plus facile, bien que asphalté uniquement sur les 85 premiers kilomètres de la montée qui en comprend 216. Et je ne parle pas de la descente en Argentine, où nous ne retrouverons le goudron après San Antonio de los Cobres, c’est à dire 135 kilomètres plus loin, sans parler des portions qui par la suite ne sont pas asphaltées.
Nous partons donc à l’assaut de ce col assez tardivement, vers les 9h30, du fait des démarches douanières qui doivent se faire impérativement à San Pedro de Atacama, alors que nous ne quitterons le pays véritablement que trois jours plus tard. Nous prenons un bon rythme sur la route goudronnée. Nous longeons le salar d’Atacama qui s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Sans incident nous arrivons dans le village de Socaire vers les 17h après 86 kilomètres et 800 mètres de dénivelé.
Nous sommes tout étonnés de cette distance parcourue, en pensant aux minuscules distances que nous effectuions dans le Sud Lipez en poussant nos vélos toute la journée, parfois à peine 20 kilomètres et généralement de l’ordre d’une trentaine. Très gentiment un homme nous accompagne pour trouver un logement. Ce n’est jamais très simple, mais nous finissons par avoir satisfaction. Le soir le restaurant attenant nous confectionne une excellente platée de spaghettis, mais nous en aurions bien mangé deux fois plus.
Le lendemain départ matinal, nous espérons monter rapidement. En effet, nous sommes à 3200 mètres d’altitude et la Paso Sico, bien qu’encore fort éloigné ne culmine qu’à 4060 mètres. Mais ce que notre carte ne nous dit pas, car pas assez précise, c’est qu’avant de l’atteindre il nous faudra d’abord passer trois points hauts dont deux dépassent les 4600 mètres. Nous sommes lourdement chargés, en particulier 7 litres d'eau chacun, car nous savons que nous avons peu de chance d’éviter un bivouac. Les deux premières heures sont longues, cloués sur place dans une pente raide en terre. Vers midi le vent va se lever et par moments souffler en furie. Nous ne nous en plaignons pas car il nous pousse.
Par moments il soulève de tels nuages de poussière que nous sommes littéralement aveugles, et nous devons nous immobiliser. Nous dépassons allègrement les 4200 mètres avant de replonger vers des lagunes d’une beauté stupéfiante. Nous commençons vers les 15 heures à nous demander où nous allons bien pouvoir nous arrêter pour la nuit dans ces éléments déchaînés. Vers les 17 heures sur le bord gauche de la route à quelques centaines de mètres un énorme rocher d’une dizaine de mètres de haut semble présenter un écran contre ce vent rageur. A son pied nous découvrons un petit espace sableux, qui correspond parfaitement aux dimensions de notre tente. Le lieu est parfait, l’altitude est un peu supérieure à 4200 mètres. Une fois bien installés nous pouvons assister à l’évolution des couleurs dans ce monde stupéfiant de l’Atacama. Au sol une herbe rase à la couleur jaune avivée par le soleil rasant se découpe sur le rouge sombre des montagnes qui l’entourent. Le tout rehaussé de touches de blanc éclatant, d’une part dû aux quelques névés qui subsistent et d’autre part du fait de la couleur de la roche qui par endroits s’apparente plus à du talc qu’à de la pierre. Absolument fantastique. Nous nous disons que tous les efforts consentis sont bien payés, de pouvoir assister bien installés dans notre tente à ce spectacle unique de la nuit qui vient sur ce désert de l’Atacama.
11 novembre
Après une nuit confortable malgré le vent qui a soufflé par intermittences et parfois très fort nous sommes d’attaque pour une nouvelle journée avec la ferme intention de passer en Argentine. Le Paso Sico n’est qu’à quarante kilomètres, mais ce que nous ignorons, c’est qu’avant de l’atteindre il nous faudra d’abord franchir deux passages au-dessus de 4600 mètres par des pistes pas très bonnes, pour ne pas dire plus, et le poussage sera long dans la première partie.
Donc vers huit heures après un petit déjeuner à base de flocons d’avoine nous nous mettons en route pleins d’entrain. Très vite la piste devient exécrable, et de plus elle monte dans le ciel. Deux heures plus tard nous atteignons le Camp el Laco à 4600 mètres. S’y trouve un ensemble de bâtiments. Flora a la géniale idée d’aller voir si nous pouvons nous y approvisionner en eau et éventuellement acheter quelques denrées. Il s’agit d’une base de mineurs. Ils nous invitent à un petit déjeuner gargantuesque, qui nous remet d’aplomb, car nos rations congrues ne sont pas vraiment adaptées aux efforts que nous effectuons. Nous passons une heure exquise à manger comme des ogres dans une douce chaleur.
Chez les mineurs je n'ai pas eu le temps de faire la photo qu'on avait tout mangé!
La reprise n’est pas trop dure, le vent est modéré et le soleil darde des rayons généreux. Cependant la pente continue à monter vers le ciel et pourtant le camp est à 4600 mètres. Enfin nous arrivons au sommet de cette bosse et nous découvrons de l’autre côté un salar de plus, tout à fait splendide dans ce monde minéral. Sur le bord, minuscule, le poste frontière chilien. Nous l’atteignons, un dernier contrôle et nous continuons en direction de l’Argentine, encore fort éloignée. Le point frontière est à 25 kilomètres et le poste argentin 11 kilomètres plus loin. Avant de quitter les douaniers chiliens nous leur demandons de l’eau. Ils nous offrent une bouteille de 1,6 litre, c’est toujours cela en plus en cas de nouveau bivouac.
La piste est un enfer, nous poussons sur plusieurs kilomètres. On se dit que jamais nous ne serons en mesure d’atteindre ce fameux Paso Sico. La piste ne s’améliore pas et commence à repartir dans le ciel. Mais le décor est tellement surréaliste que nous sentons à peine nos efforts, même si nous sommes quelque peu inquiets de la moyenne ridicule de notre déplacement.
Puis la délivrance arrive. Au sommet de cette nouvelle bosse, la piste s’améliore et nous nous engageons dans une descente d’une extraordinaire beauté, parmi des roches multicolores, de hautes dunes et des salars qui virent au rose. Dans un immense cratère plusieurs cônes de terre offrent un spectacle d’un esthétisme parfait. Bien loin vers le bas un gigantesque salar se dessine.
Cette région gigantesque est loin des dimensions européennes. Notre vitesse sur une piste dure est tout à fait satisfaisante et rapidement nous atteignons ce fameux Paso Sico, qui n’est pas à proprement parler un col, mais plutôt une plaine d’altitude.
11 kilomètres plus loin le poste argentin. Les formalités sont rapides. Dans ce coin de désert nous sommes les seuls à nous présenter à la frontière. Manifestement les 36 kilomètres de piste entre les deux postes chilien et argentin se sont pratiquement pas utilisés. Nous n'y avons pas vu un seul véhicule. Il est déjà 16h30, et nous demandons aux douaniers s’ils peuvent nous héberger pour la nuit. Ils refusent. Ils nous donnent cependant une bouteille d’eau. Ils nous indiquent un village à 18 kilomètres où nous pourrons trouver un hébergement. Ce qui est embêtant, c’est que ce n’est pas notre route. Ils nous certifient que le village se trouve sur un autre itinéraire qui n’est pas plus long et qui rejoint la route de Salta cinquante kilomètres plus loin.
Il ne nous en faut pas plus pour nous lancer dans une course effrénée pour essayer de rejoindre ce village avant la nuit. Même si le vent est avec nous, cela commence assez mal, une terrible piste en tôle ondulée qui de plus monte. Après quelques kilomètres nous nous demandons si nous n’avons pas réagi trop impulsivement. Mais il est trop tard pour faire demi-tour, donc nous forçons sur nos pédales malgré la grosse journée que nous avons déjà derrière nous. Par miracle la piste s’améliore et le vent persiste en notre faveur. Vers 18 heures nous atteignons ce village étonnant de Catuan, minuscule enfermé dans une gorge désertique. Nous y trouvons un logement rudimentaire et faisons quelques courses dans un mini-market qui n’a pas grand chose à offrir. Le coin est très dépaysant. Nous nous disons qu’il est préférable de loger chez l’habitant que de monter notre tente sans contact avec la population.
12 novembre
Départ vers les 8 heures après nous être confectionné notre petit déjeuner. Il fait bon, le soleil chauffe et le vent est nul. Le matin dans ces hautes terres est toujours agréable. On a du mal à imaginer que la nuit y soit si hostile. Après quelques kilomètres qui nous laissent pleins d’espoir quant à la facilité de cette portion de route non prévue, nous tombons sur les premières difficultés et elles sont de taille, une piste qui monte et qui est entièrement sablonneuse. Il s’ensuit une épuisante séance de poussage. En trois heures nous n’effectuerons que 13 kilomètres. Notre étape du jour en comporte 45. De plus pas une voiture, nous sommes vraiment sur une piste presque à l’abandon. Ce qu’il y a de plus épuisant nerveusement sur ce type de chemin, c’est de ne jamais savoir quand le sable commence et où il va s’arrêter. Parfois après cent mètres on peut remonter sur les vélos mais voilà qu’ à nouveau il faut pousser sur plusieurs kilomètres et tout cela dans une pente qui ne faiblit pas. La roue avant a tendance à se mettre de travers, entraînée par le sable pulvérulent. Les efforts pour la remettre dans l’axe sont épuisants. Avec cela l’altitude continue de monter alors que nous sommes déjà à plus de 4000 mètres. Loin devant nous, nous distinguons une crête. De toute évidence c’est par là que passe notre itinéraire pour rejoindre la route nationale qui va vers Salta. Enfin après plus de trois heures le point culminant vers les 4300 mètres est atteint. Comment va être la descente?
Un peu sableuse mais nous réussissons à prendre un bon rythme et enfin dans le lointain, à l’aide des jumelles de Flora, nous apercevons les véhicules qui lèvent des nuages de poussière sur la route que nous convoitons. Un salar de grandes dimensions nous en sépare. Nous le traversons sur une piste dure et le plaisir de se trouver dans ces environnements inhabituels est très grand.
Malgré l’immensité qui se développe devant nous, notre vitesse qui doit frôler les 20 km/h nous laisse envisager de rejoindre rapidement cette fameuse nationale que nous avons quittée hier soir au poste de douane. Nous y sommes vers 13 heures. A l’abri d’un mur en ruine nous faisons une pause casse-croûte, thon, pain et une demi-pomme. Le lieu est désolé, complètement à l’abandon. On se croirait vraiment dans ces cités construites à la va-vite lors de la ruée vers l’or et désertées quelques temps plus tard du fait des espoirs déçus d’enrichissement du fait du défaut de filons rentables.
La nationale est une affreuse piste sablonneuse molle qui alterne avec des passages redoutables de tôle ondulée. Deux états de la route qui sont un enfer pour le cycliste. Notre but de ce jour, le village de Olatacapo est distant de huit kilomètres. Il nous faut une bonne heure sous une chaleur forte pour les franchir. Les cinq cents derniers mètres pour accéder aux maisons sont impraticables et nous voilà à nouveau à pousser. Nous trouvons un hébergement et sommes satisfaits que cette étape prenne fin vers les 15 heures, car les jours précédents nous sommes restés dix heures sur ou à côté de nos vélos.
13 Novembre Olatacapo à San Antonio de los Cobres 60 km
Après une bonne nuit nous décidons de partir de bonne heure car l’étape de la journée fait plus de 60 kilomètres. Cela peut paraître peu, mais vu l’état de la fameuse RN 51 nous nous attendons à une étape que je qualifie de peu tranquille. Et je suis loin d’imaginer ce qui nous attend. En effet mon GPS donne la ville de San Antonio de los Cobres vers les 3900 mètres. J’en déduis que nous aurons peu de montée. Là, je me trompe très nettement. En effet il nous faudra passer un col à 4560 mètres d’altitude, et la piste est franchement horrible, sable en permanence et tôle ondulée très fréquemment. 31 kilomètres de montée, ils me semblent interminables. J’en arrive même à me demander ce que je fais là dans ces pentes infinies. Mais le col est enfin atteint et la descente ne pose pas vraiment de problème même si nous nous faisons secouer très sérieusement.
Ces grandes randonnées à vélo ont ont un côté étrange. Alors que l’on passe des heures à se traîner le long de pistes sablonneuses ou dans des pentes trop raides pour rester sur nos montures, eh bien dès que la phase suivante se présente, on oublie du passé, tout du moins tout ce qui nous a demandé des efforts épuisants, pour ne se souvenir que des paysages à couper le souffle.
14 Novembre San Antonio à Campo Quijano 130 km
Aujourd'hui nous allons renouer avec la route asphaltée, mais d'abord vingt kilomètres de piste. Cette dernière n'est pas mauvaise et nous n'aurons pas à pousser nos vélo dans le sable. Puis enfin le goudron, ce que cela est bon. Rapidement nous atteignons le Abra Blanca, col qui frôle les 4000 mètres. Alors s'ouvre à nous une descente gigantesque, qui va nous permettre d'effectuer plus de 130 kilomètres ce jour. Dans un premier temps le vent nous est favorable, mais dans l'après-midi il s'inverse et redouble de vigueur. Après un moment d'hésitation nous reprenons notre descente en appuyant sur nos pédales. Avec Flora nous nous relayons en tête face au vent rageur. Nous prenons goût à cet effort. Une dernière section de piste de 22 kilomètres et nous arrivons vers les 18h dans la petite ville de Campo Quijano.
Nous quittons la piste pour l'asphalte
Encore 22 km de piste, mais après nous devrions rester sur le goudron pour des centaines de km
Nous ne sommes plus qu'à une vingtaine de kilomètres de la ville de Salta. Mais nous avons décidé de ne pas nous y rendre. Nous mettrons le cap directement sur Cafayate.
15 Novembre Campo Quijano à Coronel Moldes 70 km
Nous sommes un peu déboussolés, d'une part du fait de quitter les pistes sur lesquelles nous évoluons entre 4000 et 5000 mètres depuis quatre semaines pour retrouver l'asphalte et la civilisation, et d'autre part du fait de la température modérée le soir et la nuit, alors que nous étions habitués au grand froid et aux moins dix degrés au lever du jour. Plus besoin de grosse couverture et de se coucher tout habillé. Au contraire il fait vite chaud et un simple drap suffit.
Nous nous levions tôt pour pouvoir rouler un maximum sans vent, il est toujours là et en plus il semble défavorable alors que généralement il était notre allié. Mais ce que nous allons devoir combattre maintenant ce sont les chaleurs suffocantes. En effet, au-delà de midi les quarante degrés seront dépassés, et de plus le vent fera virevolter des nuages de poussière. Donc on a l'intention de rouler de 6h à midi et de se trouver un coin à l'ombre pour l'après-midi.
Donc, fort de ce précepte nous démarrons ce matin seulement à 8H30. De plus suite à une erreur d'itinéraire, notre carte au 1/2 000 000 ne permet pas le détail, nous faisons une distance supplémentaire sans doute d'une bonne quinzaine de kilomètres. Mais dans le fond cela n'est pas plus mal, car cela nous évite la dernière portion de piste. Nous n'avons pas dû perdre beaucoup de temps. Que nous avons l'impression d'aller vite sur cette route asphaltée. Nous menons à tour de rôle et les kilomètres défilent. Deux petites pauses pour manger un gâteau une pomme et se désaltérer et nous sommes à Coronel Moldes un peu après midi.Nous avons abattu de l'ordre de 70 kilomètres. Mais il est vrai que les derniers dans la chaleur et contre le vent étaient fatigants. En dehors du grand plaisir d'avoir l'impression d'aller très vite, tout en faisant attention à la circulation parfois assez dense, nous n'avons rien remarqué de particulier sur ce tronçon. Nous ne sommes plus dans le même voyage qu'au cours des quatre semaines précédentes. Nous espérons cependant que la route jusqu'à Cafayate sera plus pittoresque que notre étape du jour. Je vous en reparlerai sans doute dans deux jours car cette ville est distante de 130 kilomètres. Mais si le démon de la défonce nous prend et que le vent trouve cela rigolo et nous aide, ce sera peut-être demain! Mais ne rêvons pas trop!
16 Novembre Coronel Moldes à Cafayate 128 km
Départ à 6h, il fait encore nuit. Après une brève hésitation nous nous lançons. A cette heure la ville est endormie et la route est déserte ou presque. Démarrer comme cela au petit matin et très agréable du fait du trafic nul ou presque et de la fraîcheur. Les conditions sont idéales pour pédaler. Attention seulement aux chiens que l’on voit tardivement dans ce jour tout juste naissant. La première bourgade de la Vigna est vite atteinte, 23 kilomètres en une heure. On comprend que nous avons toutes les chances de rejoindre Cafayate si les conditions se maintiennent, absence de vent et ciel couvert. La route s’insinue dans des gorges magnifiques. Sur 80 kilomètres une multitude de formations rocheuses et terreuses va nous étonner à chaque virage et à chaque montée. Le rouge prédomine. Une rivière au flux presque nul s’étale et donne l’illusion d’un large cours d’eau, car le sable du lit est mouillé.
Le vent nous est favorable et à 13H30 nous arrivons à Cafayate, petite ville touristique, dont la réputation provient de son vignoble, en particulier de son vin blanc. Allons-nous le tester? Pas si sûr car demain il nous faut rouler et ils ne vendent pas de demi-bouteille!
Le fait de rouler de cette façon en partant avec le jour est agréable à plus d’un titre et cela permet de passer tranquillement l’après-midi à se reposer en déambulant sans se presser dans la ville et puis aller s'asseoir à la terrasse d’un café à regarder la vie locale. Dans ces conditions on est bien en forme pour enfourcher nos montures dès le jour naissant le lendemain avec l’intention de dépasser encore une fois les 100 kilomètres. Cependant nos ambitions risquent d'être contrariées par un col de plus de 3000 mètres d'altitude qui s'annonce sur notre route. La grande étape risque plutôt d'avoir lieu le lendemain jusqu'à Concepcion.
Une fois arrivés à Cafayate nous avons élu domicile dans un petit hôtel sympa qui met à notre disposition une cuisine. Nous partons immédiatement faire des courses, légumes, œufs, sardines, pain et fromage de chèvre. Flora confectionne une grosse salade que nous accompagnons d’une énorme platée de pâtes. Nous engouffrons tout cela de bon appétit.
Le moral est au beau fixe. Si les conditions de route se maintiennent, vent pas trop gênant, et chaleur raisonnable comme aujourd’hui, nous envisageons de rouler jusqu’à Mendoza puis Santiago sans jamais avoir recours au bus. Pour le moment nous n’en sommes pas encore là. Nous avons décidé de rejoindre la Rioja, ville distante d'à peu près de 500 kilomètres et de faire un point à ce moment.
17 Novembre Cafayate Aimaicha de la Valle 75 km
Aujourd’hui nous allons rouler sur le mythique Ruta 40. Nous quittons Cafayate à 6H20 après que je sois retourné récupérer ma frontale oubliée sous l'oreiller. A la sortie de la ville les vignes s'étirent sur plusieurs kilomètres. Hier nous avons bu un excellent blanc d'ici.
La route en ce dimanche matin est déserte et nous avançons rapidement. Nous en profitons pour faire un petit détour de quelques kilomètres par une piste afin de visiter un ancien site indien. Il s'agit d'une multitude d'enclos aux murs de pierre qui s'étalent le long d'un grand flan de montagne. Nous n'avons pas bien compris ce que cela représentait. Il s'agit du site indien de Quilmes.
Vers midi nous arrivons dans la petite cité de Aimacha. On a l'impression qu'elle reste complètement en dehors des circuits touristiques.
18 Novembre Aimaichi à Tafi del Valle 57 km
Départ 6h, il fait frais. Une longue montée de 28 km nous attend, le dénivelé est de l'ordre de 1100 mètres et le point haut se situe à 3050 mètres. Il nous faut plus de 4 h pour franchir l'obstacle. Nous redescendons ensuite rapidement sur la petite ville de Tafi, qui est sympathique bien que très touristique.
19 Novembre Tafi del Valle Concepcion 100 km
Ce matin départ 6h. Il pleut nous sommes tout étonnés. On hésite, plutôt j' hésite car Flora veut foncer sans se poser de questions. Il fait nuit la route est mouillée, mais nous partons. Un peu plus loin on s' arrête quelques minutes dans un abri-bus car la pluie s'intensifie. Mais avec le jour cela va s'arranger. Ce matin nous allons perdre deux mille mètres d'altitude par une longue descente dans une gorge verdoyante, Après un mois de désert cela est étonnant d’être entouré de verdure.
Il va m'arriver un drôle d'incident, le roulement à billes de ma pédale gauche va casser à 12 kilomètres de Concepcion. Mais je vais réussir sans trop de difficultés à pédaler seulement avec l'axe de la pédale. Heureusement, j'ai pu en acheter une nouvelle paire en arrivant en ville.
La route est très passante et nous sommes dans des plaines de basse altitude. Cela me rappelle un peu les 700 kilomètres que j'ai effectués en début d'année entre Paksé au Laos et Bangkok, lors d'un périple de 4000 kilomètres autour du Mékong. J'avais trouvé du plaisir à rouler sur des routes très passantes, même sur autoroute, on abattait de l'ordre de 130 kilomètres par jour. Mais voilà aujourd'hui, Flora ne l'entend pas comme cela et ne trouve plus d'intérêt à pédaler dans ces conditions dangereuses. Nous prenons donc le premier bus pour Mendoza. Il nous faut la nuit pour y parvenir.
20 et 21 Novembre Mendoza
Nous passons deux jours de repos à Mendoza. La ville est agréable, bien arborée. Nous somme au centre ville dans une auberge de routards. L'ambiance est agréable, même si la nuit ça parle fort très tard. Demain nous reprenons la route pour notre dernière étape de 400 km jusqu'à Santiago.
Agent du Mossad prêt à l'action
Gloire à l'armée des Andes pour l'indépendance de l'Argentine
22 novembre Mendoza à Villavicencio 50 km
Nous décidons de passer par la route 52 et non la nationale 7. Certains nous la conseille d'autres non. Comme toujours lorsqu'on pose une question, on a toutes les réponses possibles. Déjà le fait que la circulation soit faible est un argument de poids en faveur de notre choix.Avec le recul de deux jours, ni Flora ni moi ne regrettons notre décision, bien que le chemin soit beaucoup plus difficile, route de terre sur plus de 40 kilomètres et le passage d'un col avec 2300 mètres de dénivelé.
Donc ce matin à six heures nous quittons notre auberge et prenons la route au lever du jour. A cette heure matinale nous n'éprouvons aucune difficulté car le trafic est quasiment nul. L'agglomération n'est pas très grande et en dix kilomètres nous sommes en pleine nature. Une gigantesque ligne droite part à l'assaut des Andes. En une vingtaine ou trentaine de kilomètres, tout en montant, elle nous conduit dans une petite gorge. Nous la suivons sur dix kilomètres et arrivons à la maison de la réserve naturelle de Villavicencio. Nous nous arrêtons pour visiter. Le gardien nous informe que l'hôtel un kilomètre plus loin est définitivement fermé. Nous qui pensions passer une bonne soirée, de plus avec des eaux thermales, eh bien non! Ce sera un bivouac à manger nos pâtes. Heureusement que nous avons toujours quelques provisions au fond des sacoches, car aujourd'hui nous sommes vraiment pris au dépourvu. Cet hôtel on en a entendu parler partout, et google earth l'annonce en gros. Mais voilà, afin de protéger la zone le gouvernement vient juste de prendre des mesures drastiques dont la fermeture du restaurant, l’hôtel quant à lui ne fonctionne plus depuis 1978!
Aujourd’hui nous avons vu des vigognes différentes de celles que l’on a côtoyées dans les hauteurs de l’Atacama. Nous avions l’habitude d’animaux d’assez petite taille, un peu plus d’un mètres et sans doute une vingtaine de kilos, très gracieux aux couleurs qui se fondaient bien dans le décor. Alors que là nous sommes en présence d’animaux beaucoup plus gros, d’une hauteur de deux mètres, beaucoup plus massifs et à la tête noire. De plus il y avait sur le bord de la route des panneaux annonçant «faune sauvage» avec une belle effigie de puma.
23 Novembre Villavicencio à Uspallata 57 km.
Départ 6h30, sans transition nous sommes engagés dans une montée de 28 kilomètres. La route escalade un grand flanc de montagne et nous conduit à un col à 2958 mètres d'altitude. Pour aujourd'hui il nous reste à peu près 1300 mètres de dénivelé à franchir. La route sera sur sa plus grande partie non goudronnée, ce qui apporte un petit air d'aventure à la montée. Les points de vue sont magnifiques. D'ailleurs, vu la dizaine de minibus de touristes qui nous doubleront au cours des cinq heures de la montée, l'endroit est réputé. Enfin le col, de là la vue s'étend à l'ouest sur les Andes et en particulier sur l'Aconcagua. Une belle descente de 28 kilomètres nous conduit à la petite ville de Uspallata. Sans trop de difficulté nous trouvons un hôtel pour la nuit.
24 Novembre Uspallata à Los Penitentes 64 km 1000 m de dénivelé
Nous partons un peu avant 6 heures. Il fait encore nuit. La circulation est très faible, nous sommes dimanche. Nous espérons qu’elle le restera. Mais non, rapidement le nombre de poids lourds va augmenter, malgré le jour férié. De plus le vent va se mettre de la partie . Il souffle en rafales et nous l’avons en plaine figure. Cela rend notre étape difficile. Nous évoluons dans un cadre superbe entourés de grandes montagnes de toutes les couleurs. Vers 13 heures nous arrivons dans une petite station où nous trouvons un hébergement dans un refuge qui de toute évidence sert de point de départ pour l’Aconcagua.
25 Novembre Los Penitents à Los Andes 97 km
Départ un peu après 6h car nous avons discuté avec Diego l'un des employés du refuge. Ce matin pas de vent, qu'il fait bon pédaler. Nous sommes entourés de hautes montagnes couvertes de glaciers. Le tunnel à la frontière de l'Argentine et du Chili se situe à l'altitude de 3200 mètres. Avant de l'atteindre nous surveillons sur notre droite le lieu où nous aurons un magnifique point de vue sur l'Aconcagua.
Une fois au tunnel, nous sommes pris en compte par un véhicule, car il est interdit aux vélos. Une fois de l'autre côté nous arrivons rapidement au poste frontière commun aux deux pays. Les Chiliens sont toujours assez pointilleux et il faut leur montrer tous nos aliments. Ils nous confisquent notre morceau de fromage. Une fois ces formalités terminées nous nous lançons dans une immense descente jusqu'à Los Andes, petite ville où nous arrivons vers les 16 heures.
La guerre des Malouines a laissé des traces!
26 Novembre Los Andes à Santiago 92 km
Aujourd'hui c'est la dernière étape de notre périple. Nous allons pédaler une dernière fois avant de nous séparer. Flora va partir vers le sud du Chili et moi je vais rentrer en France. C'est toujours un peu triste que l'on aborde l'ultime étape d'une belle aventure.
Mais très vite nous allons être plongés dans le feu de l'action, et pas le temps de se poser des questions métaphysiques. En effet ce dernier tronçon se fait en partie par autoroute, interdite aux vélos et parfois il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence et pour couronner le tout ce matin nous sommes partis par un matin gris brouillardeux. On n'a pas chaumé, un peu le stress aux fesses. Cette autoroute présente un tunnel. On l'a évité en prenant une belle route qui monte de 500 mètres et nous a permis de nous élever au-dessus de la nappe de brouillard. Lorsque nous sommes redescendu vers l'autoroute le temps était au beau. de plus sur les 18 kilomètres restant par autoroute il y avait une belle bande d'arrêt d'urgence, mais à plusieurs reprises de gros panneaux interdit aux vélos. Nous avons pris la sortie vers la ville de Colina comme une délivrance. Une dernière halte où nous avons mangé une dernière fois ensemble, puis encore 35 kilomètres pour arriver au cœur de Santiago. Circulation intense, l'agglomération compte 6 millions d'habitants. Flora qui ne perd pas de temps, s'arrête devant une quincaillerie, on achète du carton pour emballer nos vélos, elle pour le bus vers le sud et moi en prévision de l'avion. Nous roulons encore un peu ensemble avec nos rouleaux de carton sur nos sacoches arrières. On a presque le gabarit d'une voiture! Puis vient le moment où nos chemins se séparent. On reprend chacun ses affaires, on partage la caisse commune, une bise et s'est reparti chacun de son côté.
Mon souci premier, changer mon billet d'avion, ce qui se fera dans la foulée l'après-midi même et de trouver un logement. Je retourne à l'hostal Condell où j'avais déjà séjourné il y a quatre ans après une traversée de trois mois entre Équateur, Pérou, Chili et Bolivie. La patronne peut m'héberger une nuit, mais me trouvera un point de chute pour la nuit suivante.
J'ai emballé mon vélo dans le morceau de carton que j'ai acheté.Le paquet n'est pas terrible du tout. Le carton est fragile et casse. Je mets beaucoup de ruban adhésif, qui n'a d'adhésif que le nom et je renforce le tout avec de la ficelle. Ces retours avec vélo sont toujours assez délicats à gérer.
Pour finir j'adresse un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis et tout particulièrement à ceux qui ont pris le temps de nous mettre un ou plusieurs petits mots. En effet, on a beaucoup apprécié, car contrairement à ce que l'on pourrait croire l'action intense n'empêche pas de beaucoup penser à ceux et celles que l'on laisse et qui nous manquent.
Voilà c'est fini snif, mais je suis content de rentrer et tout particulièrement de retrouver ma chère et tendre Danielle que je remercie du fond du cœur de tolérer mes errances désertiques.
17:19 Publié dans expérience vécue, voyage à vélo | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : atacama, arica, coipasa, uyuni, sud lipez, bolivie, chili, argentine, paso sico, san pedro de atacama, arbol de piedra, laguna colorada, laguna verde
30/12/2014
Deux mois autour du Mékong à vélo: deuxième partie le Laos de la frontière nord à Luang Prabang
Mardi 5 février
Bonjour tout le monde, nous sommes dans les starting-blocks pour traverser le Mékong de Chiang Khong en Thaïlande à Huay Xai au Laos, et être dans les premiers à la douane, dans la perspective de notre première journée de pédalage au Laos.
Je mets la carte de notre trajet approximatif au cours du mois à venir. Il y aura des variantes, car comme je l'ai dit, les pistes sont trempées et nous prendrons les routes. Donc dans la première partie, nous passerons un peu plus au nord par Louang Namha, puis nous redescendrons sur Luang Prabang et irons à Vientiane. La partie sud devrait rester conforme aux prévisions.

Le tracé est approximatif en particulier dans la partie sud nous sommes revenus le long du Mékong durant 400 km avant Paksé.
Comme je l'ai dit, nous nous attendons à avoir moins de possibilités internet, donc nous ne serons sans doute plus en mesure de donner des nouvelles journalières. On fera au mieux!
Mardi 5 février Chiang Khong à Donchai 68 km
Dans notre chambre carcérale, nous passons une bonne dernière nuit en Thaïlande. Nous nous levons afin de nous trouver au poste frontière un peu avant l'ouverture. A 7h45 il y a déjà une quinzaine de personnes qui attendent. Parmi celles-ci un Français de 80 ans, qui ne les fait vraiment pas!
Les formalités côté thaï sont vite expédiées; immédiatement nous descendons au fleuve, prenons nos tickets de traversée et embarquons dans une pirogue. Les vélos sont chargés tels quels avec bagages. J'ai un peu peur qu'une vague, qui ferait tanguer notre frêle embarcation, envoie par dessus bord l'une de nos montures avec toutes nos affaires.
Mais non, tout se passe au mieux. Les formalités de l'autre côté sont un peu plus longues. A neuf heures tout est terminé. Nous tombons sur un couple de cyclistes ardéchois qui s'apprête à passer en Thaïlande, après avoir traversé le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Ils nous donnent des renseignements précieux. Avant de partir nous petit-déjeunons dans la petite ville frontière de Houay Say. Ce fut très bon et copieux, cependant beaucoup plus cher qu'en Thaïlande, 6 euros par personne. La monnaie locale est au taux de 10700 laks pour un euro. Nous nous retrouvons avec une montagne de billets!
Il est 10 heures, il fait chaud et nous avons 70 kilomètres à effectuer. Cette première journée sera éprouvante, du fait de l'heure tardive, et aussi du fait que je vais casser un autre rayon sur mon vélo. Au pied d'une immense côte un bruit sec et métallique ne laisse aucun doute sur son origine. Christian est devant. Une fois de plus j'attaque la pente à pied, afin de ne pas aggraver le mal. Après deux kilomètres très raides, la pente ne faiblit pas. Un gros camion s'arrête et les chauffeurs chargent mon vélo entre la cabine et la remorque et ils me déposent au sommet de la côte. Je leur dis un grand merci. Christian est tout étonné de me trouver là lorsqu'il arrive. En effet, lorsque nous l'avons doublé, il était tellement absorbé par son effort dans la chaleur suffocante, qu'il n'a pas levé la tête lorsque le chauffeur a klaxonné et que je l'ai interpelé par la fenêtre. Nous effectuons la réparation, grâce au démonte-moyeu que nous avons acheté à Chiang Rai. Cela devient inquiétant, c'est le second que je casse et il ne m'en reste plus qu'un!
Nous reprenons notre route. Le pays n'a plus rien à voir avec la Thaïlande. Les gens sont nettement plus miséreux. Leurs maisons alignées le long de la route sont de simples cabanes aux planches disjointes.
Vers 16 heures nous atteignons le village de Donchai, assez éprouvés par la chaleur terrible de cet après-midi. Le gîte est des plus rustiques, une grande couche pour deux, le matelas une simple planche en bois. Mais mon dieu, je vais bien dormir. Dans ce gîte une jeune polonaise est arrivée un peu avant nous. Elle voyage seule à travers l'Asie durant 6 mois. Les bouteilles de bière au Laos ont une contenance de 0,64 litre. Mais après de tels efforts sur une route surchauffée ça se boit d'un coup ou presque! Le repas du soir est excellent, un riz accompagné de multiples légumes. Autant la chambre est incomparable avec le luxe thaï, autant la nourriture, tout du moins ce soir, soutient sans problème la comparaison.
Mercredi 6 février Donchai à Vieng Phouka 51 km
Ce matin lever très matinal, nous voulons pédaler avant la chaleur. Cependant notre cuistot n'est pas à l'heure et nous partons seulement à 6h50. Mais il nous a cuisiné une grosse omelette avec des tomates et des oignons. Dès le départ une côte interminable nous fait sortir de la vallée embrumée et nous montons durant une bonne heure. Peu de circulation, des petits villages le long de la route desquels des multitudes de gamins nous disent bonjour. Vers 11h30 nous atteignons le village de Vieng Phouha. La chaleur commence à être très forte. Nous décidons de nous arrêter. Immédiatement une femme nous interpelle et nous propose son gîte. Il est très sympathique, quelques cabanes de palmes en bordure d'une belle pelouse très bien entretenue. Là aussi, une jeune Européenne nous a précédés. Elle est de nationalité allemande et voyage seule pour une durée de 9 mois.
Nous passons un après-midi très agréable dans ce village du bon du monde. Je pars à la recherche éventuelle de rayons de vélo adaptés à mes roues. Hélas, je ne trouverai pas. Notre jeune Allemande est avide de discussion, je ne me fais pas prier, car je ne rate jamais une occasion d'exercer mon allemand!
Le repas du soir sera sympathique par l'ambiance, mais la nourriture pas terrible. Le poulet est à la limite du mangeable, non par le goût, mais du fait de la manière dont il avait été découpé. On aurait pu penser qu'il avait été tué à la grenade et les morceaux d'os et les lambeaux de chair récupérés sur les murs! Particulièrement désagréable à manger, une multitude de fragments d'os très pointus, qu'il ne faut surtout pas avaler.
Jeudi 7 février Vieng Phouka à Na Teuy 87 km
Ce matin après une excellente nuit, lever 5h45, pour un petit déjeuner prévu à 6h15. Une fois de plus notre hôtesse est en retard et nous partirons avec 40 minutes de retard sur notre horaire prévu, il est 7h15. C'est la dernière fois que nous demandons le petit déjeuner. A l'avenir nous mangerons ce que nous aurons acheté la veille afin d'éviter d'être dépendants du lever tardif de nos hôtes!
Il fait frais, 10 degrés, le brouillard intense et de plus il mouille particulièrement. Nous ruisselons de grosses gouttes. Je comprends pourquoi Schoendoerffer appelait dans ses livres le Laos le pays des brumes.
Le long de notre route les habitants sont sortis de leurs habitations et se chauffent à de minuscules feux à même le bord de la chaussée. De ces silhouettes assises et blotties auprès de leur minuscules bûches incandescentes qui fument, le tout noyé dans une brume épaisse, il ressort une impression de grande pauvreté. Nous sommes vraiment très loin de ce que nous avons connu en Thaïlande.
Aujourd'hui les côtes ne sont pas très raides. De ce fait nous avançons rapidement. Je fais cependant attention de ne pas trop forcer sur mes rayons arrières.Dans une partie raide, je préfère pousser mon vélo afin de ne pas trop solliciter mes rayons abîmés. Mais en courant à côté de mon vélo je monte quand même à 9km/h, plus vite qu'en pédalant. Cependant, je tiens moins longtemps à ce rythme!
Vers midi nous avons effectué 87 kilomètres. Nous trouvons une guest house de bonne qualité et de plus elle a l'eau chaude.
Nous partons nous promener dans ce petit village qui n'est situé qu'à 20 kilomètres de la Chine. D'ailleurs si les routes sont en bon état depuis notre entrée au Laos, on le doit aux Chinois qui investissent pour le développement de ces régions près de leurs frontières. Le petit marché est miséreux, quelques fruits et légumes, deux bassines de gros poissons chats et puis c'est tout.
Vendredi 8 février Na Teuy à Oudom Xay 80km
Ce matin nous partons à 6h45, à l'heure prévue car nous petit-déjeunons dans notre chambre. Comme les jours précédents un brouillard assez épais nous accompagnera durant deux heures, jusqu'à ce que le soleil réchauffe l'atmosphère. Tout le long de la route des maisons misérables sont alignées. Les habitants sont assis à même la terre devant de minuscules feux. Partout des enfants qui se préparent et qui en groupes partent à l'école à pied. Malgré l'humidité et le froid, ce matin 11 degrés, certains sont très peu vêtus. Une petite fille de cinq ans, ne porte qu'un t-shirt à manches courtes.
Mais dès que le soleil fait son apparition dans un ciel dégagé, la température monte rapidement et cette sensation de grisaille et de tristesse se dissipe rapidement.
Vers midi nous atteignons notre but de la journée. Nous nous installons dans une guest house où nous rencontrons un couple constitué d'une jeune Allemande et d'un Mexicain, sans doute un peu plus âgé qu'elle, et qui sont en route à vélo depuis 18 mois. Nous déjeunons ensemble. Leur conversation est très intéressante, et nous parlons dans plusieurs langues, allemand, anglais, espagnol et même un peu français. Après le repas, avec Christian nous partons à la recherche de rayons pour mon vélo, mais sans trop d'espoir, car les roues de 700 sont très peu utilisées. Il me faudra sans doute plus tard m'acheter un vélo aux normes standardisées! Mais si nous ne trouvons pas de rayons, nous retrouvons Stéphane, le cycliste français rencontré à Chiang Rai. Nous allons boire un verre ensemble. Il nous parle d'un couple de Chinois à vélo, qu'il a doublé ce matin. Et voilà nos Chinois qui arrivent. Nous les invitons à notre table. Elle est professeur d''anglais et s'exprime très correctement. Nous passons un bon moment, puis ils reprennent leur route pour aller bivouaquer plus loin. Quel courage, il fait au moins 35 degrés.
Le soir nous nous retrouvons avec Stéphane, encore un repas bien sympathique. Après avoir croisé peu de cyclistes au long cours depuis un mois, je me dis qu'aujourd'hui nous sommes vraiment servis. Vers 20h30 nous nous séparons en nous disant simplement au revoir, car nos routes devraient se croiser à nouveau dans deux jours. Je dis un grand merci à Stéphane, qui m'a donné l'un de ses rayons de rechange, car il roule aussi avec des roues de 700, ce qui fait que j'ai encore deux rayons de rechange. Et je le remercie aussi d'avoir dévoilé ma roue, ce que je n'avais pas réussi à faire lors de la dernière réparation que j'ai effectuée il y a trois jours.
Samedi 9 février Udom Xai à Muang Khoua 100 km
Ce matin départ à 6h50, après avoir petit-déjeuné dans notre chambre, avec entre autre du pain que nous avons acheté hier soir. Ce pain est un compromis entre la baguette et la brioche. Il n'est pas très frais mais on le trouve quand même bon.
Ce matin comme les jours précédents, le brouillard est présent. Que tout semble triste dans ces petits matins mornes. Les bords de route ne sont pas très propres, une multitude de déchets plastiques constelle la végétation. La France à vélo n'offre jamais un tel spectacle de désolation. Peut-être faut-il partir pour se persuader que notre pays est vraiment la destination la plus merveilleuse?
Nous commençons par quelques bosses. Si le profil de la route reste le même sur les cent kilomètres que nous avons à parcourir, l'étape sera sportive. Mais il n'en sera rien. Après vingt kilomètres les bosses s'affaissent et alternent montées et descentes peu raides. Nous allons suivre une vallée dominée de forêts inextricables et au fond de laquelle coule une rivière à l'eau claire. De nombreux villages jalonnent notre itinéraire. Fréquemment nous voyons des pêcheurs qui réparent leurs filets accrochés devant leur maison. Cette étape me ravit, ce qui n'est pas le cas de Christian. Des goûts et des couleurs, il en faut pour tout le monde. Pour ma part, dès qu'au détour d'un virage je peux voir de l'eau courir sur des galets ou chercher dans des gros trous d'eau verts quelques poissons, je suis aux anges!
Nous croisons un cycliste au long cours. Bien évidemment nous nous arrêtons et nous lançons dans une discussion passionnée. Il s'agit d'un jeune Allemand qui est sur la route depuis 13 mois. Il a entre autre parcouru une bonne partie de l'Himalaya, en passant par différents pays, en particulier l'Inde et le Népal. Il nous montre carte à l'appui son trajet à travers ce gigantesque massif montagneux. Ça fait rêver. Ne t'inquiète pas Danielle je n'envisage pas de partir si longtemps, déjà deux mois le temps me semble long sur certains points! Ces cavaliers au long cours de la route et des pistes ont dans l'expression du visage une forme de sérénité, que j'ai vue chez les religieux des ordres réguliers. A chacun sa religion, ses croyances et son mode de vie. Mais l'accomplissement dans la durée, qu'il soit de renoncement ou d'effort amène une forme de béatitude, à laquelle j'aspire.
Les cent kilomètres vont être effectués sans trop de difficulté. Les trois premières heures de brouillard sont certes assez désagréables, mais cette période permet d'avancer sans s'épuiser sous une chaleur accablante.
Vers 13heures nous atteignons notre but, Muang Khoua. C'est une petite bourgade alanguie au milieu d'une forêt impénétrable, qui doit sa notoriété à sa position au bord de la rivière Nam Ou. Nous somme presque à l'extrême nord du Laos. La chine est toute proche.
Après avoir posé nos affaires dans une guest house, nous partons manger dans un petit restaurant qui surplombe la rivière. Nous pouvons voir les bateaux le long des berges, qui demain feront le trajet vers Nong Khiao, 115 kilomètres plus au sud. Nous comptons prendre cet itinéraire fluvial. Cela nous fera une journée de repos après nos 400 premiers kilomètres au Laos. Je dois dire qu'ils ont été moins difficiles que ce à quoi nous nous attendions. Les raidillons de la Thaïlande sont incomparablement plus difficiles que ce que nous avons parcouru ces cinq derniers jours.
Ce soir je pars pêcher dans la Nam Ou, que nous allons descendre demain. Je vois bien quelques poissons de petite taille sauter, mais je n'ai pas de touche.
Ce soir nous retrouvons le français Stéphane. Cela fait la troisième fois. Il compte rester un jour supplémentaire dans ce village. Nous nous donnons rendez-vous dans deux jours à Luang Prabang. En effet, il roule plus vite que nous et il effectuera les 150 kilomètres un un jour. Pour notre part tranquillement nous étalerons ce trajet sur deux jours.
Lundi 11 février Nong Khiao à Luang Prabang 145 km
Cette petite bourgade perdue au milieu des montagnes, nous n'en ferons même pas une photo, car la visibilité ne sera jamais suffisante. Seulement une fois la nuit tombée, hier soir nous aurons pu constater tout un magnifique cirque de montagnes.
Mais hélas, ce matin plus rien, sauf la grisaille à laquelle nous sommes habitués au lever depuis que nous roulons au Laos. Que ces départs matinaux sont mornes, et ce matin tout particulièrement. La visibilité réduite ne nous permet pas de voir plus loin que le bord de la route, jonché de détritus en particulier plastiques. Les trente premiers kilomètres sont vraiment tristes et c'est un véritable effort que je dois fournir pour pédaler dans ce décor de décharge publique sans intérêt.
Nous nous arrêtons boire un café, très bon que nous agrémentons du gâteau au chocolat que nous avons acheté hier. L'endroit très poussiéreux, carrefour de routes non goudronnées, est cependant très sympathique, car les gens y sont accueillants.
Nous repartons dans un meilleur état d'esprit. Le soleil fait de timides apparitions et vers les dix heures il s'installe vraiment. Le décor change prenant de la profondeur. De loin en loin des points de vue intéressants se laissent découvrir. Nous visitons les abords d'un temple. Il est orné à la manière des églises orthodoxes balkaniques. Un bonze s'approche tout sourire; mais hélas nous ne pouvons communiquer du fait de la barrière de la langue.
Tout au long de notre itinéraire les enfants très nombreux nous saluent avec des "sabadi" en insistant bien sur le i. Nous répondons à chacun, ce qui fait que nous sommes en permanence à envoyer des sabadi.
Nous comptions faire 80 kilomètres aujourd'hui. Nous ne rencontrons aucun point de chute susceptible de nous accueillir pour la nuit à venir. Vers treize heures trente, nous avons effectué 98 kilomètres. Nous nous arrêtons manger en bordure de route. Dans la chaleur une heure plus tard nous repartons. Nous ne verrons aucun hôtel avant Luang Prabang, voilà la raison pour laquelle nous effectuons cette longue étape d'une traite. Les quinze derniers kilomètres nous les parcourons au milieu d'une circulation très dense. Ce trafic très fourni est dû à la présence de nombreux Chinois qui viennent fêter leur nouvel an. Nous avons de la chance, car les jours précédents c'était bien pire! Nous arrivons à 17heures. Nous venons d'effectuer notre plus longue étape, presque huit heures sur le vélo, 7h51mn exactement.
La ville est grande, devant un hôtel manifestement chinois, on nous donne gentiment un plan de la cité, qui nous est bien utile. Nous trouvons rapidement un point de chute pour 12 euros à deux. Bien que ce soit plus cher que les jours précédents, cela reste très bon marché, pour une chambre de belles dimensions équipée d'une salle de bain fonctionnelle.
Cette cité est absolument remplie de touristes occidentaux. Une multitude de restaurants et de magasins, typiques des villes touristiques, sont très largement éclairés. Cela me fait une drôle d'impression. J'ai vraiment la sensation de me trouver sur la côte d'azur un soir du mois de juillet. Christian est moins critique.Attendons demain, quand il fera jour, pour se faire une idée de l'endroit.Nous avons passé aujourd'hui les 2000 kilomètres à vélo, et sans doute la moitié de notre périple à deux roues.
Mardi 12 février repos à Luang Prabang
Journée sans vélo, mais cela ne va pas durer, nous reprenons la route demain matin. Nous comptons cinq jours de trajet jusqu'à Vientiane, capitale du Laos. J'ouvrirai une nouvelle note de Luang Prabang à Vientiane, troisième partie.
Je vais essayer de mettre quelques photos de notre longue étape d'hier, mais internet est très lent, donc je risque d'attendre une prochaine étape où le débit sera meilleur.
Aujourd'hui nous nous sommes promenés dans la ville et le long du Mékong. Il est toujours aussi impressionnant par sa largeur. De très nombreux bateaux de transport de passagers occupent les rives. Je dois dire que l'envie de la route me rend impatient d'enfourcher ma monture. Ce que nous ferons demain dès le lever du jour.
18:05 Publié dans expérience vécue, voyage à vélo | Lien permanent | Commentaires (8)
30/09/2014
Balkans express
Un voyage rapide de vingt jours de Lyon à Lyon, 5200 kilomètres en voiture (Koleos) par différents pays des Balkans. Des impressions glanées au fil des arrêts dans les villes traversées. Vingt jours et huit pays, très vite trop vite, on n'a pas le temps de se poser. La polémique peut naître, cela ne s'appelle plus voyager mais se déplacer à grande vitesse sans même prendre le temps d'aller à l'essentiel. Mais au fait c'est quoi l'essentiel?
Ce voyage éclair je vais le décliner à travers un certain nombre de flashes au cours des arrêts dans les villes étapes. Les Balkans je les ai connus à différentes époques de ma vie. J'y ai vécu des évènements forts comme le siège de Sarajevo durant trois mois. Trois années de ma vie professionnelle se sont passées en Albanie. Dans ces différents pays je m’y suis aussi promené en touriste lors de voyages de courte durée. Je puis dire qu'une partie de mon cœur y est définitivement resté. Voilà pourquoi cette traversée même éclair fait resurgir du fond de ma mémoire une multitude de souvenirs plus ou moins enfouis, tristes ou gais et me permet de livrer nombre d’émotions ressenties au filtre de mon expérience de ces coins d'Europe particulièrement attachants. J’appuierai mon récit sur des photos de ce qui m’a le plus frappé au cours de ces 20 jours marathon.
Avec un grand plaisir en ce mois de septembre 2014, malgré le temps pas terrible, je fais découvrir à mes trois compagnons de voyage, mon épouse mon cousin et sa femme, ce véritable pays d'Ali Baba, les Balkans. Comme ils n'acceptent de voyager que dans de très bonnes conditions, je les laisserai choisir les hôtels dans lesquels nous descendrons. Mon dieu, nous sommes bien loin de la vie rude du cyclo à travers l'Atacama, mais je me laisse faire. Dans le fond voyager dans le confort c’est aussi une façon agréable de découvrir le monde, bien que les conditions spartiates permettent bien souvent une plus grande proximité avec les populations locales.
Somme toute, le prix de ce voyage, hôtels quatre ou cinq étoiles, et la plupart du temps, midi et soir, des restaurants excellents, sera loin d'être exorbitant. Cela va nous revenir par couple à 2600 euros. On est très loin du coût d'un voyage de trois semaines organisé par un voyagiste, avec un confort souvent bien inférieur. Le seul reproche que je fais quant à ce mode de voyage, c’est que ce n’est pas l’idéal pour la ligne !
BOSNIE
Sarajevo
Parmi toutes les villes que j'ai connues durant ma vie, deux m'ont fait une très forte impression, et parmi celles-ci il y a justement Sarajevo. Il est vrai que j'y ai vécu durant plusieurs mois en 1994 au cours d'une période très troublée, le Siège de la ville lorsque la Yougoslavie se désagrégeait. J'y suis repassé en 2008, déjà six ans, alors que la paix était revenue. Immédiatement j'avais été repris par le charme étonnant de cette ville toute en longueur le long de sa fameuse "sniper allée" et tout en moutonnements de collines de part et d’autre de cette longue avenue, de huit kilomètres.
Sniper allée
Notre hôtel est situé sur cette fameuse "sniper allée" pas très loin de l'aéroport. Il se nomme le Radon Plaza, immense building au « look » futuriste, qui s’élance sur 15 étages. Nous allons y passer deux nuits. Ce qui nous laissera une grande journée, laps de temps bien insuffisant, afin de s'imprégner de l’atmosphère de cette cité tant chargée d’histoire, où toutes les cultures se sont côtoyées, et qui fut aussi zone de confrontation entre l'empire ottoman et le monde de la chrétienté.
notre hôtel le Radon Plaza
Du restaurant tournant panoramique situé au sommet de notre hôtel, nous avons tout loisir de contempler la nuit qui s'installe sur cette grande ville. De nombreux souvenirs me reviennent à l'esprit, les obus, certains jours jusqu'à cinq mille, les avions de l'OTAN remontant parfois les rues à basse altitude afin d'intimider les différents belligérants, et puis aussi le bruit sec des tirs de petits calibres qui claquaient sur le blindage de notre véhicule. Aujourd’hui, l’ambiance est bien différente. La circulation est importante, et la ville très animée n’est plus du tout figée dans l’immobilité que la peur d’être abattu par un obus ou une balle de sniper, faisait en permanence régner sur le lieu.
De notre perchoir nous distinguons malgré le mauvais temps une bonne partie de la cité. Des ruines datant de la guerre sont encore visibles. Les grandes façades juste en face, que je contemple en dégustant mon repas agrémenté d’un excellent vin, me ramènent 20ans en arrière. Je me souviens les avoir vues toutes fumantes sous les coups de canon tirés par un char d’assaut embusqué à proximité, et qui sortait de temps à autre afin de lâcher quelques obus.
Ruines datant des bombardements
Nous partons nous promener au centre ville. Il est très impressionnant de se rendre au carrefour au bord de la rivière Miljacka, où ont été assassinés l'archiduc d'Autriche François Ferdinand et son épouse Sofia, préambule à la première guerre mondiale. Aujourd’hui la rivière charrie une eau rouge très boueuse, du fait des fortes précipitations qui sévissent depuis de nombreux jours.
Rivière Miljacka
La vieille ville avec ses rues aux larges pavés, sa multitude de mosquées et ses quelques églises, ses places, ses échoppes nombreuses et cette foule bigarrée qui déambule, donne vraiment l’impression d’être quelque part au pays d’Ali Baba, mais pas en Europe. C’est là que réside tout le charme des Balkans.
vieille ville de Sarajevo
Nous montons sur les collines au-dessus de la vieille ville, à la rencontre de l'immense cimetière où sont ensevelies de nombreuses victimes du long siège de Sarajevo conduit par les troupes serbes. Les tombes partent littéralement à l’assaut des hauteurs. Leur blancheur illumine la grisaille environnante, due à la forte masse nuageuse qui enserre la ville et ses reliefs. De très anciennes pierres mortuaires, érodées par le temps et les intempéries, remontant à l’époque ottomane, semblent s’être échappées de leur emplacement initial, et se répandent de façon anarchique dans les pelouses. Pour moi l’âme de Sarajevo réside exactement en ces endroits de vieilles pierres et d’herbe. Une multitude de minuscules mosquées, au minaret en bois souvent peint en noir, escalade ces pentes raides. Se déplacer en voiture dans ces rues très pentues, où les véhicules foncent, a donné des sueurs froides à nos deux passagères, d’ailleurs sans doute pas seulement à elles ! Je ne sais pas si l’expression parfois employée dans certaines situations scabreuses « c’est bosniaque » vient de là ?
Mostar
Encore une ville symbole du martyre vécu par la population au cours des évènements tragiques de la période 1992-1996. Son pont, qui avait été dynamité et reconstruit en 2004, représente l’emblème de la ville.
Nous logeons dans un superbe hôtel au-dessus de la vieille ville. L’Eden hôtel, établissement très moderne tout juste ouvert. A notre arrivée un homme et les cinq femmes entièrement voilées, qui l’accompagnent, sont assis dans le petit salon d'entrée. En nous voyant toutes réajustent bien vite leur voile afin qu'aucune parcelle de leur peau ne soit visible. De toute évidence dans ce pays qu'est la Bosnie un islam rigoriste, (est-ce le bon terme ?) s'est installé. Cette situation est-elle le résultat des promesses non tenues de l'ONU, qui a laissé massacrer 7000 musulmans un peu plus au sud à Srebrenica, alors qu'elle avait promis de sécuriser la zone?
La réceptionniste de l'hôtel de confession musulmane m'affirme que ce rigorisme est le fait d'étrangers et non de Bosniaques, ce comportement n’étant pas dans leur tradition.
La vieille ville est un lieu touristique très fréquenté. Le vieux pont (reconstruit après la guerre) est littéralement pris d'assaut. Les traditionnels adolescents sautant dans l'eau du haut de cette arche sont présents et font le spectacle.
Visiter la grande église catholique qui manifestement vient d’être reconstruite ne laisse pas indifférent. A l’entrée sont affichées les photos de plus de 60 moines exterminés par le régime communiste qui a sévi après la deuxième guerre mondiale. Ces visages affichent volonté et sérénité. De toute évidence ils étaient animés par la foi et l’espérance.
Cette ville a été très éprouvée par la guerre de désagrégation de la Yougoslavie. Les destructions ont été immenses, mais les répartitions ont effacé ce terrible passé récent. Cependant, toutes les haines et les animosités ont-elles disparu ? J’aurais tendance à dire malheureusement non. Dans un bistrot on nous propose de payer soit en euros ou en kunas croates, en refusant la monnaie locale, le mark bosniaque, étrange ! Il semble exister encore des frontières, que nous Occidentaux avons du mal à percevoir.
La rue principale ressemble à toutes les rues des villes du monde, où le tourisme de masse sévit avec ses multitudes d’échoppes qui proposent les mêmes types de souvenirs confectionnés en Chine ou dans un autre pays asiatique.
MONTENEGRO
Kotor
Les fameuses gorges de Kotor. Nous y accédons par une route qui plonge d’un coup de mille mètres en arrivant de Bosnie. La ville, première impression : la circulation difficile. Est-ce dû aux pluies fortes qui s’abattent ? Il faut reconnaître que cette année le temps n’est pas très clément dans cette région des Balkans. Nous avons quelques difficultés à trouver un point de chute pour notre véhicule afin de rejoindre notre hôtel dénommé Monte-Cristo, situé en plein centre de la vieille ville. Cette dernière on n’en soupçonne pas l’existence, tant que l’on n’a pas franchi le mur de protection qui la cache à la vue. En effet, cette enceinte, vue de l’extérieur, semble collée à la grande paroi calcaire qui domine le lieu. On imagine mal comment une ville pourrait se blottir dans l’espace. Mais ce n’est qu’une illusion due sans doute à une perspective trompeuse. Cette vieille cité à la pierre patinée pleine d’élégance surprend par son ampleur dès que l’on est passé sous le porche d’entrée.
Notre hôtel, très bien situé, occupe un très vieux bâtiment et de ce fait il offre des chambres qui ne sont pas aux standards modernes. Néanmoins, je le trouve plein de charme malgré le bruit et le peu de lumière. Rien ne me donne plus le cafard que ces grands hôtels aux multiples étoiles qui présentent exactement les mêmes standards et les mêmes prestations que vous soyez n’importe où sur la planète.
Il est impératif de visiter la forteresse qui s’élève tout en hauteur dans la falaise surplombant la ville. Je crois me souvenir qu’il y a 1340 marches à gravir. Mais l’effort en vaut vraiment la peine. La ville de forme triangulaire se dévoile rapidement au fur et à mesure de l’ascension. De plus la vue sur ce fjord incroyable que constituent les gorges de Kotor est superbe, pour ne pas dire époustouflante.
Cetinje
Ville au charme désuet d’une ancienne capitale perchée à mille mètres d’altitude. La route pour y arriver, la route serpentine est tout simplement magnifique. Une longue suite d’épingles à cheveux qui escalade un pan de montagne vertical sur un kilomètre de dénivelé. Et après chaque virage la vue sur les gorges de Kotor devient toujours plus stupéfiante. Les passagères ont eu des angoisses et elles étaient prêtes à la rébellion si la voiture s’approchait trop du bord, ou pire si le chauffeur regardait la mer tout là-bas en-dessous au lieu de la route.
La ville rappelle un temps passé où les ambassades étaient actives. La balade à pied à travers cette cité tranquille, qui recèle de magnifiques monuments, est très agréable. Il y règne une quiétude qui rappelle l’idée que l’on se fait des villes coloniales où l’ennui représentait la principale activité.
Virpazar
Bourgade au bord du magnifique lac de Shkoder à cheval sur le Monténégro et l’Albanie. Notre hôtel, à notre avis trop vanté par notre guide ne mérite pas de tels éloges. Par contre la promenade en bateau sur le lac est un enchantement.
Nous allons vivre un épisode troublant. Je ne suis pas particulièrement parano, même si je me suis fait voler beaucoup de choses dans ma vie, mais ce jour j’ai entendu mon ange gardien qui m’a dit de me sauver. Au matin nous quittons Virpazar avec le désir de suivre le lac par la minuscule route qui le longe par sa rive sud. L’itinéraire est magnifique, mais les croisements problématiques. Après une dizaine de kilomètres nous nous arrêtons pour faire le point sur un petit espace. Une voiture jaune, genre break, nous dépasse et s’arrête une centaine de mètres plus loin. Nous avons à peine l’espace pour la doubler. Elle redémarre et nous suit. Une quinzaine de kilomètres plus loin, elle nous talonne toujours. Dans la voiture je ne suis pas le seul à l’avoir remarquée. A la sortie d’un virage serré un petit carrefour avec un espace permettant de s’arrêter. Nous descendons faire des photos sur un panorama extraordinaire, le lac une centaine de mètres plus bas apparaît dans toute son immensité. Le chauffeur de la voiture jaune a sans doute été surpris de notre arrêt inopiné, et s’immobilise cette fois derrière. Lui et son passager descendent en nous regardant ostensiblement et sortent un sac plastique duquel ils prennent un casse-croûte, qu’ils attaquent en restant accoudés à leur voiture. Là, çà commence à m’intriguer sérieusement. Je monte, reprends le volant, fais demi-tour et ils nous regardent nous éloigner en sens inverse. Avaient-ils prévenus des comparses qui quelques kilomètres plus loin auraient sans difficulté bloquer la route, et là pris en sandwich nous aurions été à leur merci ? Le Koléos les intéressait-il ? Les grosses voitures que l’on croise sont-elles toutes achetées ? Nous ne saurons jamais ce qu’ils nous voulaient, mais j’ai ressenti un profond malaise le temps qu’a duré cette petite aventure. Je me souviens m’être fait dépouiller de mes affaires au Pérou par un individu qui s’était quasiment fait accepter dans notre environnement comme non hostile.
ALBANIE
Shkoder
Nous voilà en Albanie. Première surprise, plus besoin de visa on ne paie plus rien. Je ne suis pas loin de penser que l’Albanie considère qu’elle appartient à l’Union Européenne. D’ailleurs si la monnaie locale est le lek, partout l’euro est accepté et il est presque inutile de faire du change. J’ai même constaté que lorsque vous payez en carte bleue, bien souvent c’est directement en euros. Au restaurant la note vous est présentée en leks, en euros et en dollars, à vous de choisir ! D’autre part, d’une façon générale les routes n’ont plus rien à voir avec celles que j’ai connues il y 15 ans. Les grands axes que nous avons empruntés sont de bonne qualité sur l’ensemble du territoire. Sur les petites routes on trouve encore des portions où alternent bitume et terre. Mais de toute évidence, l’Albanie est un pays qui s’adapte à grande vitesse.
La ville de Shkoder au bord de son immense lac, ne ressemble plus du tout à l’image que j’en avais gardée. Je me souvenais d’une ville, où le goudron avait disparu des rues et où les immenses mares d’eau étaient si nombreuses que l’on aurait dit des rivières ou des marécages et non des rues. Tout cela est bien fini, tout est propre, de nombreux bâtiments modernes ont remplacé les vieux bâtiments de l’ère communiste.
Notre hôtel est absolument superbe. Il porte bien son nom « Tradita ». C’est une ancienne demeure albanaise, magnifiquement rénovée, au charme certain. Il est nécessaire de demander une chambre non borgne et là c’est le rêve. Pour un prix modique vous plongez dans la tradition albanaise. Le personnel est particulièrement attentif. On le sent pressé de bien faire, c’est émouvant et un peu rigolo. Dès que je suis dans ce pays j’ai vraiment le sentiment d’être dans ma deuxième patrie. Mon épouse qui appréhendait un peu est immédiatement conquise par tant de gentillesse. Le patron parle couramment le français et vient de temps à autre discuter de choses et d’autres. On sent que le monde il l’a beaucoup arpenté.
intérieur de notre hôtel
Le centre ville est piéton, et fini les embouteillages dont je me souviens, faits de vieilles Mercédès fumant plus noir les unes que les autres. D’ailleurs le parc automobile est rénové, toujours beaucoup de Mercédès, mais pour la plupart de dernière génération.
Shkoder c’est la ville du célèbre photographe albanais Pjeter Marubi (1834-1904).Ses photos de monuments ou de personnes en noir et blanc sont remarquables.
photo de Marubi
Nous allons visiter son château sur une colline qui domine la cité, d’où la vue, en particulier sur le lac, est de tout premier plan. En trois ans j’y étais venu de nombreuses fois entre 1999 et 2002. Jamais ou presque je n’y avais rencontré âme qui vive. Ce matin le flot de touristes est impressionnant, qu’ils soient albanais ou étrangers. De nombreux bus se lancent dans des manœuvres laborieuses dans des espaces restreints. Je reconnais l’un des caractères albanais dont je me souvenais. Mais la dextérité des chauffeurs fait que tout se déroule sans incident, même si nous sommes restés prisonniers quelque temps dans notre voiture entre ces gros engins.
Vue du château
Kruja
Bastion de la résistance albanaise à l’empire ottoman, la ville héberge un musée historique qui ne représente pas le même intérêt que celui de Tirana. Ce dernier étant plus particulièrement axé sur la période récente de l’ère de la dictature d’Enver Hodja. La ville vaut cependant le détour. Son bazar tout en longueur le long d’une jolie rue vaut le coup d’œil. En particulier les amateurs de vieux livres pourront y trouver des ouvrages intéressants sur l’ère de la dictature, aussi bien pour les textes que pour les images. Certains sont écrits en français. Je viens d’en acheter deux, dont l’un de Hodja qui raconte ses différentes entrevues avec Staline.
Un poème de Vehbi Bala montre cet esprit de résistance du peuple albanais:
L’Héroïne
Kelmendi, assiégé, était dans la misère :
Enfants, vieillards y mouraient par milliers.
L’Assemblée siégeait dans les montagnes altières
Qui dressent au ciel leurs versants escarpés.
Nora la Belle sort d’une chaumière,
Traverse le siège d’un pas accéléré.
-Me voilà Vuça Pacha, je suis ta prisonnière,
Mes compatriotes se meurent affamés ! »
-Sois la bienvenue ma belle Albanaise-
S’écria Vuça Pacha dévorant
Cette fraîche beauté de ses yeux de braise.
Et les monts retentirent tout tremblants
Lorsque Nora se lança de fureur
Et lui planta la dague dans le cœur.
J’ai tiré ce poème aux rimes approximatives en français, de la revue littéraire albanaise « Les lettres Albanaises » numéro 4, 1984, qui était publiée sous la dictature. Attention à tout texte qui pouvait paraître non conforme aux canons de la pensée ! L’auteur s’exposait immédiatement aux différents châtiments en vigueur, entre relégation, emprisonnement, camp de concentration voire exécution.
Tirana
C’est avec émotion que je retrouve cette ville où j’ai habité trois ans. J’ai l’impression que j’ai rêvé cette époque maintenant lointaine, et qu’il s’agit d’une vie précédente. L’entrée de l’agglomération a complètement changé. En effet, une multitude de grands buildings a été construite et la ville s’est considérablement étendue. Nous descendons dans un hôtel superbe, tout neuf, le LAS. Il est tenu par un couple aidé de leurs deux enfants, un garçon et une fille d’environ 18 ans. Accueil de tout premier plan.
Nous laissons notre voiture et partons nous promener au centre ville. La rue principale le boulevard Dëshmorët e Kombit a gardé son aspect d’il y a 15 ans avec tous ses ministères, même si certaines affectations ont changé. Par contre les autres rues sont méconnaissables. Elles sont bien goudronnées, les magasins sont nombreux et diversifiés et très bien achalandés. Il y a de la lumière, et la nuit tout est bien éclairé, alors que quinze ans auparavant, la seule lumière que l’on voyait dans l’obscurité provenait des poubelles qui brûlaient. Nous sommes aujourd’hui dans une ville moderne, où dès que la nuit tombe la fête semble démarrer partout, sur les terrasses de café et dans les restaurants. La musique est toujours présente, qu’il s’agisse de sonorités anglo-saxonnes ou de chants plus langoureux balkaniques.
centre ville Tirana
musée historique national
Berat
La ville aux mille fenêtres, ancienne cité ottomane qui garde un charme fou. Notre hôtel un peu avant la vieille ville est tout récent, ouvert seulement depuis trois mois. Il s’agit de véritables suites et non de chambres, dans un ancien combinat extrêmement bien réaménagé. Et une telle prestation pour 40 euros. Ça ne vaut pas le coup de s’en priver. Quant aux prix des repas de très bonne qualité comme partout en Albanie dans les hôtels il est dérisoire. Pour dix euros maximum, souvent cinq, vous faites un véritable festin avec un vin de très bonne qualité.
Nous sommes arrivés vers midi en provenance de Tirana. Nous avons tout l’après-midi pour visiter la vieille ville et la magnifique citadelle qui la domine. De cette dernière, lorsque le temps est clair la vue porte sur la montagne du Tomor qui culmine à plus de 2400 mètres d’altitude. Si on dispose du temps nécessaire il est très intéressant de s’engager vers ce massif montagneux qui conduit dans l’Albanie profonde. Mais cette fois-ci ce ne sera pas le cas pour nous. Ne disposant que de 20 jours pour un tour des Balkans, j’ai déjà du faire preuve de persuasion pour que nous restions une semaine dans ce merveilleux pays, l’Albanie.
Dans la citadelle il faut absolument visiter le musée des icônes. Elles sont remarquables vieilles de plusieurs siècles et très bien conservées. On doit à la présence d’esprit et l’initiative de la mairesse de la ville au cours de l’explosion du pays en 1997 d’avoir conservé ce patrimoine exceptionnel. Voyant venir le chaos, elle a caché chez elle tous ces trésors et les a restitués lorsque les pillages prirent fin et l’ordre rétabli. Sans cette remarquable volonté, toutes ces œuvres de premier plan seraient dispersées chez des collectionneurs sans morale de par le monde. Dans l’enceinte du musée il y a une ancienne église orthodoxe avec une iconostase absolument magnifique, la plus émouvante que je connaisse. Il faut, au sommet de la citadelle, aller voir les gigantesques réservoirs d’eau enterrés qui permettaient une grande autonomie en cas de problème ou de siège.
musée des icônes
Himara
Station balnéaire, qui elle aussi a beaucoup changé en quinze ans. La route qui va de Vlora à Saranda en passant par le col de Llogara et Himara n’a plus rien à voir avec la piste étroite d’antan. Ce coin du sud de l’Albanie est l’un des endroits les plus beaux que je connaisse. Hélas trop peu de temps pour faire découvrir à mes compagnons les trésors cachés dans la montagne, comme les vieux villages de Qeparo ou Himara le vieux.
Notre hôtel apparaît très moyen aux standards de ma famille, mais cependant il permet une vue extraordinaire sur la mer et permet d’assister à un coucher de soleil de toute beauté.
Malheureusement le mauvais temps qui nous a accompagné une bonne partie de notre périple ne nous a pas permis de jouir de l’extraordinaire panorama de la route de la riviera albanaise de Vlora à Himara.
Saranda
Bref arrêt le temps de prendre un café et d’admirer la mer Egée avec en toile de fond l’île de Corfou. Oui je sais, venir jusqu’ici et ne pas prendre le temps d’aller visiter le magnifique site de Butrint, mais voilà une semaine pour un pays c’est décidément bien trop court. En repartant nous passons par la curiosité géologique : l’œil bleu. Il s’agit d’une résurgence à fort débit dont l’eau présente une teinte admirable.
Gjirokastra
Avec Berat ce sont les deux villes les plus typiques d’Albanie. Surnommée la ville de pierre du fait de ses toits en lauses épaisses. De cette cité sont originaires deux célébrités albanaises. Tout d’abord le dictateur Enver Hodja et puis, plus réjouissant, le célèbre écrivain Ismaël Kadaré. Si vous ne deviez lire qu’un seul de ses livres, je vous conseille «Avril brisé ». Il y décrit la vie des gens du nord de l’Albanie sous le joug de la loi du kanun, la vengeance par le sang. Cette coutume est malheureusement toujours d’actualité.
Notre hôtel qui porte le nom de la ville se trouve juste sous le château. Pour l’atteindre il nous faut monter par des rues d’une extrême raideur, à se demander si l’adhérence des pneus sur ces pavés polis sera suffisante. La chambre très vaste que nous occupons est de toute beauté, bien dans la tradition albanaise. L’hôtel est une entreprise familiale dont le restaurant est aussi très correct. Nous nous rendons au château qui coiffe la colline, le long de laquelle s’étagent les maisons de la cité. La vue y est de tout premier plan sur les toits et les façades si caractéristiques de ce coin d’Albanie.
notre chambre vue de l'extérieur
notre chambre de l'intérieue
La visite du musée installé dans la forteresse est très instructive. On y découvre nombre d’œuvres, sculptures et peintures, à la gloire de la puissance et à l’héroïsme des combattants albanais. J’aime beaucoup l’art inspiré du réalisme socialiste, né en Union Soviétique. L’ère de la dictature albanaise s’en est beaucoup inspirée, et ce musée recèle nombre de pépites en la matière.
Permet
Ville située sur la route entre Gjirokaster et Gorça. Cette route je ne la connaissais pas. Elle est tout à fait incroyable. Elle passe dans l’une des régions les plus désertes du pays. Elle est particulièrement tortueuse et il nous faudra au moins 6 heures pour effectuer une distance de 200 kilomètres, alors que le trafic est quasiment nul. Nous ferons une halte dans la petite ville de Permet. Elle est paisible et semble vivre à un rythme lent, très loin de la frénésie de Tirana. Aujourd’hui c’est jour de fête annuelle. Sur la place différents stands, dont l’un animé par les nostalgiques de l’ère de la dictature. Ils arborent des photos d’Enver Hodja. On voit bien aussi en Russie des nostalgiques de l’époque de puissance de l’URSS, qui s’affichent avec des effigies de Staline.
statue à la gloire du combattant albanais
nostalgiques de l'époque communiste
Gorça
Ville que l’on surnomme le « Petit Paris ». Après la première guerre mondiale elle a été sous administration française et on y trouvait encore à l’époque où j’habitais le pays, des personnes d’un certain âge qui parlaient notre langue sans le moindre accent. Hélas en 15 ans beaucoup ont dû mourir du fait de leur grand âge.
La ville a beaucoup changé. De grands bâtiments ont poussé de toutes parts. La partie ancienne constituée de jolies maisons du début du vingtième siècle d’inspiration sans doute italienne est à l’abandon. Manifestement l’argent pour rénover ce beau patrimoine fait défaut et tout est dans un état de décrépitude déplorable.
Notre hôtel présente une très belle façade récente. Mais l’arrière est de toute autre nature. La fenêtre de notre chambre donne sur une terrasse où s’entremêlent dans un fouillis indescriptible une multitude de fils électriques.
Au centre de la ville une imposante église orthodoxe de facture récente est implantée. Nous assistons à un mariage. La mariée a toutes les peines du monde à se déplacer dans sa robe, qui semble plus tenir du carcan que de la robe de mariée.
A Gorça se trouve un cimetière militaire français où reposent 640 de nos concitoyens morts durant la première guerre mondiale dans des combats contre les forces de l’Axe, en particulier les Bulgares. Il m’est arrivé à trois reprises de présider au 11 novembre des cérémonies militaires dans ce coin reculé, situé pas très loin des frontières grecque et macédonienne. J’en garde un souvenir ému. La dernière année j’avais invité les différents attachés de défense étrangers, dont l’allemand et le bulgare.
Pogradec
Cette ville est au bord du lac d’Ohrid. Elle constitue notre dernière étape avant de passer la frontière en direction de la Macédoine. Ce lac de très grandes dimensions héberge un poisson que l’on trouve ici et dans le lac Baïkal et nulle part ailleurs. En albanais on l’appelle le Koran, il s’agit d’une grosse truite saumonée vivant en profondeur.
Dans cette cité habite un artiste que j’aime beaucoup le peintre Taso. D’ailleurs la peinture sous mon pseudo VF est de lui.
Les derniers kilomètres nous conduisent à la frontière et un peu triste je quitte ce pays après une trop courte visite. Nous rentrons en Macédoine et le douanier macédonien est citoyen macédonien certes, mais aussi albanais. Il s’étonne que je parle sa langue l’albanais. Les Balkans c’est une mosaïque de peuples qui s’entremêlent par delà les frontières.
MACEDOINE
Ohrid
Jolie station balnéaire à la réputation internationale, nous y descendons dans un hôtel en plein centre qui donne sur le lac. L’endroit est charmant. Le tourisme y est particulièrement actif. Nous y passons un moment très agréable à déguster les différents poissons du lac et à goûter les vins blancs et rouge de bonne tenue. Il est à noter que le fameux Koran, il faut rester en Albanie pour le manger, car sa pêche est interdite en Macédoine, étant considéré comme une espèce protégée.
Bitola
Nous faisons un détour par cette ville. Nous voulons voir le cimetière militaire français qui contient les corps de 17 000 soldats morts dans des combats contre les Bulgares. Nous ne le trouvons pas et mettons le cap sur Skopje la capitale de Macédoine, après avoir bu un café au centre ville. Cette ville dégage tristesse et pauvreté.
Skopje
Cette ville est étonnante, sa partie slave et sa partie albanaise sont très différentes. Le Vardar, fleuve qui traverse la cité est bordé d’immenses bâtiments bien entretenus. On est frappé en premier lieu par le nombre incroyable de statues de bronze qui constellent les ponts et les places. On y croise des personnages de légendes comme Alexandre le conquérant ou des hommes politiques récents.
La partie albanaise au contraire d’une ville de grands bâtiments, nous ramène en Albanie avec ses rues pavées, son architecture balkanique et ses mosquées. La religion a l’air plus suivie ici qu’en Albanie, où les mosquées même si elles sont nombreuses restent généralement désertes.
SERBIE
Belgrade
Immense ville qui s’étale sur de grandes distances. Nous logeons en plein centre à proximité immédiate de la Présidence de la République dans un hôtel assez étrange au charme désuet des grandes demeures du début du XXème siècle. Au détour des rues, parfois on voit encore par endroits les traces du bombardement effectué durant, me semble-t-il trois longs mois par les aviations de pays de l’OTAN, dont la France fut le deuxième contributeur après les USA. La ville se trouve au confluent de la Save et du Danube.
La longue rue qui conduit à la colline où se trouve l’ancienne forteresse est piétonne. Il est particulièrement agréable de s’y promener. J’ai recherché dans les nombreuses librairies des ouvrages sur la guerre récente, écrits par des Serbes et traduits en anglais. En effet, jusqu’à présent je n’ai jamais lu de textes venant de cette partie. Il est toujours instructif d’avoir la vérité de chacun.
La visite de la forteresse est aussi très intéressante. En particulier, on peut y admirer le confluent de deux puissants cours d’eau la Save et le Danube. De la même manière à Mendoza j’avais cherché un livre sur la guerre de Malouines écrit par un Argentin, car les nombreux livres que j’avais lus à ce sujet étaient tous d’auteurs britanniques. Là encore on découvre des perceptions différentes d’un même évènement.
Il nous reste trois jours et 1500 kilomètres avant de rentrer à Lyon. Notre voyage touche à sa fin. En trois étapes, exclusivement ou presque par autoroute, nous allons regagner les bords du Rhône.
CROATIE
Rijeka
Ville qui a été disputée au cours du temps entre la Croatie et l’Italie. Actuellement elle est le principal port de Croatie. Un centre ville piéton où nous faisons une balade nocturne avant d’aller faire un repas de poissons.
ITALIE
Sirmione
Adorable petite cité sur le bord du lac de Garde, nichée tout au bout d’une presqu’île effilée. Nous descendons dans un hôtel au charme désuet et aux peintures un peu fanées. Mais sa situation est de tout premier plan. Son site archéologique, une immense villa romaine qui est située au point ultime de la presqu’île et son château qui en garde l’accès sont deux sites remarquables de ce très joli coin d’Italie. Comme dernière étape ce fut un enchantement. Je recommande très vivement la visite de ce lieu pittoresque, même si nous étions de véritables hordes de touristes à l’assaut de cet endroit ravissant.
13:43 Publié dans expérience vécue, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albanie, macédoine, bosnie, monténégro, serbie
06/02/2014
Notre traversée du Sud Lipez
Notre traversée du Sud Lipez à vélo
Préparer un voyage à travers les déserts de l’Amérique du Sud, pourquoi ? Le Dakar à la télé, entre les camions, les motos et les voitures à fond à travers le désert de l’Atacama, un arrêt sur image, le journaliste focalise sur un cycliste lourdement chargé, qui avance à son rythme à travers ce désert hostile. Pour les coureurs mécanisés trois heures pour monter un col, pour lui, ils réalisent qu’il lui faudra trois jours. Les exigences de base de notre condition humaine se posent de façon immédiate à lui, l’eau, les aliments ainsi que l’absence d’assistance technique. Quels seront les souvenirs les plus forts et durables que chacun gardera de ce désert le plus vaste et le plus aride du monde ? Ces coureurs privilégiés qui ont besoin de vastes sommes d’argent pour assouvir une passion certes exigeante et exaltante mais pas à la portée de tous, ou alors ce cycliste seul parti avec pas grand-chose, dont l’engagement financier principal aura été le prix du billet d’avion le conduisant d’Espagne en Amérique ? Chacun est libre d’apporter sa propre réponse. En ce qui me concerne, je n’hésite pas et je penche pour le cycliste. Cela dit, je trouve les images de course automobile dans ces coins reculés absolument magnifiques et les capacités techniques des ingénieurs prodigieuses. Mais au-delà de ces considérations mécaniques, ma philosophie de la vie me conduit inexorablement à choisir la lenteur et l’engagement physique en autonomie, ce qui rend toute sa grandeur et son immensité à notre planète. Tout l’argent du monde ne permettra jamais d’apporter le bonheur procuré par cette confrontation aux éléments les plus hostiles de notre planète, armé seulement de sa passion et de sa force physique et morale.
Ces remarques me semblent primordiales pour comprendre pourquoi on s’engage dans des trajets longs et aléatoires dans les régions les plus hostiles de la planète. La journée il y fait chaud et la nuit il y fait fréquemment moins dix, voire moins. Les destinations de tourisme de masse ne sont pas recherchées, mais au contraire une envie d’apprendre à se connaître face à la nature de notre planète, dans les régions où elle se montre la plus rude et particulièrement inhospitalière. C’est quoi être écologiste ? Vouloir remplacer l’énergie nucléaire par une autre source de production électrique pour assouvir son envie de confort, ou cette aspiration à vivre (momentanément) dans une forme de dénuement face aux rigueurs de notre planète ? Chacun sa définition. Mais j’en conviens l’avion que l’on utilise pour s’y rendre n’est pas très écologique !
Voilà mon état d’esprit lorsque je fais défiler les cartes d’Amérique du Sud sur l’écran de mon ordinateur dans la préparation de mon prochain périple, tout en écoutant des voies splendides de chanteuses canadiennes. Toujours derrière mon bureau, je ressens déjà la sensation de la fatigue dans les jambes, la poussière dans le nez soulevée par un vent brutal et rageur qui règne en maître dans ces régions de dix heures du matin jusqu’à la tombée de la nuit, l’attaque des rayons solaires de longues heures durant à plus de quatre mille mètres d’altitude, exposé aux ultra-violets.
Mon envie ne fait que se renforcer à ces pensées, je sais que je vais partir, malgré l’incompréhension de mes proches, qui se sentent abandonnés ne pouvant imaginer toute la puissance de l’envie de vivre qui m’anime et me submerge. Oui les risques, il y en a certainement, la mort par manque d’eau perdu dans la fournaise de sable, l’accident de la route, un vélo c’est vulnérable, une vie est aussi fragile qu’une coquille d’œuf qui se brise, rependant son contenu. La différence, l’œuf ne réfléchit pas, l’homme conscient de sa faiblesse reste aux aguets et avec un peu d’intuition, d’anticipation, de réflexion et d’humilité, de chance, voire de crainte et de peur peut triompher de sa vulnérabilité.
Pour tout amateur du voyage à vélo la traversée du Sud Lipez, désert de 400 kilomètres au cœur de l’Atacama, représente la consécration. Tous les récits de ceux qui se sont lancés dans l’aventure mettent en exergue une expérience hors du commun nécessitant un profond engagement physique et moral. Il faut y ajouter une patience à toute épreuve, du fait des longs passages trop raides ou trop instables obligeant à pousser le vélo dans le sable ou la cendre volcanique. Les conditions météorologiques participent aussi à la réputation de cet itinéraire, qui se situe entre 4000 et 5000 mètres d’altitude. Vent violent, chaleur la journée et grand froid la nuit sont des constantes de ce coin de désert particulièrement aride, le plus sec du monde. Se pose aussi la question du ravitaillement, tout spécialement en eau.
Avant de se lancer dans cette traversée qui dure au minimum une dizaine de jours, toutes ces questions viennent à l’esprit. Bien évidemment le doute naît. Sera-t-on à la hauteur de l’épreuve ? Avons-nous sérieusement préparé l’itinéraire et anticipé les embûches qui nous attendent ? Les provisions seront-elles suffisantes ? Le matériel de bivouac est-il assez performant pour protéger des grands froids ? La tente sera-t-elle assez résistante contre le vent violent ?
Mais voilà, justement ce sont toutes ces questions et ces incertitudes qui font surgir l’envie irrépressible de se confronter à cette immensité désertique. Cela explique pourquoi nous nous retrouvons Flora et moi, après un périple depuis Arica, sur l’île d’Incahuasi au milieu du salar d’Uyuni le plus vaste du monde, prêts à nous lancer dans l’aventure, qui va durer dix jours. En ce lieu extraordinaire où je situe le départ de cette traversée mythique, nous passons une nuit étonnante avec deux cyclistes, qui se trouvent aussi là par le hasard de la route. Le premier, Javier l’Espagnol qui vient justement de vivre cette expérience du Sud Lipez et qui en parle avec des trémolos d’effroi dans la voix. Le second, Hugues, l’Anglais passera d’abord par la ville d’Uyuni avant de tenter l’aventure.
1er jour Île d’Incahuasi à Colcha K 60 km
Au matin, nous nous séparons de nos nouveaux amis, bien conscients d’avoir vécu un grand moment de communication entre amoureux de sensations fortes à vélo. Pour nous l’aventure commence par 50 kilomètres à rouler dans l’un des cadres les plus insolites de la planète, la partie sud du salar d’Uyuni. On reste stupéfait au milieu de cette grande étendue blanche entourée de hautes montagnes. Le silence est seulement perturbé par le crissement de nos pneus sur le sel. La vue porte à plus de cent kilomètres. Nous avançons facilement, donc assez rapidement. Presque à regret nous voyons le point de sortie approcher. Nous savourons d’autant plus notre plaisir, que nous savons qu’il s’agit de la partie la plus facile de notre itinéraire. Comment retranscrire ce que nous éprouvons en écoutant nos pneus bruire sur le sel dans cet air immobile du matin, alors que dans quelques heures le vent sera déchaîné, et alors toute quiétude aura déserté ce lieu. C’est tout le corps qui entre en harmonie avec les vibrations des roues en mouvement. La surface est changeante, elle peut être très lisse, plus rugueuse, parsemée de petites aspérités pointues ou faite d’immenses hexagones jusqu’à perte de vue. Cette surface figée s’apparente à la surface d’une mer qui elle aussi au gré des conditions météorologiques prend toutes sortes d’aspects. Nous restons très attentifs, afin de graver au plus profond de notre mémoire toutes ces émotions et sensations qui montent en nous, car la féerie du salar s’interrompt dès qu’on en aborde les confins.
La piste de sortie se dessine, tout d’abord comme un fin trait noir dans le lointain. Au fur et à mesure que nous nous en rapprochons ses vraies dimensions se révèlent. Il s’agit d’une large piste surélevée, qui s’étire sur trois kilomètres. En effet, les abords du salar sont mouvants entre sel et sable, qui se disputent la suprématie. Vouloir sortir hors de la piste aménagée contraindrait à des efforts surhumains à pousser son vélo dans des zones inconsistantes. Il est donc bien préférable d’utiliser ce chemin d’accès. Dès que nous l’abordons, nous retrouvons la consistance habituelle des routes de ces coins perdus de Bolivie. Afin de minimiser ses efforts, il est impératif d’avoir l’intuition du passage le moins mauvais à prendre entre sable, tôle ondulée et cailloux. On n’y parvient pas toujours malgré les déplacements de droite et gauche permanents, et l’on se retrouve à forcer comme une bête sur les pédales, cherchant à se dégager d’un banc de sable, ou alors on se retrouve piégé à être secoué fortement sur une succession de vaguelettes, qui se révèlent une véritable entrave à la progression. Parfois il nous faut même pousser nos montures. Mais malgré tout nous avançons. Nous rejoignons le village de Colcha K. Peu avant ce hameau nous doublons un couple de Suisses à vélo, mais de plus ils traînent leurs deux enfants de trois et cinq ans, le plus petit dans une carriole et la plus grande sur un petit vélo accroché derrière celui de sa mère. Tout à fait incroyable, ils sont en train de traverser l’Amérique du sud et comptent aller jusqu’à la Terre de Feu. Le village dans lequel nous entrons est tout en longueur, épousant la forme de la gorge qui l’abrite. Cette première tape a été assez facile en comparaison de ce qui nous attend, bien que nous ayons fait quelques tours et détours en limite de salar à la recherche de la piste la plus praticable.
Il est quatorze heures et la chaleur devient pesante. Nous sommes heureux de trouver un logement. Cela nous évite de monter la tente dans la touffeur, le vent et la poussière. Ce village calme nous apparaît comme un havre de paix dans l’enfer de sécheresse et de chaleur de l’Atacama. Nous réalisons clairement que nous sommes à la veille d’un combat d’au moins une semaine pour tracer notre voie à travers ces immensités de sable de lave et de lagunes entourées de hauts volcans. Le moral est bon, Flora a un mental d’acier. C’est probablement son métier de professeur de sport et d’entraîneuse d’une équipe de handball qui permet cela. Je suis bien content de cela, car c’est un atout prépondérant lorsqu’on se lance dans un défi difficile d’être bien accompagné, par quelqu’un qui ne se pose pas de questions et qui fonce, et avec d’autant plus d’obstination que la difficulté est grande.
Nous montons sur les hauteurs du village. Les immensités du salar d’Uyuni et du Sud Lipez nous saisissent par leur beauté, leur étrangeté et aussi par leur hostilité dans cette ambiance de vent et de poussière, pays rude aux contrastes forts dans des espaces vastes difficilement évaluables. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que ce désert sans fin nous sommes venus pour le traverser à la force des mollets. Nos certitudes sont un peu ébranlées devant ce spectacle sauvage. Mais pourquoi douter, cette première étape s’est remarquablement bien passée, alors pourquoi pas le reste ? On se pose cependant la question de la solidité de notre constance devant l’adversité à venir. Laissant là nos doutes nous retournons sur la place d’armes du village dans un petit restaurant qui nous sert un superbe poulet accompagné d’une bonne ration de riz. Rien de tel que le ventre bien plein pour arrêter de gamberger. Sur la table d’à côté, alors que nous sommes en train de savourer notre plat, plusieurs personnes arrivent avec une grande carcasse de lama et se mettent à la découper à l’aide de grands couteaux. Nos mines étonnées les font franchement rigoler et c’est avec bonne humeur qu’ils se prêtent au jeu des photos. Mais ce n’est pas particulièrement appétissant pour nous, petits Occidentaux aux habitudes policées !
2ème jour Colcha K à Avaroa 90 km
Dès six heures du matin nous quittons Colcha K, après nous être préparé notre petit déjeuner dans notre chambre. L’air est calme, le froid intense, mais l’absence d’humidité le rend presque agréable. Il est très important de partir le plus tôt possible, dès le lever du jour, d’une part à cause de la chaleur qui devient intense dès treize heures et d’autre part à cause du vent qui dans l’après-midi forcit. Ces départs matinaux dans la fraîcheur et l’air immobile constituent un vrai plaisir et l’âme du voyage à vélo s’y niche en partie. Les muscles bien reposés se mettent en action, et avancer sur une piste défoncée semble presque facile. Nous rentrons vraiment dans l’esprit du défi au Sud Lipez. De nombreux facteurs renforcent notre motivation et exacerbent notre désir de nous confronter à la piste les jours à venir. Pour ne citer que les principaux, je dirais, la curiosité face à ce spectacle unique, l’envie d’aller voir plus loin, tester nos limites, le goût de l’effort, relever le défi auquel on aspire et puis ce bien-être dans cet air immobile du matin que le soleil arrose durant quelques heures de rayons tempérés.
Ces immensités à perte de vue, sable, sel, rares touffes d’herbe en pointe nous rappellent l’ampleur du challenge. Dans le lointain, à une cinquantaine de kilomètres, un volcan, il s’agit sans doute de celui au pied duquel se trouve le poste militaire de Chiguana. Notre chemin passe par là. Éventuellement nous envisageons, selon les conditions de demander l’hospitalité en ce lieu. Nous verrons bien le moment venu. En effet, la piste est toujours pleine de surprises. On ne sait jamais si l’on va pousser ou rouler, si la moyenne sera de trois ou douze kilomètres à l’heure. Les bancs de sable apparaissent, ils peuvent disparaître rapidement ou au contraire nous obliger à de longues heures à côté de nos vélos, comme englués dans une matière collante.
La piste court le long d’un immense golfe du salar, en en suivant les contours. En effet, le salar d’Uyuni s’apparente exactement à une mer, seule différence il s’agit de sel et non d’eau. La qualité du sol n’est pas propice à nos roues. Il nous semble que si nous descendons directement sur le salar, nous devrions trouver une piste beaucoup plus favorable. Pour commencer, afin de le rejoindre il nous faut pousser sur un chemin de sable et même franchir des barbelés, sans doute un ancien enclos à lamas. Pourvu que nous ne soyons pas engagés dans une impasse et que nous devions revenir sur nos pas, après avoir dépensé beaucoup d’énergie et perdu des heures précieuses avant la chaleur, qui inexorablement monte. Nos espoirs sont exhaussés. Devant nous une zone plane, comme damée se dirige plein sud. Sur une dizaine de kilomètres nous progressons à bonne allure. Quelques kilomètres à l’ouest se trouve la piste beaucoup plus difficile sur laquelle nous voyons les volutes de poussière laissées par les rares véhicules qui circulent. Cet itinéraire se joue aussi sur des coups de chance. Pourquoi décider quelques kilomètres à droite ou à gauche ? La différence en temps et fatigue est conséquente. La trace que nous suivons se rapproche de la piste et la rejoint au point précis dont j’avais noté les coordonnées sur Google earth. Le GPS est vraiment un outil sécurisant dans ces immensités où tout se ressemble et se confond.
Le prochain village sur notre route se nomme San Juan de Rosario. Nous partons plein ouest par une piste constellée de trous et de bosses. Après une quinzaine de kilomètres nous rejoignons San Juan. D’après nos informations nous devrions y trouver du ravitaillement. Effectivement, quelques épiceries proposent divers produits. Nous choisissons la plus grande et y entrons comme dans la caverne d’Ali Baba. Qu’allons-nous acheter et en quelles quantités ? Combien de jours allons-nous mettre pour traverser jusqu’à San Pedro de Atacama ? Nous ne sommes pas en mesure d’apporter des réponses bien précises à nos différentes interrogations. Nous partons du principe que deux kilos de riz et deux kilos de pâtes devraient nous fournir une bonne base. On complète avec de nombreux petits pains ronds, quelques boîtes de thon et paquets de gâteaux. Nous n’oublions pas de nous charger chacun de sept litres d’eau. Ainsi nous voilà parés pour plonger dans la grande aventure.
Nous quittons le village, la route la plus importante n’est pas la nôtre. Une grande plaine, qui ressemble fort à un salar, se déroule devant nous en direction de l’ouest vers la frontière chilienne. Il nous faut y aller. Comme toujours les zones en limite de salar sont très sableuses et difficiles à vélo. Mais une fois sur le sel, le sol devient dur et la piste agréable. La progression se poursuit à un bon rythme. Notre moral est au beau, car pour le moment nous sommes en avance sur nos estimations. Mais n’oublions pas qu’il nous reste 300 kilomètres et de sacrés obstacles. Mais ne réfléchissons pas trop aux incertitudes futures. Contentons-nous de vivre notre route kilomètre par kilomètre et de nous attaquer aux difficultés immédiates quand elles se présentent.
Sur notre gauche en bordure sud du salar, la fameuse voie ferrée. Nous ne pouvons la voir du fait de la distance. Par contre nous discernons les immenses trains minéraliers qui traversent ces grands espaces. De baies en plaines nous venons buter sur la voie que nous traversons à proximité du poste militaire. Nous sommes satisfaits car nous avons depuis ce matin déjà effectué cinquante-six kilomètres, et il n’est que treize heures. La chaleur dans ce terrain de pierre devient intense et l’ombre est quasiment absente. Une vieille gare désaffectée et délabrée nous offre sa protection à quelques centaines de mètres du poste militaire. Que le lieu est étrange. On se croirait dans une mise en scène du livre de Dino Buzzati « le désert des Tartares ».
Nous nous installons à l’ombre de l’avant-toit et mettons en action notre réchaud à gaz afin de préparer une bonne platée de riz. Alors que notre repas mijote, des bruits de moteurs de motos nous font regarder dans la direction d’où ils proviennent. Effectivement cinq ou six motos de trial, suivies de deux véhicules 4X4 viennent vers nous. Ils s’arrêtent aussi à la gare pour y déjeuner. Des deux véhicules sort tout un attirail, table, chaises, glacières, nourriture et boisson à profusion. Ils s’installent à côté de nous à l’ombre. Il s’agit d’un groupe de motards de Saint-Étienne qui effectue un trajet en boucle de quinze jours depuis la Paz. Nous allons passer un moment agréable en leur compagnie, et surtout ils vont nous proposer quelques aliments de choix, en particulier un magnifique morceau de viande de bœuf. Flora décline l’offre, mais pour ma part je me rue et prends une large tranche que je déguste avec un immense plaisir.
Vers quatorze heures les motards se remettent en route et disparaissent rapidement dans le lointain. Le vent s’est levé et il nous est défavorable. La chaleur est forte, mais sans hésiter nous enfourchons nos vélos avec l’intention de rejoindre le poste frontière bolivien d’Avaroa distant de trente-trois kilomètres. Nous espérons seulement que la piste sera suffisamment roulante pour nous permettre d’y arriver avant la nuit. La première partie est effectivement facile, bien que le vent nous ralentisse et que parfois nous nous demandions si nous ne sommes pas en train de nous perdre dans l’un des recoins de cette immensité sans point de repère. Nous quittons le salar et sa piste aisée et tombons sur une route poussiéreuse de creux et de bosses, pleine de cailloux, avec pour nous aider un vent qui souffle en tempête et qui nous arrive en plein nez. Ces quinze kilomètres nous demandent trois heures d’efforts violents. Nous avons l’impression que jamais nous n’atteindrons notre but avant la nuit. De toute évidence le combat du Sud Lipez a bien commencé, et son hostilité légendaire nous apparaît dans toute sa réalité. Nous finissons par distinguer dans le lointain ce qui ressemble à des bâtiments. Très lentement ils grossissent et à la nuit quasiment tombée nous y sommes. Dans la tourmente de vent qui sévit nous nous imaginons difficilement monter la tente. Nous demandons l’hospitalité au douanier qui tient son poste. Il nous répond d’attendre. Une demi-heure plus tard il ferme la douane pour ce jour et il nous propose la salle d’attente comme chambre à coucher. Nous n’en demandons pas plus, et nous installons à même le sol, trop contents d’être à l’abri. Nos couchages installés nous mettons en œuvre notre réchaud. Nous sommes de vrais nababs !
3ème jour Avaroa à la Laguna Hedondia 60 km
Réveil cinq heures, il fait nuit. Nous préparons notre petit déjeuner dans notre poste de douane. Vers les six heures nous sommes prêts, cependant il nous faudrait plus d’eau pour la journée à venir. Nous demandons au douanier qui dort dans son bureau à côté. Comme hier il nous apporte un seau, ce qui nous permet de compléter notre stock d’eau. Nous sortons, et comme tous les matins l’air est immobile. Devant nous l’immensité minérale au-dessus de laquelle d’immenses volcans nous regardent de leurs six mille mètres. Tout est à une autre échelle qu’en Europe.
Nous partons par une large piste utilisée par les camions qui ravitaillent certaines parties de la Bolivie à partir du Chili. Cette route qui porte le numéro 701 nous allons la suivre sur un peu moins de quarante kilomètres. Alors nous la quitterons pour les pistes sableuses. Il est tôt, très peu de circulation, nous apprécions, car chaque fois qu’un véhicule nous dépasse ou nous croise nous sommes pris dans un nuage de poussière qui met un certain temps à retomber. Depuis notre départ entre poussière et absence d’humidité nos cloisons nasales sont irritées et ce n’est pas très agréable. Notre route monte de six cents mètres et nous conduit à 4300 mètres. En prenant de la hauteur le panorama s’élargit. De nombreux volcans apparaissent. A nos pieds s’étale l’immense vallée salée que nous avons traversée hier. Je suis toujours surpris de réaliser qu’avec un vélo on est en mesure d’abattre de grandes distances. En effet, cette vallée que je regarde vers le bas disparaît à l’horizon vers l’est, entourée d’un foisonnement de cônes volcaniques. Nous sommes dominés par le volcan Ollagüe, du haut de ses 5869 mètres. Son cône est égueulé dans notre direction. Nous pouvons y voir toute une palette de couleurs, du blanc au rouge sombre, ce qui correspond aux différents minéraux qui ont été éjectés au cours des irruptions.
Vers les huit heures le trafic se fait un peu plus intense, camions, quelques cars et les véhicules 4X4 des touristes qui traversent eux aussi le Sud Lipez nous en gratifient de quelques nuages de poussière. La traversée classique en véhicule s’effectue en deux jours. Pour notre part il nous faudra au moins dix jours. Le voyage pour les uns en voiture et les autres à vélo ne sera pas le même. Ayant déjà parcouru cet itinéraire en voiture je peux juger des différences. En véhicule derrière la vitre on a plus l’impression d’assister à un documentaire assis devant son écran de télévision. À vélo, d’une part la lenteur introduit un facteur qui permet la contemplation, d’autre part l’absence d’habitacle qui vous protège vous amène tout naturellement à vous sentir partie intégrante de cette nature sauvage qui vous entoure. Ce contact long et étroit, une réelle intimité avec la planète, est une sensation forte qui est créée par le fait que vous vous mettez à la merci des éléments qui parfois ne sont pas très cléments. L’engagement et le risque donnent de la profondeur à l’aventure. Le petit doute que l’on a toujours concernant un échec possible est un moteur fort de motivation pour lutter contre les multiples difficultés qui se présentent. Sur un vélo on se ressent beaucoup plus comme acteur que dans un véhicule. Le corps, les muscles qui fonctionnent et qui durant des heures sans se rebiffer vont emmènent sur les pires routes, cela vous apporte la certitude que vous êtes vivant. Le vélo est un immense amplificateur de sensations au cours d’un voyage.
Tout à mes réflexions nous continuons à monter jusqu’à un col. Une courte descente et ne pas louper le démarrage de la piste qui à droite nous conduira au cœur du Sud Lipez. Voilà l’embranchement, pas de doute grâce au GPS, devant nous une plaine fermée quelques kilomètres au sud par un col. Notre itinéraire passe par là. Bien qu’elle commence à descendre cette piste ne nous permet pas de rester sur le vélo et nous poussons. Nous allons le faire sur trois kilomètres, tout d’abord dans du sable en descendant, puis dans de gros cailloux en montée pour rejoindre le haut du col qui est à 4300 mètres. Ces premiers kilomètres donnent le ton de ce qui nous attend sur les 250 suivants. Ne nous laissons pas envahir par le doute et le pessimisme. Raccrochons-nous à l’instant présent. Ce que nous voulons c’est arriver ce soir à l’hôtel de la laguna Hedondia. Il nous reste donc 21 kilomètres à parcourir. Il est quatorze heures et la faim nous tenaille. À l’abri d’un muret de pierres adossé à une paroi nous nous protégeons du vent et mettons en route notre réchaud. Nous sommes bien organisés, nous sentons que nous sommes en mesure de résister aux intempéries. Cela est rassurant et renforce notre motivation. Après une halte qui nous a fait du bien nous reprenons notre chemin vers notre but de la journée. Nous dépassons un premier petit salar, puis nous rejoignons la laguna Canapa. Elle est de belles dimensions et de nombreux flamants roses en ponctuent la surface. Nous longeons cette étendue salée, pris sous le charme du spectacle et secoués par les bourrasques de vent qui avec l’après-midi se renforcent. Par la suite il nous fait pousser nos vélos jusqu’au sommet de la prochaine bosse. De là une dizaine de kilomètres au sud nous distinguons la laguna Hedondia. Elle est d’une autre ampleur. Sur le bord est nous sommes trop loin pour distinguer l’hôtel. La piste se déroule devant nous. En réalité une multitude de traces, il nous faut choisir laquelle sera la moins mauvaise. Le choix se fait à l’intuition en fonction de la grosseur des cailloux, la couleur, l’aspect plus ou moins sableux. Essayer de lire à travers ces différents éléments la praticabilité de la piste n’est pas chose aisée, mais il faut choisir et rapidement car tous les cent mètres, voire moins, tout est en permanence à recommencer. On a vraiment l’impression que l’on grignote l’itinéraire mètre après mètre. La lagune grossit, nous en rejoignons le bord. Une piste blanche la contourne au plus près. Cela est très bon signe, car nous allons rouler sur un sel dur et notre moyenne va bondir. Nous discernons maintenant le bâtiment de l’hôtel. Nous le rejoignons facilement malgré le vent terrible qui souffle en bourrasques. Qu’il fait bon se mettre à l’abri. Nous sommes presque seuls. Un groupe de trois femmes a aussi décidé d’y passer la nuit. De la baie vitrée de la salle de restaurant nous assistons à la venue de la nuit dans ce décor féerique aux teintes incroyables, se côtoient le vert d’une zone du lac, le bleu d’une autre, le blanc du sel, le rouge de la roche, le rose des flamants. Le tout évolue en permanence en fonction de la position du soleil qui change rapidement à cette heure crépusculaire.
La nuit n’est pas très bonne, d’une part du fait de l’altitude 4150 mètres et d’autre part à cause de l’odeur forte provenant des WC chimiques et qui se répand dans la chambre. Ces effluves disparaitront en cours de nuit lorsque la température véritablement polaire aura tout congelé !
4ème Jour Laguna Hedondia à l’hôtel del Desierto 31 km
Comme chaque matin l’air est totalement calme et la clarté du soleil sur ce monde minéral est d’une beauté qui nous étonne chaque fois autant. Bien que le froid soit vif, l’absence d’humidité le rend très supportable. Ces départs matinaux sont un enchantement. Le vélo est vraiment un mode de voyage idéal pour se sentir partie intégrante de ces régions que nous traversons. Autant le pare-brise d’un véhicule constitue une vraie barrière entre vous et la nature, le vélo lui s’efface et vous laisse en contact direct avec la sauvagerie du lieu, toutes vos sens aux aguets.
Nous commençons notre journée facilement, le sol est solide et nous longeons la laguna Hedondia. Ensuite une côte nous conduit par un col à la lagune suivante, nommée Honda. Ces premiers kilomètres sont agréables, le Sud Lipez aurait-il usurpé sa terrible réputation ? Ne vendons pas la peau de l’ours prématurément ! Effectivement, la suite va nous prouver que non, la réputation du Sud Lipez n’est pas usurpée. En effet, l’état de la piste se dégrade, sable et lave pulvérulente l’envahissent, et seront nos compagnons au cours des huit heures qui viennent. Nous ne pourrons pas enfourcher nos montures, et nous nous engageons dans une longue séance de poussage de huit heures.
Tout d’abord une longue et large plaine à peu près plate nous donne le ton de la journée. Une fois que nous l’avons traversée en poussant, nous marquons une pause vers treize heures à l’abri d’un rocher pour nous restaurer. Puis nous reprenons notre progression en direction d’une gorge. Nous espérons que le changement de topographie va entraîner une modification de la structure du sol. Il n’en est rien. Le seul changement provient que du plat nous passons à une pente raide, demandant d’autant plus d’efforts. Par endroits de grosses pierres nécessitent des détours sur cette piste défoncée et instable.
Un motard nous rattrape. Nous discutons un bon moment. Il se dénomme Julien, est français. Il voyage depuis deux ans et demi avec sa Yamaha. Il a déjà traversé plusieurs continents, l’Europe, l’Asie, l’Australie et l’Afrique. Ces rencontres improbables au milieu de nulle part sont toujours des moments privilégiés de communication On apprend toujours auprès d’êtres passionnés qui sont hors norme. Mais le temps court et il nous faut repartir et nous laissons Julien, qui termine son pique-nique. Lorsqu’il a terminé il nous double rapidement et nous dit au passage : « vous avez une drôle de manière de faire du vélo, d’habitude on est dessus ! »
Nous continuons à monter, le vent devient très violent, la piste disparaît quasiment dans des champs de lave. Nous sommes le long d’un long plan incliné dont on ne voit pas la fin. Mon GPS indique 4700 mètres et ça monte toujours. Cela fait déjà au moins cinq heures que nous poussons dans ce terrain inconsistant. Parfois nous devons soulever la roue avant qui s’enfonce profondément et qui se met en travers. On pourrait se décourager, mais voilà nous n’avons pas d’alternative. En effet, il n’est pas concevable de s’arrêter à un endroit aussi hostile, alors on pousse, on pousse à deux à l’heure mais on avance. Cependant engagés dans une telle entreprise, l’esprit tendu vers la réalisation de notre traversée, nous mobilisons toutes nos ressources physiques et mentales pour persévérer. Dans ces conditions je comprends bien Saint-Exupéry lorsqu’il dit que seule la démarche compte et non le but.
Un véhicule 4X4 s’arrête à notre hauteur. Nous lui demandons des indications pour rejoindre l’hôtel del Desierto. Le chauffeur nous les donne et nous dit qu’il viendra voir où nous en serons à la tombée de la nuit. Dans une situation difficile, il est toujours réconfortant de savoir que l’on peut compter sur une aide. Nous repartons. Flora caracole en avant, ouvrant la voie tel un bulldozer. La côte prend fin, devant nous une longue descente s’amorce. Nous pensons que notre calvaire va prendre fin. Il n’en est rien, impossible de monter sur nos vélos, nos roues restent enfoncées dans un sable profond et inconsistant, mélangé à une poussière à la consistance et couleur du talc. Il nous faut donc continuer, alors que la descente est raide, à marcher arcboutés sur nos guidons à traîner nos lourds équipages sur plusieurs kilomètres. Cette étape semble ne jamais finir, alors que le jour décline. Enfin une indication, l’hôtel n’est plus très loin. À ce moment le 4x4 revient et nous demande si nous avons besoin d’aide. Nous lui répondons que non, mais le remercions. Encore deux petits kilomètres et nous serons arrivés. De plus comme par miracle la piste devient dure et c’est en pédalant que nous terminons cette étape qui se révélera la plus difficile de notre traversée. En effet, en douze heures d’efforts soutenus nous avons parcouru uniquement trente et un kilomètres. Je n’ose calculer la moyenne.
L’hôtel est un véritable havre de paix après cette journée en plein air. Au cours du repas nous entendrons de la part de personnes qui nous ont dépassés en véhicule une remarque du style : « il faut être un peu inconscient pour venir à vélo dans des coins pareils ». Je ne pense pas qu’ils aient raison. S’ils pouvaient imaginer ce que cela procure comme sensations de lutter contre l’adversité. D’autant que jamais nous nous sommes sentis dépassés et que s’il l’avait fallu nous aurions été en mesure de bivouaquer. En effet, notre tente nous la montons en une ou deux minutes maximum et lorsque nous sommes à l’intérieur nous y sommes très bien. La perception que l’on a des éléments n’est pas du tout la même lorsqu’on descend de son véhicule chauffé et lorsqu’on y est exposé depuis déjà de longues semaines. Dans ce second cas, le corps s’est aguerri et endurci. On a l’impression de retrouver les qualités de résistance et d’adaptation de nos ancêtres, qui vivaient dans des conditions beaucoup plus rudes que les nôtres. Cela procure un immense bonheur pour le corps et l’esprit. Le vélo au long court de par la durée de l’effort est un sport unique. Une grande ascension difficile s’étire sur quelques jours voire un peu plus pour certains sommets de l’Himalaya, alors que le vélo vous permet de vous engager dans des coins reculés de la planète et d’affronter les éléments durant un périple de plusieurs mois. Ce qui doit s’apparenter le plus au vélo en termes de préparation à la durée, ce sont les grandes traversées en voilier. Mais je ne m’aventurerais pas trop sur le sujet, car la voile est un domaine que j’ignore, bien que des navigateurs m’aient déjà fait l’immense plaisir de m’emmener sur l’Atlantique par gros temps.
5ème Jour hôtel del Desierto à Arbol de Piedra 31 km
Nous démarrons ce matin d’un point surélevé et nous voyons à nos pieds la grande vallée qui constitue la première partie de notre étape du jour. La couleur nous inquiète, en effet elle révèle la présence de résidus de lave, ce qui constitue un terrible ennemi pour le cycliste. Les premiers kilomètres nous surprennent par leur facilité. Mais cela ne dure pas. Nous retombons sur les sols que nous avons eus hier. Durant une dizaine de kilomètres et trois longues heures nous allons pousser une fois de plus nos vélos. Dans ces moments, alors que l’on n’a aucune idée de ce que nous réserve la suite, on essaie de ne pas penser qu’il nous reste encore deux cents kilomètres à parcourir entre grands volcans et larges lagunes.
Nous arrivons là où la multitude de traces converge en une piste unique, qui semble beaucoup plus consistante que le champ de lave que nous venons de traverser. Effectivement, enfin nous remontons sur nos vélos et reprenons des vitesses de l’ordre de huit à l’heure, ce que nous trouvons très bien. Nous sommes dans un cadre gigantesque. Tout autour de nous, aux limites lointaines de la plaine de lave, de grands volcans se découpent sur le ciel. Être au beau milieu de ce désert, alors que nous sommes venus par nos propres moyens physiques, nous semble presque irréel. Le voyage extrême à vélo ou considéré comme tel, fait naître des sensations et des sentiments, qui font oublier les difficultés et les incertitudes. Plus que jamais nous ressentons que sans adversité il n’y a pas de réel accomplissement. La difficulté est l’un des ingrédients indispensables pour une bonne alchimie du voyage.
Nous arrivons à Arbol de Piedra, gros rocher qui monte en s’évasant, sculpture naturelle, façonnée par le vent, universellement connue. Elle représente l’une des stars de cette traversée du sud Lipez. Le nombre de photographies qu’elle a généré doit être gigantesque. Il n’est pas tard, vers les quatorze heures, nous installons notre tente à l’abri d’une petite falaise, afin que le vent ne nous secoue pas trop. Il ne nous reste plus qu’à attendre tranquillement la venue de la nuit en regardant défiler les 4X4 qui s’arrêtent à proximité et dont les passagers s’empressent de fixer sur la pellicule la multiplicité des roches aux formes étranges qui fleurissent tout autour. Nous discutons avec quelques personnes étonnées de voir des vélos ici. Nous, nous sommes étonnés par le nombre de personnes parlant français. On en profite pour demander un peu d’eau que l’on nous donne de bon cœur. Par moments j’ai l’impression de ressembler à un singe quémandant quelques cacahuètes. Je plaiderais ma cause en disant que les conditions particulières justifient le comportement.
Au soir, tous les véhicules ont déserté le lieu, et nous nous retrouvons seuls dans ce gigantesque décor d’altitude balayé par un vent furieux. La nuit s’installe et les étoiles envahissent la voûte céleste. La tente est large et confortable, ce qui est promesse de nuit douillette. Dans un cadre aussi fantastique le vent, le froid et la fatigue sont malheureusement des freins insurmontables à la contemplation des astres dans ce ciel d’une pureté absolue. Alors que pouvoir observer le ciel dans ces conditions exceptionnelles de pureté de l’air sans aucune pollution lumineuse constitue un privilège rare, nous restons affalés dans nos sacs de couchage, trop contents de rester bien au chaud sans bouger.
6ème Jour Arbol de Piedra à la laguna Colorada 18 km
La nuit a été très froide mais dans nos duvets nous avons bien résisté. Au matin cependant la partie inférieure de mon matelas est couverte d’une couche de glace. Nous attendons bien sagement que les premiers rayons du soleil atteignent le tissu de la tente pour mettre le nez dehors. Effectivement, dès que la chaleur arrive la température monte à une vitesse incroyable. Alors nous sortons et préparons notre petit déjeuner dans un décor grandiose. La ronde des 4X4 reprend. Tout naturellement les gens voyant que nous sommes à vélo et que nous avons dormi sur place viennent nous parler. Je suis encore une fois surpris de voir le pourcentage de Français. Les chauffeurs boliviens nous rassurent sur l’état de la piste. Nous partons donc confiants. Mais rapidement nous constatons que les critères pour un véhicule tout terrain ne sont pas les mêmes que ceux pour un vélo ! La piste est horrible, ça ne roule pratiquement pas. Heureusement notre étape de la journée est courte. Nous roulons tellement peu, que nous nous écartons de la piste à la recherche d’un terrain stable. Mais nous ne le trouvons pas, c’est même pire ! La piste a cette couleur grise, qui nous indique que nous n’avons d’autre alternative que de pousser le vélo. On ne sait jamais si cela va durer cinq cents mètres ou dix kilomètres. On m’a toujours dit que le Sud Lipez nécessitait une grande qualité, la patience. On ne peut pas dire que je suis patient, loin de là. Mais je me suis bien imprégné du conseil. Je me dis que ma journée est consacrée exclusivement à atteindre le but fixé, et que j’arrive à treize heures ou dix-huit heures cela n’a pas d’importance. L’esprit du lieu me pénètre, la distance le temps et la fatigue disparaissent de mon esprit. Plus de stress, je pousse en contemplant le décor gigantesque et d’une incroyable beauté qui nous entoure en ne cherchant pas à regarder en permanence ma montre. Les yeux ne cherchent plus le compteur kilométrique à guetter avec impatience les centaines de mètres qui défilent, voire seulement les dizaines. Pour ma part je ne peux plus avoir les yeux rivés sur le compteur, car je me le suis fait voler il y a une dizaine de jours à la frontière bolivo-chilienne à Tombo Quemado. Mais j’aurais pu le remplacer par le GPS, qui a aussi cette fonction. Eh bien non ! Il est bien sur mon guidon, mais il reste éteint. Ça fait un bien fou, mais c’est un peu hypocrite car j’ai un topo qui donne précisément les distances. J’ai lu un livre d’un accompagnateur montagne, qui a fait une traversée en solitaire des Pyrénées, en fin d’automne, en passant par nombre de sommets. Il a décidé de ne prendre aucun appareil de mesure, boussole, altimètre, podomètre, montre. Le soleil et sa carte étaient ces seuls éléments de repères. J’aimerais bien être capable de l’imiter. Effectivement, je me sers du GPS pour me diriger vers un point lorsque j’ai un doute, mais suivre une trace je trouve que cela nuit à l’esprit du voyage. J’ai un ami lorsqu’il fait des balades en montagne, il ne regarde pas le spectacle de la nature, mais reste les yeux rivés sur son écran pour coller au plus près du parcours. Je trouve cela aberrant, mais ce n’est que mon sentiment, et chacun fait bien comme il veut. Cependant, au cours de mes voyages à pied ou à vélo, souvent j’ai fait de très belles découvertes alors que je m’étais perdu. Donc il est important de pouvoir se perdre. Mais je reconnais que dans l’Atacama, ça fait peur de ne plus savoir où l’on se situe !
La laguna Colorada apparaît, elle semble loin, d’autant plus loin que nous poussons en descente pour la rejoindre. Mais nous en prenons l’habitude, et nous nous étonnons même de parcourir de telles distances à pied doucement mais inéluctablement. Il faut dire que Flora garde une constance d’humeur et une forme physique indestructible, il n’y a plus qu’à essayer de l’imiter ! La piste perd sa teinte grise et devient meilleure. Une fois sur le bord nous arrivons rapidement au point de contrôle à l’entrée du parc. Nous payons la taxe et partons à la recherche d’un logement. Nous le trouvons facilement. Il n’est pas tard, 11h30. Nous en profitons pour faire un peu de lessive, comptant sur le soleil de l’après-midi pour sécher nos affaires. Nous voyons arriver deux cyclistes qui traversent dans le même sens que nous. Le premier Ron est américain, le second Daniel, allemand. Ils sont lancés dans la descente de l’Amérique du sud, et roulent ensemble depuis Cusco.
Nos provisions diminuent lentement, car nous avons jusqu’à présent trouvé le gîte et le couvert assez fréquemment. Après avoir englouti notre gamelle de riz, nous partons admirer la lagune Colorada à partir du point haut situé au nord. La vue est époustouflante sur un monde étrange, où les couleurs de l’eau sont surprenantes, le rouge domine rehaussé par des touches de vert. Le nombre de flamants roses est important, ils se regroupent en colonies nombreuses. À l’arrière-plan un immense volcan à la forme pyramidale parfaite domine cette vaste lagune. Nous avons du mal à quitter ce spectacle grandiose, malgré le vent qui souffle en rafales rageuses.
7ème Jour laguna Colorada à Sol de Manana 37 km
Comme tous les matins avec Flora dès le lever du jour nous sommes sur nos montures. Nos deux camarades Ron et Daniel, désirant comme nous aller bivouaquer à proximité des geysers ont décidé de partir plus tard. Les seize premiers kilomètres le long de la lagune sont particulièrement mauvais. Cailloux et sable sont présents en permanence et il nous faut jongler d’un côté à l’autre de la route pour espérer rester sur nos vélos. Nous n’y arrivons pas toujours et il nous faut encre pousser. Un pick-up s’arrête et nous propose de nous prendre. Je suis sur le point de céder, Flora s’y refuse. Voilà comment grâce à elle je traverserai le Sud Lipez sans aucune aide extérieure, un grand merci à Flora ! J’ai failli craquer car j’ai eu peur de la longueur de l’étape de 37 kilomètres, alors que les jours derniers nous avons effectué des étapes de l’ordre de la vingtaine de kilomètres seulement.
Enfin nous arrivons au bout de la lagune et la route d’après nos informations s’améliore. Effectivement le sable et les cailloux disparaissent. Va-t-on pouvoir rouler ? Nous commençons par manger, puis nous remettons en route. Le revêtement est incontestablement meilleur, mais la pente est terrible. Nous voilà donc repartis dans une longue séance de marche dans une côte qui va nous conduire pratiquement à 5000 mètres d’altitude. En trois heures à côté de nos vélos nous progressons de 12 kilomètres et montons de 700 mètres. Quelques 4X4 et camions nous doublent. Ces derniers comme souvent en Amérique du sud contrairement aux bus sont toujours prudents lorsqu’ils nous dépassent et nous gratifient de grands bonjours par signes de la main ou par coups de klaxon.
Nous arrivons à l’altitude de 4700 mètres et manifestement nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous marquons l’arrêt en un endroit où le point de vue sur tout ce que nous venons de parcourir depuis ce matin, nous démontre que bien que nous ayons passé pas mal de temps à pousser, nous avons fait un sacré bout de chemin, presque trente kilomètres. Après avoir grignoté quelques petits gâteaux nous repartons en roulant. Après un « super-poussage » c’est très bon pour le moral. Nous arpentons un vaste plateau, au bout duquel nous savons qu’il va falloir monter jusque vers 5000 mètres. Ron nous rattrape. Il a un bon coup de pédales. Avec Flora ils me laissent vite en arrière. Je les vois s’engager dans la dernière côte, Flora pousse, Ron non. Il faut dire que Flora a un petit plateau d’au moins trente dents, alors que Ron comme moi en possède un de 22 dents, ce qui permet de monter aux arbres. Le vent commence à souffler avec force et il nous est contraire. Je suis un peu perdu, je vois mes deux compagnons partir dans une côte raide. Je fais un point GPS, je suis à plus de 4900 mètres. Ils sont en train de passer les 5000 mètres. Un 4X4 s’arrête à leur hauteur et leur indique le chemin de Sol de Manana. Je commence à sentir sérieusement la fatigue. Flora redescend à pied et vient me pousser pour passer le dernier petit raidillon qui conduit à un carrefour, d’où démarre la piste pour notre but du soir. En trois kilomètres en légère descente nous rejoignons cette cuvette extraordinaire, au milieu de laquelle des quantités de fumerolles se dégagent.
Il nous faut nous préparer au bivouac à 4850 mètres, dans ce site que l’on nous a dit glacial. Pour le moment le froid n’est pas très violent, il y a encore du soleil. Mais quand il va disparaître il faut s’attendre à une chute brutale et de grande amplitude de la température. Des points de bivouac nous n’en voyons pas vraiment. Il y a une ruine, avec Flora nous installons notre tente à proximité de l’un de ses murs, bien qu’il n’abrite pas vraiment du vent. En effet, ce dernier est si violent qu’il crée sur l’obstacle des turbulences rageuses, qui nous secouent sérieusement. La tente est vite montée et dès que nous sommes à l’intérieur c’est le calme. Je suis vraiment content de mon choix, j’avais hésité entre plusieurs modèles.
Daniel nous a rejoints. Nos deux amis cherchent un emplacement pour monter chacun sa tente. Ce n’est pas facile. Nous les aidons à construire un mur protecteur. Après ces trente-sept kilomètres difficiles effectués en 8 ou 9 heures, porter des gros cailloux à cette altitude dans les rafales de vent est assez éprouvant. Nous réussissons à ériger un joli ouvrage qui les protégera. Nous allons voir les geysers. Un dernier 4X4 se prépare à partir. J’en profite pour demander des renseignements pour la suite au chauffeur. Comme toujours c’est très gentiment qu’il me renseigne. Puis nous regagnons chacun nos tentes, car les conditions de température deviennent sévères. On va même allumer notre réchaud à l’intérieur en mettant une couverture de survie en protection.
8ème Jour Sol de Manana à la Laguna Chalviri 21 km
La nuit n’est pas très bonne, non qu’il fasse froid, mais le manque d’air m’handicape. J’essaie de lire un peu, mais nous passons Flora et moi une partie de la nuit à discuter. Je ne me souviens pas quels étaient les sujets, mais cela nous a aidé à passer le temps. Mais rien que de se trouver dans ce coin extraordinaire, malgré les difficultés à respirer j’éprouve un immense plaisir. Nous finissons par sombrer dans le sommeil bien après minuit.
Comme tous les matins l’air est immobile, les jets des geysers ne sont pas perturbés par le vent et montent très haut en grands panaches blancs qui se découpent sur le ciel bleu profond. Se réveiller avec le bruissement des gaz et émerger de la tente devant ce spectacle est tout simplement merveilleux. Dire que j’étais venu en ce lieu en véhicule il y a quatre ans. Je n’en garde pas cette impression féerique, qui me subjugue aujourd’hui. J’invite tout le monde à sauter sur un vélo et venir bivouaquer ici et vivre cette aventure du Sud Lipez !
Dès que le soleil nous touche nous sortons et étalons nos affaires de bivouac et préparons notre petit déjeuner. Nos camarades ont moins de chance que nous, ils sont toujours à l’ombre et la différence de température est conséquente. Nous ne nous lassons pas de regarder ces grands jets qui pointent dans le ciel. Ce matin nous ne nous pressons pas, l’étape sera courte et en descente, et effectivement les différents chauffeurs boliviens nous l’ont annoncée « todo abajo ». Mais on se méfie quand même, même si d’après leurs dires ce sera très court. On table tout de même sur quatre heures. En partant vers huit heures on compte arriver à midi.
Il nous faut rejoindre la piste principale qui passe quelques kilomètres plus bas. Les indications de la veille sont claires et rapidement nous sommes dans la descente qui doit nous conduire à la laguna Chalviri. Effectivement, nous la distinguons nettement quelques centaines de mètres plus bas. La piste n’est pas très bonne mais nous pouvons rester sur le vélo, donc tout va bien. Encore et comme toujours le spectacle est magnifique. On ne se lasse pas de pédaler dans ce décor d’exception. Nous rejoignons le bord de la lagune et après quelques kilomètres les bâtiments des refuges font leur apparition au détour d’un mouvement de terrain. Nous trouvons de quoi nous loger et on nous propose aussi les repas. Nous n’en demandions pas tant, mais nous nous empressons d’accepter.
Nous déchargeons rapidement nos vélos et mettons nos sacoches dans notre chambre et partons nous baigner en plein air dans une eau merveilleusement chaude provenant de l’activité volcanique. Cela procure un bien-être prodigieux ! Cette séance de thalasso nous a ouvert l’appétit, nous rentrons et nous installons devant une belle assiette bien préparée. Le Sud Lipez c’est presque le paradis !
Ron et Daniel arrivent. Ron décide de ne pas s’arrêter, il compte rejoindre le refuge de la laguna Blanca. Cela fait encore beaucoup de kilomètres, une quarantaine et la chaleur commence à être forte. Daniel plus sagement reste avec nous. Nous passons l’après-midi à contempler cette magnifique lagune. Le temps est couvert, la pluie semble menacer. L’eau prend des teintes sombres sous les nuages noirs. Au cours de notre traversée nous aurons passé beaucoup de temps au bord des lagunes. Les étapes que nous avons effectuées nous ont permis bien souvent d’assister à la venue de la nuit sur ces surfaces liquides, et nous n’avons pas vu le temps s’écouler pris sous le charme de cette nature magnifique. J’imagine que les personnes qui traversent en 4X4 se disent que mettre dix jours pour faire ce trajet que l’on parcourt en 48 heures en véhicule, doit rapidement engendrer de l’ennui voire de l’impatience. Eh bien non ! L’esprit du lieu nous a pénétrés et la lenteur a été source de bonheur. Ne pas se soumettre aux rythmes effrénés, qui nous Occidentaux nous réduisent en esclavage, toujours à la recherche de la rentabilité maximale, vite voir beaucoup de choses en peu de temps, eh bien casser ce cycle infernal du chronomètre donne accès à un autre mode de vie, qui procure beaucoup de jouissance et qui permet de vraiment s’imprégner de lieux aussi fantastiques que ceux que nous traversons. La planète reprend ses dimensions pour la plus grande joie de ceux qui ont décidé d’aller lentement.
Nous sentons que l’expérience du Sud Lipez à vélo touche à sa fin. Demain nous effectuerons l’avant-dernière étape. L’ultime, ne comportant plus que 10 kilomètres de piste, ne sera que le point final de cette aventure. Presque à regret nous voyons arriver le terme de cette fantastique chevauchée, et nous n’éprouvons pratiquement aucune fatigue et la lassitude ne la piste ne s’est pas non plus installée. Cela fait déjà une vingtaine de jours que nous sommes partis d’Arica à la frontière nord du Pérou au bord de l’océan Pacifique et le plaisir de pédaler est toujours plus fort. Comme dit mon ami Jean, nous sommes en pleine vélo thérapie et les effets sont extraordinaires sur le corps et l’esprit. En me faisant ces réflexions je regarde la nuit venir sur ces immenses montagnes, qui prennent des teintes sombres évoluant vers le noir, quant à la surface de la lagune elle prend une couleur argentée ou peut-être plomb fondu.
9ème Jour Laguna Chalviri au refuge de la laguna Blanca 46 km
Comme presque tous les matins, départ six heures, c’est une bonne habitude que nous garderons jusqu’à Santiago. Effectivement, rouler dès le lever du jour permet d’effectuer des étapes dans de bonnes conditions de chaleur et d’arriver tôt, généralement en tout début d’après-midi. Entre six et neuf heures du matin, ce sont les meilleures heures pour rouler, et cela pas uniquement dans le Sud Lipez. Ici ce moment est privilégié car pas un souffle d’air ne perturbe la quiétude matinale.
Première partie de notre étape, le désert de Dali, étendue d’une vingtaine de kilomètres qui se termine par une belle côte qui culmine à 4726 mètres. Nous avons une bonne surprise, la piste sans être excellente est tout à fait « roulable » et nous n’avons pas à chercher désespérément et en permanence l’endroit de la chaussée où nous aurons une chance de rester sur le vélo. Le spectacle est une fois de plus grandiose. Des roches aux teintes étonnantes nous accompagnent tout au long de ce désert. Il porte ce nom, en référence au grand peintre, dont certains tableaux rappellent le spectacle qui se déroule sous nos yeux dans ce monde minéral. La montée est effectivement sévère. Une fois au sommet, nous basculons en direction d’une autre lagune, plus formée de sel que d’eau. Nous sommes surpris à chaque détour ou mouvement de terrain par les couleurs qui se superposent, un sable rouge foncé qui tranche sur le blanc du sel, le tout se fondant dans le vert pâle de l’arrière-plan. Le Sud Lipez aura décidé de nous émerveiller jusqu’à son dernier kilomètre. Après cette lagune au nom oublié, le volcan Licancabur, du haut de ses 5916 mètres, s’impose sur un décor magnifique. À son pied deux magnifiques lagunes s’étirent, le Blanca et la Verde. Cette dernière ne se découvre pas immédiatement.
Nous longeons dans un premier temps la Blanca en direction du Licancabur. Le vent se met sérieusement de la partie. À l’abri d’une ruine en bon état nous faisons une halte pour midi. Bien protégés du vent nous mettons en action notre réchaud. Cette heure d’arrêt après trente kilomètres est très appréciée. Nous repartons face à un vent violent en direction de la laguna Verde, que l’on ne voit pas encore. Au détour d’un mouvement de terrain, elle nous saute littéralement à la figure ! Véritable bijou à la couleur vert émeraude, tapi au pied même de cet immense volcan à la forme géométrique parfaite. Malgré les très fortes rafales de vent nous restons au moins une demi-heure devant cette extraordinaire beauté de la nature. Nous sommes seuls. Nous essayons d’imaginer la voie d’ascension de ce cône qui nous domine. Puis nous enfourchons nos vélos et nous dirigeons vers la rive ouest de la laguna Blanca qui nous conduira onze kilomètres plus loin au terme de notre étape du jour, au refuge situé sur sa rive sud. Minuscules dans le lointain on discerne quelques bâtiments. Le vent cette fois va nous accompagner et c’est un plaisir immense de longer ce plan d’eau salée poussés puissamment par Éole. On pourrait penser que nous avons des vélos électriques. C’est presque sans difficulté que nous avons effectué les 46 kilomètres de l’étape du jour. Le Sud Lipez c’est la surprise permanente. Un jour on parcourt difficilement trente kilomètres voire moins, et le suivant on pourrait faire le double. Au refuge nous retrouvons Daniel. Nous ne sommes pas très nombreux, un groupe de Français en partance pour la traversée en véhicule en direction d’Uyuni y séjourne.
10ème Jour laguna Blanca à San Pedro de Atacama 53 km
Je suis toujours étonné de la différence de sensation quant au poids du vélo avec ses bagages lorsqu’on le pousse ou lorsqu’on pédale. En effet le matin avant de se mettre à pédaler il faut sortir le vélo de l’endroit où on l’a rangé pour la nuit. Bien évidemment ces manipulations se font en poussant le vélo. À ces moments on le trouve effroyablement lourd et l’on se dit que jamais on va arriver à pédaler. Et puis le miracle s’accomplit, une fois les premiers mètres parcourus, les pédales tournent presque toutes seules.
Ce matin nous sommes bien conscients que l’aventure du Sud Lipez va prendre fin. Au lever du jour sans empressement nous partons. Nous roulons lentement en cherchant à nous imprégner toujours plus de ce décor minéral, dont on ne se lasse pas. Les cyclistes qui ont effectué un tour du monde, disent presque tous que le temps fort de leur périple consistait justement dans cette traversée que nous sommes en train de terminer. Nous ne voulons pas terminer. Nous pensions que ces derniers kilomètres de piste nous les ferions comme une délivrance, heureux de quitter un enfer. Eh bien non ! Notre enfer nous aimerions qu’il dure encore et c’est à regret que nous voyons arriver le poste frontière, qui marque la fin de l’aventure. Les douaniers boliviens sont particulièrement sympathiques. Ils ne nous font pas payer les 15 ou 20 bolivianos que nous avions conservés dans ce but. Ils se proposent même de nous prendre en photo tous les trois, car aujourd’hui encore nous roulons avec Daniel. Après avoir crié à leur intention, ce qui les fait rire, « Viva Bolivia » nous pénétrons au Chili. La piste se prolonge encore sur quelques kilomètres, au long desquels de nombreuses vigognes pas farouches du tout viennent nous donner un ultime salut du Sud Lipez. Un carrefour, le goudron est là. Nous sommes un peu tristes, un dernier regard en arrière sur ces dix jours qui nous laisseront des souvenirs merveilleux toute notre vie, et nous nous lançons dans une gigantesque descente vers San Pedro de Atacama en faisant attention de ne pas nous laisser entraîner au-dessus de 80 kilomètres/heure, car les patins de frein risqueraient de chauffer plus que de raison.
Ce que nous ne savons pas encore c’est que dans deux jours, notre prochaine étape, de San Pedro de Atacama à Salta en Argentine par le Paso Sico sur 500 kilomètres, va nous réserver une aventure au moins aussi intense et plus sauvage que celle que nous venons de vivre. Mais c’est une autre histoire !
15:14 Publié dans expérience vécue, voyage à vélo | Lien permanent | Commentaires (0)
17/12/2012
Deux mois autour du Mékong à vélo 1ère partie Thaïlande
Un projet comme celui que nous envisageons Christian et moi, de l'ordre de 4 à 5000 km en un peu plus de deux mois en Thaïlande, Laos et Cambodge, commence à se vivre bien avant d'être partis. Des images déjà plein la tête nous réfléchissons à l'itinéraire. Mais le chemin suivi a-t-il vraiment une importance quant à son détail? Le voyage ne se construit-il pas au fur et à mesure des sensations ressenties, des rencontres faites, et des intuitions sur le terrain?
Ce que je sais de façon presque certaine, c'est que la route passera par les montagnes du nord Thaïlande et nord Laos. Le voyage à vélo, outre bien entendu le fait, comme les autres formes de voyages, de se plonger dans des cultures autres, consiste plus précisément en de longues étapes sur la route, tourné vers soi-même dans l'accomplissement d'un effort de longue durée. Peut-être ce mode de déplacement simple et peu onéreux permet-il d'avoir une meilleure communion avec l'espace et donc communication avec les autochtones? Ce n'est pas sûr. Il faut savoir garder son humilité et bien réaliser que pour les habitants de pays très pauvres, nous restons des touristes, certes à vélo, mais des touristes. Eux qui bien souvent ne rêvent que de limiter les efforts qui les épuisent à essayer de se procurer la nourriture qui leur permet de survivre. Quelle idée peuvent-ils se faire de ces Occidentaux repus qui pour combler leur grand vide, ne trouvent rien de mieux que de se lancer dans de durs efforts physiques?
Vers le 15 novembre, nous avons pris nos billets d’avions. C'est un grand pas psychologiquement, bien que nous n'ayons pas encore fait le premier centimètre de notre périple. Je suis satisfait, en effet un changement avec peu d'attente aussi bien à l'aller qu'au retour; départ donc le 10 janvier et retour le 17 mars. Cela représente un peu plus de 60 jours sur nos vélos, ce qui fait peu et beaucoup.
Je suis depuis pas mal de temps un couple de cyclistes lancés dans la traversée de l'Amérique du Sud. Leur dernière narration sur leur blog consiste en la traversée du sud Lipez. Magnifique tout simplement. Hier je suis allé à l'ISBA Santé Prévention. Un médecin très compétent durant 45 minutes m'a expliqué les différents risques dans les différentes zones que nous comptons traverser. Effectivement les risques sont d'autant plus élevés que nous allons séjourner généralement en dehors des villes dans les campagnes, là où se développent les foyers de paludisme, de dengue et de l'encéphalite japonaise. Concernant le palu et l'encéphalite la question se pose, concernant le premier de se mettre sous malarone tout au long du voyage ou non, et pour le second de se faire vacciner, que faire? Nous ne serons pas dans ces pays à la saison des pluies, donc le risque est moindre, mais jamais nul. Mon camarade Eric qui traîne dans ces coins depuis de nombreux mois, me rassure en me disant qu'un bon répulsif est tout à fait suffisant. Ce qui est aussi le cas d’Évelyne et Jean qui l'année dernière sont restés trois mois dans cette région.
En définitive, je m'oriente vers une vaccination contre l'encéphalite japonaise et une dose de sécurité en malarone en cas de suspicion de contamination. Il est préférable d'être prudent sans être alarmiste. Comme on me l'a appris: pessimiste dans la conception et optimiste dans la réalisation.
Je viens d'avoir un contact intéressant, qui m'a relaté son voyage à travers les pistes du Laos du nord loin des routes les plus courues. Son récit m'a beaucoup plu et me donne vraiment envie d'aller me perdre sur les plateaux parmi les ethnies. Ce coin de la planète est une destination assez courante pour les cyclotouristes. En particulier la route Luang Prabang Vientiane représente souvent pour ceux qui l'ont parcourue un passage d'anthologie. Mais les pistes perdues semblent moins pratiquées. Si l'on s' inscrit dans un voyage programmé avec points de passage obligatoires dans un temps contraint, alors nécessairement on a tendance à rejoindre les routes les plus roulantes, donc les plus passantes pour abattre des kilomètres, afin de coller au programme. Mais bien souvent ces points de passage sont les grands "spots" touristiques qui ponctuent les pays de loin en loin. Ne faut-il pas justement échapper à cette normalisation du voyage à l'occidentale et aller à l'aventure justement là où aucune promotion n'est faite dans les guides?

Sur la carte ci-dessus notre itinéraire durant le premier mois à travers la Thaïlande est facile à repérer. Après notre arrivée à l'aéroport de Bangkok, nous prendrons le train pour Ubon Ratchathani, située à 600 kilomètres à l'est de la capitale. De cette ville notre périple à deux roues commencera. Tout d'abord nos vélos nous conduiront plein nord en direction de Mukdahan, cité où nous trouverons le Mékong. De là nous longerons la frontière est du pays jusqu'au nord, à venir buter contre la Birmanie. Alors nous franchirons la frontière laotienne à Chiang Kong.
Cet itinéraire en Thaïlande, estimé à 1500 kilomètres, sans tenir compte des détours que nous ferons sans doute, se décompose en deux parties distinctes.
La première de Ubon Ratchathan jusqu'à Nong Khai (qui est le point frontière donnant sur la capitale du Laos, Vientiane) se déroulera le long du Mékong, zone essentiellement plate. La distance est de 600 kilomètres. Outre l'attrait de découvrir ce grand fleuve tout au long de ce parcours de plusieurs centaines de kilomètres, cela me permettra de m'installer dans l'effort physique au long court, car je pars avec très peu d'entraînement, pour ne pas dire aucun!
La seconde partie, de Nong Khai à Chiang Kong plus au nord à la frontière avec la Chine, passe à travers les montagnes du nord du pays. Le parcours sera beaucoup plus accidenté, et il s'étirera sur une distance de 900 kilomètres.
Arrivant le 11 janvier à Bangkok, il nous faudra au plus tard sortir du pays 30 jours après, durée limitée du visa. En fonction de cette contrainte nous adapterons notre durée de séjour dans le nord du pays et des différents circuits que nous envisagerons afin de monter sur quelques uns des sommets réputés pour leur fabuleux point de vue, en particulier au lever du jour.

Concernant le Laos, le programme n'est pas encore calé. D'ailleurs nous n'avons pas l'intention de planifier grand chose. Nous savons que nous voulons dans toute la mesure du possible rouler par des pistes perdues avec peu de circulation. A travers les différents contacts pris avec des cyclistes qui ont emprunté les routes et chemins de ce pays, j'ai bon espoir que nous puissions partir nous perdre sur des plateaux loin des routes classiques suivies par les tour-opérateurs. Nous ne chercherons pas à traverser le pays en vue de préserver une semaine pour visiter le Cambodge, au contraire nous nous laisserons guider par notre inspiration et les informations que nous glanerons éventuellement au cours de notre avancement.

Sur cette carte du Laos on peut distinguer les différentes régions. Ce pays me fascine de plus en plus au fil des témoignages des voyageurs à vélo, dont je lis les aventures sur leurs blogs. J'ai l'impression que deux types de voyages à vélo fort différents sont possibles, soit rester sur les grands axes du nord au sud, ou alors aller à la découverte par des petites pistes peu fréquentées. Ces dernières on les trouve aussi bien au nord qu'au sud. Ces différentes lectures, me permettent de visualiser mieux le trajet à venir, que nous cherchons à élaborer.
Depuis le nord à partir de Chiang Kong rejoindre Pakbèng puis Hongsa et de là Luang Prabang; ensuite nous ne couperons pas à la mythique route qui conduit en 400 kilomètres à Vientiane via Vang Viang; puis rejoindre Viang Kham quelques 200 km à l'est puis par la N8 Lak Sao, puis plein sud par la N1E jusqu'à Mahaxai, puis en restant au centre du pays par des pistes rejoindre Saravane puis Attopeu, et revenir plein ouest sur Pakse.
En un mois cela me semble déjà un joli programme, car selon l'état des pistes et le niveau des précipitations, la moyenne journalière peut fort tomber à quelques dizaines de kilomètres! Nous verrons bien, c'est justement là tout l'intérêt de ce type de voyage, l’incertitude.
J-2
Le départ arrive. Je commence à faire les sacs, je vais avoir moins de vingt kilos de bagages, bien que nous ayons opté pour la version lourde avec autonomie donc capacité de camping sauvage. Ce jour j'ai enduit mes vêtements d'un répulsif à moustiques. Pouah! ça pue! j"espère que ce sera efficace. J'ai pulvérisé ce produit, piquant pour le nez, sur mes vêtements de base, un pantalon et trois t-shirt à manches longues. Ces quatre effets seront ceux que je porterai en permanence durant ces deux mois. En effet, le problème du paludisme est à prendre au sérieux, car nous n'avons pas l'intention de rester dans les villes mais d'aller dans les coins reculés et d'y dormir dans des conditions rustiques. J'ai entendu tous les avis sur ce problème de piqûre de moustiques. Cependant certaines personnes interrogées avaient contracté le paludisme. Toute fois, ne soyons pas alarmiste, même en France nous ne sommes pas à l'abri. Une personne de mon entourage l'a attrapé, alors qu'elle n'était jamais partie à l'étranger. Pour ma part, suite à avis médical j'ai décidé de partir avec deux plaquettes de malarone, que je prendrai à dose massive, quatre par jour pendant trois jours, en cas de crise de palu. Le prix en pharmacie varie de 31 à 49 euros la plaquette de 12. La grande pharmacie de Lyon est particulièrement compétitive. Concernant l'encéphalite japonaise, je me suis fait vacciner, deux doses espacées d'un mois, 115 euros la dose, aïe!
J 10 Janvier
Il ne fait pas beau à Lyon, de la pluie, nous partons pour l'aéroport assez tôt. Sur les conseils de Christian j'expérimente l'emballage directement à l'aéroport avec film plastique. Pas si évident et cela prend du temps. Les opérateurs de la machine à filmer se sont appliqué et sont allé chercher du carton pour renforcer la protection.Mais ils se sont fait bien payer pour leur labeur: 25 euros par vélo. Une petite sueur froide à l'enregistrement, nos vélos n'étaient pas prévus, alors que nous avions payé depuis deux mois. Mais tout a fini par s'arranger.
J+1 11 Janvier
Arrivée à Bangkok vers 15 heures locales, six heures de décalage avec la France. L'aéroport est très grand, moins cependant que Francfort, par lequel nous avons transité. La récupération de nos bagages et vélos se passe pas trop mal. Nous n'avons pas trop de dégâts sur nos montures malgré une manutention assez "virile". Mon porte- bagages un peu tordu, ce qui est une petite gêne, mais que j'ai déjà expérimentée, car il avait souffert au retour du Chili, raison pour laquelle j'avais décidé de le changer.
L'hôtel nous fait récupérer à la descente de l'avion, tout est bien organisé. Il fait chaud vers les trente degrés avec un fort taux d'humidité. Le contraste avec la Franc en ce mois de janvier est important.
Premier dîner thaï, nous demandons expressément que les aliments ne soient pas trop épicés,faveur qui nous fut accordé. J'ai du mal à définir ce que j'ai mangé, un mélange de légumes avec différents fruits de mer, le tout accompagné d'une sauce douce, très bon.
Nous n'avons pas trop dormi, tout du moins en décalé, car en nous couchant à 22 heures locales, il était 16 heures en France!
J+2 12 Janvier
Journée à Bangkok, notre hôtel à proximité de l'aéroport est loin du centre ville. Nous partons à pied pour la station de train la plus proche. Nous nous perdons, mais cela nous permet de regarder des quantités de gros poissons qui grouillent dans un canal.
Nous faisons appel à un taxi qui nous amène à la gare. De là après un parcours d'une bonne quinzaine de kilomètres nous continuons notre chemin en métro. Ce dernier est très propre. Nous arrivons à la gare centrale avec l'intention de prendre nos billets pour demain soir à destination de Ubon Rathachani, ville distante de 600 kilomètres en direction de la frontière est du pays. Nous voyagerons de nuit afin d'attaquer notre première étape à vélo tôt le matin.
Christian achète un abonnement téléphonique thaï, pas évident à mettre en œuvre!
Nous partons nous balader dans la ville, en particulier nous traversons toute la China Town, grouillement immense qui s'étire sur des kilomètres carrés. La ville compte 12 millions d'habitants.
De retour à l'hôtel, nous n'arrivons pas à négocier un taxi en mesure de nous conduire avec nos vélos au train. Nous décidons que demain nous irons à deux roues. Trajet de 25 ou 30 kilomètres en ville, mais Évelyne et Jean l'ont fait l'année dernière, ça nous donne le moral.
J+3 13 Janvier Bangkok 26 km
Ce matin il fait chaud, nous démarrons la traversée de la ville tentaculaire de Bangkok à neuf heures. C’est avec quelques appréhensions que nous nous lançons dans ce trajet de 26 kilomètres. D’après le plan fourni par l’hôtel, l’itinéraire semble très simple. Ce dimanche matin nous nous retrouvons dans un trafic modéré . Dès que que nous roulons l’air créé par le mouvement rend l’étuve provenant de la chaleur, du goudron et de la pollution très supportable. Bangkok est considérée comme l’une des villes les plus polluées au monde.
Les douze premiers kilomètres sont rapidement parcourus avec un petit vent arrière qui nous permet sans forcer de rouler à 25 kilomètres à l’heure.
Les choses vont se gâter quelque peu par la suite. En effet, à un carrefour en patte d’oie, que nous ne remarquons même pas, nous prenons le mauvais embranchement. Nous allons réaliser notre erreur quelques kilomètres plus loin, car la route prend une direction que le plan n’indique pas. Nous nous retrouvons dans une grande avenue au très fort trafic, enserrée au milieu d’immenses buildings. Arrive un carrefour, nous sommes perdus, que faire? A l'aide du plan j’interroge la première personne. Il s’agit d’un homme qui parle couramment anglais et qui lit facilement le plan de la ville, ce qui est loin d'être la généralité, vu notre expérience de la veille. Nous avons de la chance. Il nous situe immédiatement et nous indique le chemin de la gare. Dans un énorme flot de voitures et de motos nous parcourons les dix derniers kilomètres conduisant à notre destination. Il nous aura fallu deux heures. Par comparaison, j’ai trouvé ce parcours moins stressant que la traversée de Quito, que nous avions effectuée deux fois il y a trois ans, d’abord de jour puis de nuit.
Nous voilà donc arrivés en gare, il est onze heures du matin. Il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment le départ de notre train de nuit jusqu'à 20h30.
Dans le hall beaucoup d'Occidentaux avec sac au dos. L'ambiance est calme, mis à part une musique d'ambiance, qui par moments nous casse un peu les oreilles. J'en profite pour m'acheter un bouquin, in english of course, ce qui me permet d'attaquer cette longue attente dans de bonnes conditions.
Enfin la délivrance. Nous chargeons nos vélos, et avec nos bagages nous rejoignons nos couchettes. Le compartiment fait un peu transport vers Tréblinka. Mais un employé vient confectionner les couchettes et ajoute pour chaque voyageur un rideau vert pour l'isoler des autres. Le compartiment s'en trouve transformé instantanément. Il ne me reste qu'à essayer de trouver le sommeil qui ne vient pas vraiment.
J+4 Ubon Rathatchani à Kut Khaopun 96 km
A 7h40, après une longue nuit le train arrive à son terminus. Rapidement nous sommes en mesure de rouler et quelques centaines de mètres après la gare nous nous retrouvons au milieu d'un trafic conséquent. Par où partir? Tout est écrit en thaï, bien que ma carte soit dans les deux langues, l'écriture thaïe est tellement tarabiscotée que nous n'arrivons pas à identifier les noms de ville par comparaison. Mais une personne nous renseigne et nous voilà dans la traversée de Ubon un lundi, sans doute à l'heure d'embauche.
Nous n'avons rien dans le ventre. Arrêt dans un café, qui nous prépare un café très bon, mais la tenancière ne peut rien nous proposer à manger.
Nous reprenons notre route avec l'espoir de nous ravitailler plus loin. Nous nous engageons sur la N212 que nous suivons une trentaine de kilomètres. Premier contacts avec les commerçants de bord de route. Nous dégustons nos premières bananes, très bonnes, douces et sucrées, et nos premiers criquets, salés, craquants et les pattes qui restent dans la gorge!
Puis nous optons pour des routes secondaires, ce qui bien entendu du fait de l'écriture thaïe laisse toujours une incertitude sur l'itinéraire, car la carte Michelin en notre possession est au 1/ 1 370 000, et la barrière de la langue est bien réelle. Mais la bonne volonté des gens rencontrés et la très bonne facture de la carte nous permettent sans difficulté de ne pas nous perdre.
Vers les 13 heures, il fait 37 degrés, en roulant cela va bien, mais à l'arrêt nous sommes dans un four. Arrêt en rase campagne dans un petit restaurant , où la nourriture à base de riz et poulet est très bonne et surtout pas épicée. Nous prenons notre premier cours de thaï. Bosse de rire général, mais ils nous comprennent à moins qu'il s'agisse de politesse de leur part! Voilà le fruit de ce premier apprentissage: droite KWA, gauche SAÏ, toilettes OHN NHAM, très bien SABAÏDI KHRAP, combien ça coûte KHO LAY KHRAP...
Le son KHRAP revient très souvent dans de nombreux mots dont bonjour, bonsoir. Cela m'amuse et me sert de moyen mnémotechnique, car en albanais il signifie carpe.
Vers les quatorze heures nous repartons après un très bon moment passé dans ce petit restaurant au milieu de nulle part. La chaleur étouffante est immédiatement atténuée par le vent généré par le mouvement.
La campagne environnante n'a pas grand caractère, à cette période de l'année, le manque d'eau est évident, tout est jaune. Dans ce qui tient lieu de prés, pour le moins rabougris, quelques buffles et d'étranges vaches aux très longues oreilles, qui font plutôt penser au chien Pluto des dessins animés de Donald.
Bien que de loin en loin il y ait quelques mares, les moustiques semblent absents, pourvu que cela dure! Par contre les serpents manifestement sont bien présents, vu le nombre écrasés en bord de route. Christian me dit que dans le coin il y a des cobras, j'aurai du coup tendance à ne pas trop raser les herbes du bord de chaussée!
A seize heures nous arrivons à Kut Khaopun, je suis content de m'arrêter. En effet, ces derniers jours depuis notre départ de Lyon, n'ont pas été de tout repos. De plus mon entraînement n'est pas terrible, je n'ai pratiquement pas fait de vélo depuis septembre. Après quelques recherches un jeune Thaï nous conduit un peu en dehors du village dans un endroit assez extraordinaire, chez un Allemand qui tient une Gest House depuis trois ans. Il possède une grande mare dans laquelle se cachent quelques monstres. Je me précipite avec ma canne à pêche, essayant différents leurres, mais les monstres ne se laisseront pas abuser.
J+5 Kut Khaopun à Don Tan 85 km

Sur la photo à droite Christian et à gauche un locataire à temps complet de nationalité allemande. Ce dernier nous fournit gentiment des photocopies de sa carte plus détaillée que la notre.
Ce matin nous démarrons à neuf heures, quittant notre Allemand et sa compagne thaïe par un revoir appuyé. Rendus trop sûrs de notre navigation de la veille sans problème, nous commençons la journée en prenant la mauvaise route. Nous avons été induits en erreur par le fait que toutes les routes ne figurent pas sur la carte, mais comment peut-il en être autrement avec une carte d'une telle échelle? Il nous aurait suffi de chercher le numéro des routes sur les bornes et aux carrefours importants. Après quatre kilomètres nous réalisons notre erreur, car la direction prise est plein est au lien du nord.
La chaleur est importante, jusqu'à 38 degrés, et nous avons un léger vent de face. Vers quatorze heures, arrêt dans une minuscule échoppe, où nous dégustons une soupe locale à base de pâtes chinoises de viandes et de boules blanches à la composition indéterminée. C'est très bon, d'autant que le bouillon regorge d'une multitude d'herbes aromatiques très goûteuses.
Cette heure passée à l'abri du soleil particulièrement ardent nous requinque. Au moment de partir je demande l'autorisation de faire une photo de la cuisinière devant son fourneau. Immédiatement son mari et sans doute son fils arrivent en riant, et tous trois se mettent au garde-à-vous pour la prise de vue.
Nous reprenons notre chemin à travers une campagne desséchée et nous rejoignons la route qui longe le Mékong. Hélas ce dernier nous reste caché.
Arrivés à Don Tan, on nous indique un hébergement pour la nuit. Nous débouchons sur le fleuve, situé quelques mètres en contrebas. Il nous apparaît dans toute son immensité. Fantastique, je l'évalue à au moins 700 mètres de large (en réalité plus d'un kilomètre). Des pêcheurs en pirogue au milieu semblent minuscules. Leur embarcation ressemble à une brindille.
Le gîte nous est proposé, mais pas le couvert. Ayant déposé nos bagages, nous reprenons nos vélos, et nous voilà repartis pour le marché au milieu du village. Nous sommes un peu l'attraction. Nous achetons deux belles mangues, deux salades composées mélange de différents légumes et des brochettes proposées par une petite fille adorable à l'air un peu effarouché. Nous passons un moment très agréable au milieu des vendeurs et vendeuses qui s'esclaffent, lorsque nous essayons de prononcer des mots en thaï. Je vais apprendre un mot indispensable: kao, le riz.
J+6 Don Tan à That Phanom 86 km
Nous commençons à nous installer dans le voyage. Au stress des premiers jours, dû au transport, aux craintes que nos vélos soient abîmés au cours des manipulations de chargement et déchargement, et aussi du fait des deux jours passés dans cette ville géante de Bangkok, succède un mode de vie plus en harmonie avec nos aspirations.
Nous quittons notre gîte au-dessus du Mékong d'où nous avions un point de vue remarquable. L'étape de ce jour va se passer sans incident. Elle sera ponctuée d'un très bel arrêt dans la ville de Mukdahan, qui possède un magnifique temple juste au-dessus du Mékong.
Halte vers midi en bordure de route pour déguster des spécialités locales, excellents légumes, très bien cuits et macérés dans un jus, toutefois un peu épicé!
Nous arrivons vers seize heures à That Phanom. Rapidement installés dans un hôtel en bordure du fleuve, nous partons visiter ce fameux stûpa de 55 mètres de haut, l'un des principaux lieux de pèlerinage de Thaïlande. Il est vraiment époustouflant!
Nous finissons la soirée dans un restaurant tout au bord du Mékong, la nuit s'est installée. L'eau ne reflète rien,devant nous un kilomètre de néant et tout là-bas dans le lointain, les lumières de villages laotiens de l'autre côté de la frontière.
Ce matin départ matinal, 7h30. Nous espérons de la sorte limiter notre temps de pédalage par grosse chaleur. Les berges de la petite ville de That Phanom sont ce matin envahies par les échoppes des commerçants du marché laotien, qui se tient deux fois par semaine. Avec nos vélos nous avons du mal à nous frayer un chemin dans cette masse humaine compacte. Mais ce moment d'immersion au milieu d'une foule n'a rien de désagréable.
Les cinquante premiers kilomètres, qui nous conduisent à la ville de Nakhon Phanom, se déroulent le long d'une autoroute. Mais la circulation n'est pas très importante, et une large bande est à la disposition des deux roues. La monotonie du trajet est ponctuée à quelques reprises de vendeuses d'ail.
Après une vingtaine de kilomètres nous visitons un temple et assistons à un office autour d'un grand stûpa.
Trente kilomètres plus loin, la ville de Nakhon Phanom. Elle possède une magnifique esplanade, bordée d'un côté d'une multitude de temples plus beaux les uns que les autres et de l'autre par le fleuve. Nous avons une très belle vue sur les montagnes laotiennes sur la rive gauche du Mékong. Pris par le charme de l'endroit, nous effectuons un arrêt prolongé, et dégustons un ananas doux et sucré bien installés sur la promenade. Je suis étonné par la quantité de temples en si peu de distance. Ils sont tous remarquablement entretenus.
Vers treize heures nous effectuons les trente derniers kilomètres qui nous amènent à notre étape du jour Tha Udhet. Petite ville alanguie auprès du Mékong. Un marché très dense propose une multitude de poissons du fleuve, en particulier de grosses carpes à écailles et des silures.
Cette étape semble ignorée des chemins touristiques, nous n'avons vu que deux Occidentaux. A chaque fois il s'agissait d'un homme accompagné d'une jeune asiatique d'une vingtaine d'années. A proximité de notre hôtel, nous rencontrons un jeune Camerounais qui est professeur d'anglais dans les environs.
J+8 Vendredi 18 Tha Uthen à Bung Khla 124 km
Départ à 7h30. L'étape du jour va se dérouler le long d'une route monotone, où cependant nous avons éprouvé du plaisir à pédaler. Nos corps s'habituent à la chaleur et nous ne trouvons plus qu'il fait si chaud, alors que le thermomètre indiquait 35 degrés.
En démarrant de notre hôtel, dans la rue qui nous conduit au Mékong, nous tombons sur notre professeur d'anglais camerounais, avec qui nous avions discuté hier soir. Il s'appelle Dieudonné. A cette heure matinale, il s'apprête à emmener ses élèves à l'école.
Il y a beaucoup d'eau de part et d'autre de la route. Nous nous sommes arrêtés sur un pont pour regarder des élevages de poissons.
Un peu plus loin, nous avons été attaqués, non par un cobra ou un naja, mais par un ichtyosaure. Christian, un moment en mauvaise posture a réussi à maîtriser la bête, en véritable Indiana Jones qu'il est!
Vers treize heures, tout juste à 100 kilomètres de notre point de départ de ce matin, nous avons mangé comme des ogres dans une petite échoppe en bordure de route. Les abords ne faisaient pas très net, mais en définitive, ce fut excellent et nous avons mangé deux plats chacun, soupe aux pâtes chinoises et riz assaisonné de succulentes plantes aromatiques. On nous sert en condiment de grandes branches de basilique frais, un délice. Nous avons goûté au "pork fish", poisson cochon, en boules dans le bouillon. Cela a un peu la consistance de la quenelle, en plus ferme et avec une saveur nettement plus relevée.
Nous avons repris la route vers quinze heures, bien requinqués. Tellement bien d'ailleurs que nous sommes partis comme des fusées et avons dépassé notre point de chute de plusieurs kilomètres, ce qui nous a obligé à faire marche arrière. Le cap des cinq cents kilomètres est passé.
Cette nuit nous logeons dans un hôtel perdu en pleine campagne juste au-dessus du Mékong.
J+9 Samedi 19 Bung Khla à Pak Khat 96 km
Une fois de plus nous pouvons admirer le fleuve au réveil, chaque jour le spectacle est différent.
Ce matin comme les jours précédents nous démarrons le ventre presque vide. Aujourd'hui, contrairement aux fois précédentes, impossible de se faire chauffer quoi que ce soit. Avec l'eau chaude de la douche on se concocte un semblant de café crème. Durant les vingt premiers kilomètres, nous suivons une route très agréable qui ne figure pas sur notre carte. On traverse de grandes forêts d'hévéas, équipés pour la récolte du latex. Un petit gobelet, comme pour la résine dans les Landes, et au pied une demi-sphère de latex au sol, en attente d'être ramassée.
Nous retrouvons notre fameuse nationale 212, qui commence à être une vieille connaissance. Bien que les abords ne soient pas très propres, le panorama monotone et la circulation assez importante et de plus les véhicules roulant souvent vite, et bien nous prenons plaisir à pédaler le long de ces immenses lignes droites.
Vers dix heures trente, nous nous arrêtons pour acheter quelques bananes. Le compteur indique 48 kilomètres et d'un coup nous réalisons que nous avons faim. Nous n'allons pas prendre uniquement des bananes, mais aussi pas mal d'autres choses, dont un magnifique poulet à la braise. Il est préparé de façon particulière (cf la photo). En tout cas c'est excellent. Nous allons rester assis à nous empiffrer de tout ce qui nous tombe sous la main dans cette échoppe durant une bonne heure et c'est repus que nous remontons sur nos vélos pour effectuer les 50 kilomètres restants.
Bien requinqués, le ventre rebondi, il nous faut quelques distances pour reprendre notre vitesse de croisière. Nous longeons un étrange parc dans lequel fleurissent d'immenses blocs de grès. Intrigués nous le visitons. Nous ne serons pas déçus, car la visite conduit au bord même du Mékong, dans un coin charmant.
Nous effectuons ensuite les derniers 25 kilomètre de la journée. A l'arrivée à Pak Khat, un hôtel adorable nous accueille, avec piscine et une vue merveilleuse sur le Mékong.
Un rêve se réalise. Je lance pour la première fois ma canne dans ce fleuve fabuleux. Bien évidemment, je m'imagine une foule d'énormes poissons grouillant de toutes parts, n'attendant que mon hameçon. Je dois bien avouer que la réalité est toute différente. D'abord je n'ai pas eu de touche, et puis j'ai accroché et ma belle cuillère ondulante à sandre, bien sûr je l'ai perdue. Cependant le plaisir fut intense.
Le repas du soir sur la terrasse face au fleuve, qui a disparu dans le grand trou noir de la nuit, est très agréable, et pour ne rien gâcher, il n'y a pas un seul moustique.
J+10 Dimanche 20 Pat Khat à Nong Khai 90 km
Pour la première fois depuis notre départ nous avons eu un petit déjeuner copieux, café, tartines, pain, beurre, confiture, beignets et une délicieuse soupe vietnamienne à base de pâtes chinoises et d'herbes aromatiques.
On se sent nettement mieux de partir le ventre bien plein, et pas seulement en ayant ingurgité trois petits biscuits avec un peu d'eau dans laquelle le café en poudre fait de gros grumeaux!.
Sur la distance qui nous sépare de Nong Khai l'itinéraire suit la nationale 212. Le rythme est soutenu et en quatre heures nous effectuons les 90 kilomètres qui nous conduisent au cœur de cette petite ville au bord du Mékong. Le plaisir de pédaler est immense lorsqu'on avance de cette manière à une moyenne élevée, bien que le panorama ne présente pas grand intérêt, à part à de rares occasions la vue sur des champs de riz au joli vert tendre.
Durant cette étape sans point caractéristique, juste à mi-parcours nous avons eu la chance d'assister à un match de foot d'éléphants ainsi que d'admirer des champignons géants!
Mon compteur affiche 697 kilomètres depuis Bangkok. Demain lundi nous allons faire une pause et prendre le temps de nous balader tranquillement le long du fleuve et dans le vaste marché couvert, en attendant de reprendre notre périple en direction des montagnes du nord de la Thaïlande.
Ce soir succulent repas au bord du Mékong, une multitude de crudités dont certaines assez épicées mais pas trop, un régal. Je vous laisse admirer la photo.
J+11 lundi 21 repos à Nong Khai
Ce matin lever tardif, pas de préparation de bagages à arrimer sur le vélo en se dépêchant pour profiter au maximum des quelques heures de températures relativement clémentes. Nous partons nous promener à travers la ville vers un grand marché, où l'on expose une multitude d'objets en tek, superbes.
Nous retournons au bord du Mékong. Dans son immensité trouble se cachent des monstres de grande taille.
Dans l'après-midi, nous testons le massage thaï, une heure pour moins de cinq euros. Pendant une heure on se fait malaxer dans tous les sens à coups de tranchant de la main, de poings, de pieds, de coudes,de genoux. On se fait tordre de haut en bas , de gauche à droite, et droite à gauche, on nous presse les membres, on nous les étire, nos pieds sont tordus avec vigueur. Parfois ça fait mal, parfois ça chatouille. Le résultat est sans appel. Nous partons de notre séance en ayant laissé toutes nos douleurs sur le tapis.
Le soir vient doucement sur le fleuve qui est d'huile. Au loin, on distingue le pont de l'amitié qui permet d'accéder au Laos.
J+12 Nong Khai à Sangkhom 84 km
Départ matinal, le ventre vide. Vingt kilomètres plus loin nous trouvons un petit commerce qui nous propose thé et café avec une omelette. Il était temps.
La route devient plus petite, avantages et inconvénients. Avantages, les abords sont plus jolis et le tracé est souvent à proximité du fleuve, offrant de beaux points de vue sur les berges sablonneuses. Inconvénients, chaussée plus étroite, donc les voitures nous serrent de plus près, mais en général les conducteurs sont très corrects.
Sur la route, quelques plantations de tabac, et aussi, je suis désolé Bertrand mais un pêcheur a surgi avec un énorme poisson chat ou quelque chose de ressemblant, tout du moins en ce qui concerne la tête.
Je suis tout surpris de constater que nos étapes de plus de 80 kilomètres nous les effectuons rapidement. Aujourd'hui à midi nous sommes arrivés à notre but, un adorable site de cabanes dominant le Mékong. Nous avons chacun la nôtre, elles sont ouvertes aux quatre vents, mais heureusement les lits sont équipés de moustiquaires.
Demain nous devrions encore avoir une étape à peu près plate, puis la montagne commencera.Nous allons contourner la pointe du Laos qui s'enfonce en Thaïlande et ensuite remonter vers le nord tout en longeant la frontière.
Sur la carte on peut voir notre itinéraire d'aujourd'hui de Nong Khai à Sangkhom et celui de demain jusqu'à Chiang Khan.
J+13 Mercredi 23 Sangkhom à Chiang Khan 103 km
Ce matin, je suis sorti de ma cabane avec en spectacle un magnifique lever de soleil sur le Mékong.
Nous avons eu droit, une fois encore à un petit déjeuner avec tartines, beurre et confiture.
Vers les 8 heures nous nous sommes mis en route. L'itinéraire passe au plus près du fleuve. Les points de vue y sont nombreux et variés. Par endroits le fleuve semble se perdre, puis plus loin de nouveau il est plus important.
Un peu après 80 km il est midi, et nous faisons arrêt là où nous voyons des gamelles chauffer. Une bonne ration de pâtes chinoises accompagnées de verdure du genre épinard, avec en dessert une canette de café froid, le tout pour 75 centimes d'euro par tête. En prime les femmes dans cette petite échoppe étaient très gentilles.
Nous arrivons vers les 14 heures dans la petite ville de Chiang Khan, très pittoresque avec sa rue le long du fleuve, bordée de magnifiques maisons de bois.
Demain nous allons changer de décor et rentrer dans des zones plus reculées, où les logements seront sans doute plus difficiles à trouver. Nous n'écartons pas l'option tente, et pour la première fois nous avons fait quelques provisions.
La prochaine petite ville se trouve à plus de 300 km, Nan, et les dénivelés seront sans doute conséquents, car la montagne arrive. Nous allons continuer à descendre au sud ouest le long de la frontière encore une centaine de kilomètres, puis nous reprendrons la direction du nord, après avoir contourné cette protubérance laotienne en territoire thaï.
J+14 jeudi 24 Chiang Khan à Ban Nong Phue 53 km
Nous allons quitter le Mékong après une quinzaine de kilomètres. Nous le retrouverons dans deux semaines lors du passage de la frontière au nord du pays. La route devient plus étroite, la circulation peu dense. Mais l'état de la chaussée n'a plus rien à voir avec ce que nous avons connu depuis notre départ. Une multitude de gros nids de poule nécessitent une attention permanente.
Un petit incident mécanique nous fait perdre un peu de temps. Il s'agit en fait d'une belle chute de l'un d'entre nous. Vol plané par dessus le vélo, le casque fendu, mais à part des égratignures de partout rien de sérieux! Mais cela nous permet de constater la grande serviabilité des Thaïs. Immédiatement le blessé est emmené en mobylette chez le médecin du coin, qui le soigne remarquablement bien. Une heure plus tard après cette séance chez le toubib et la réparation du vélo qui a aussi subi quelques dégâts nous reprenons notre route.
Les premiers raidillons qui font la réputation du nord de la Thaïlande apparaissent. Il fait chaud, vers les trente degrés mais tout se passe bien.
Vers les 13 heures nous faisons une erreur d'itinéraire et aboutissons dans un petit village complètement enserré en territoire laotien. D'ailleurs, il est en partie habité par des Laotiens, certains parlent quelques mots de français.
Nous trouvons de quoi nous loger dans de très bonnes conditions à 500 bats, ce qui fait 12,5 euros, cher pour le coin, mais pas pour la prestation. Par contre en matière de nourriture c'est beaucoup plus difficile. L'épicerie vend de la bière des chips et des œufs. Nous arrivons à nous en faire faire trois au plat chacun, ce qui nous tiendra de repas du soir.
J+15 vendredi 25 Ban Nong Phue à Ban Mueng Phrae 72 km
Lever matinal, petit déjeuner à partir des provisions que nous avons faites à Chiang Khan. Départ à 7h30. Les premiers trente kilomètres sont rapidement parcourus, on se prend à espérer des distances comme les jours précédents le long du Mékong. Mais une première côte, qui n'est que la première va nous révéler la vraie topographie des routes du coin. Un départ à 12%, avec des passages de plus de 15%. Ce que l'on vient de monter péniblement nous le redescendons dans la foulée et la prochaine côte infernale est là. Nous finirons à plusieurs reprises à pied à pousser les vélos. D'ailleurs en ce qui me concerne je vais plus vite à pied qu'à vélo dans ces cas. A pied 4,5 km/h, et à vélo je tombe à 3,5. La chaleur est très forte. Je bois trois litres d'eau au cours de ces montées. Heureusement j'avais prévu large, trois bouteilles d'eau d'un litre et demi et une bouteille de coca. Les pentes sont plus raides que celles que j'ai connues en Équateur, et qui représentaient mon expérience la plus difficile à vélo. Il ne reste plus qu'à attendre les prochaines étapes pour voir si la tendance se confirme.
On commence à se poser des questions. Aurons-nous ce type de terrain sur les 600 km qui nous séparent de la frontière?
Vers 13h30 nous arrivons à Ban Mueng Phrae et trouvons un logement très honorable, mais encore à 500 bats. La proximité des parcs nationaux doit avoir une influence sur les prix. Après nous être installés, nous retournons au village pour déjeuner, bien qu'il soit plus de 14h30. Dans une petite échoppe repérée en passant on nous sert une succulente soupe avec du poulet. Nous sommes affamés, on en redemande.
Ce soir le compteur affiche plus de 1000 kilomètres, ça ne veut pas dire grand chose mais c'est quand même bon pour le moral!
J+16 Samedi 26 Ban Mueng Phrae à Ban Rom Klao 41 km
Après une nuit agréable nous prenons la route vers 7h30. On espère que la journée sera moins difficile que la précédente. Immédiatement la première immense côte nous enlève tous nos espoirs. J'ai vraiment la sensation de rester coller au goudron. Ma vitesse tombe par moments à 3,5 km/h. C'est la limite de l'équilibre, et pour rester sur le vélo, il me faut jouer du guidon.
En cinq heures nous ne parcourons que 41 kilomètres. On commence à comprendre que ce que nous avons lu sur les redoutables pentes de la montagne thaïe n'était pas exagéré.
Au cours de ce parcours nous traversons de grandes zones aux collines couvertes de champs d'ananas. A cette période de l'année la récolte bat son plein. Partout des tracteurs chargés de centaines de gros ananas peinent le long de la route. Nous décidons de nous arrêter pour en acheter un et le dévorer sur place, car nous sommes affamés et assoiffés. La paysanne qui manipule son énorme tas de fruits en choisit un bien mûr, de deux kilos, et nous le découpe en belles tranches avec dextérité à l'aide d'un coupe-coupe. Il est absolument succulent, un jus chaud abondant et très sucré nous procure un grand plaisir. Au moment de payer elle refuse catégoriquement. Christian donne un paquet de cacahuètes à son fils. Au moment d'enfourcher nos vélos elle nous donne à chacun un grand sac rempli de tranches d'ananas. Nous ne pouvons pas refuser et nous voilà partis, chacun avec un bon kilo en plus!
A midi au sommet d'une énième pente infernale, nous nous arrêtons pour déjeuner dans une petite échoppe comme souvent. Un jeune homme parle bien l'anglais. Nous lui demandons où loger. Il nous accompagne avec son cyclomoteur à une guest house, soit disant à 1km, en réalité il y en a trois. Mais les deux derniers empruntent une petite route qui monte littéralement dans le ciel. la pente moyenne est bien à 15% avec des passages à 20%. Il est 14h, nous venons juste de manger et la température est supérieure à 30 degrés. Ces deux kilomètres que nous gravirons en grande partie en poussant les vélos nous laisseront des souvenirs impérissables. Jean va bien comprendre, quand je compare cette épreuve à la montée chez Emmanuel en Équateur, pour aller au pied de l'Imbabura.
Une fois arrivés à cette fameuse guest house, on nous dit que la seule chambre de l'établissement n'est pas disponible. Nous sommes donc montés pour rien!
A ce moment le jeune homme nous dit que sa maison est à notre disposition. Nous redescendons donc au village et nous rendons chez lui. Son village est étonnant. Un peu en retrait de la route, tout en longueur, les maisons de bois sont alignées de part et d'autre de la rue unique. Une multitude d'enfants déambulent à même la chaussée. Les quelques véhicules, de gros 4x4 ou des tracteurs roulent au pas et manifestement les enfants n'ont rien à craindre. Il s'agit d'un village de l’ethnie hmong.
Nous sommes reçus un peu à la manière d'autorités. Le maire vient nous saluer et nous sommes invités à manger le soir en se présence. La discussion au cours du repas sera très instructive. Les Hmongs de ce village à la frontière du Laos,sont tiraillés entre les deux pays, chacun des deux gouvernements revendiquant ce territoire. Il y a quelques dizaines d'années en ce lieu des combats particulièrement meurtriers se sont déroulés entre les armées thaïe et laotienne. Le maire se souvient aussi dans sa jeunesse des avions américains qui survolaient le village en route pour aller bombarder le viet minh au Laos.
J+ 17 Dimanche 27 Ban Rom Klao à Ban Khok 70 km
Au cours de la nuit des pluies très violentes s'abattent pratiquement sans discontinuer. Comme par miracle, à 7 heures, le village s'éveille et la pluie s'arrête. Nous petit-déjeunons avec notre jeune homme, qui s'appelle Lee, et sa famille. L'alimentation est hmong, à base de riz et de salade cuite, très énergique pour la journée qui nous attend.
A 8h30 nous prenons congé de ces gens qui ont été si gentils, et bien évidemment ils refusent tout argent. Je ne sais plus qui a dit que le voyage c'était le plaisir de la découverte de l'autre et le déchirement de l'adieu. Ce sont bien les sentiments qui nous habitent en ce moment.
Très vite la route reprend le dessus. La chaussée est encore très mouillée, par endroits de nombreux végétaux au sol témoignent de l'importance des précipitations des dernières heures. Ce matin la montagne couverte d'une forêt très dense aux arbres gigantesques, toute nimbée de bandes de brume prend des airs mystérieux. Pas un véhicule, on a l'impression que les habitants ont disparu. Nous sommes en altitude vers les 800 mètres. Ce spectacle rappelle Pierre Schoendoerffer et son livre là-haut, dont la couverture représente justement cette forêt des hauts plateaux baignée de brume.
Peu de montée, très vite de longues descentes vont nous conduire dans la plaine. Nous retenons notre vitesse, non seulement du fait de la chaussée détrempée, mais aussi parce que nous sommes sous le charme de ce coin reculé, toujours imprégnés des paroles de ces villageois hmongs qui nous ont hébergés, et qui nous ont parlé avec amour de leur forêt, de la cueillette du miel tout en haut des cimes de ces grands arbres perdus dans le brouillard.
Une fois dans la vallée, la végétation change radicalement et nous longeons des taillis aux arbres rabougris tout desséchés par le manque d'eau. Mais notre moyenne reprend de la consistance. Encore une petite échoppe en bord de route pour le repas vers les 13 heures. Un groupe d'enfants, plutôt d'adolescents, déjeunant est tout intrigué de voir ces deux farangs, à l'air de papis mal rasés à la barbe blanche, arriver sur des vélos surchargés. Ces jeunes thaïs sont absolument magnifiques et toujours souriants.
Après 70 km nous arrivons devant une guest house à l'accueil superbe par une femme qui nous offre un petit saladier de fruits locaux. Dix minutes plus tard son mari, qui parle très bien anglais, nous en apporte encore une assiette. Je lui montre la corbeille en lui disant que sa femme vient de nous l'apporter. Il repart avec son assiette en riant comme un bossu, mais me prévenant que c'est bon mais laxatif.
Il y a un étang. Après avoir demandé la permission je me précipite pour y pêcher. A plusieurs reprises des poissons de grosse taille suivent mon leurre, mais ne s'en saisissent pas. Le repas du soir est un régal, multitude de plats, légumes et viandes variés. Bien que les efforts de la journée par grande chaleur soient intenses et nécessitent beaucoup d'énergie, j'ai bien peur que je ne maigrisse pas et que je rentre aussi lourd que je suis parti!
J+18 Lundi 28 Ban Khok à Na Noi 92 km
Encore une fois il a bien plu cette nuit. Nous nous levons tardivement vers les 7h30. La maîtresse de maison nous a préparé un petit-déjeuner gargantuesque. A 8h45 nous partons après avoir fait quelques photos avec ce couple particulièrement accueillant.
Les vingt premiers kilomètres sont plats, puis les 70 suivants sont constitués d'une série de montées et de descentes raides. Nous allons souffrir. La zone est complètement vide d'êtres humains. Nous traversons d'immenses forêts, qui par moments font penser aux routes de la Sainte Baume en automne.
A 16h nous arrivons sur un sommet de 1300 mètres d'altitude après une interminable montée à 10% et plus. En 17 kilomètres d'une descente de rêve à grande vitesse nous atteignons Na Noi.
Durant cette journée fatigante dans une zone abandonnée des hommes, à part quelques checks points militaires, nous n'avons traversé qu'un minuscule village, où cependant j'ai pu me ravitailler en boisson. Mais ce que je retiendrai c'est son nom qui me plait particulièrement: BAN DEN CHAT!
J+19 Mardi 29 Na Noi à Nan 59 km
Hier soir étant arrivés tard, nous nous sommes rapidement mis à la recherche d'un endroit pour dîner. Il ne faut pas traîner car à 19h tout est fermé et les rues sont désertes. Nous tombons rapidement sur un restaurant à la grande salle vide et à l'aspect patibulaire. Mais mieux vaut tenir! Nous nous installons et la serveuse nous propose un menu auquel nous ne comprenons rien. Christian va regarder dans la cuisine. Paraît-il c'est un vrai capharnaüm. Quelques minutes plus tard les plats arrivent. Sublime, un mélange de légumes de poulet et de riz, que des petits morceaux très goûteux.
Une fois de plus le logement était de tout confort.
Ce matin nous redoutons les séquelles de la séance d'hier où nous avons pédalé dans des conditions éprouvantes six heures et demi. Mais non, dès que nous roulons le plaisir est là, et l'envie d'abattre les kilomètres intacte. Cette sensation d'être sur la route à vélo est quelque chose d'étrange. Généralement en voiture les déplacements sont les moments incontournables que je trouve particulièrement ennuyeux en voyage. Alors qu'à vélo la route, même s'il s'agit d'une nationale passante, constitue l'essence même du voyage. Y-a-t-il quelque chose à comprendre?
Donc cette grande route présente des montées et des descentes comme nous en avons l'habitude depuis maintenant 500 km, mais les pourcentages de pente restent raisonnables. De grands champs de riz nous accompagnent et nous effectuons cette courte distance en un peu plus de trois heures.
Nan, cette ville est quasiment inconnue de notre guide routard. On s'attend à un endroit lugubre et sans intérêt. Nous découvrons une petite ville au charme certain. Une guest house adorable en centre ville dans une petite rue calme nous accueille, et de plus le prix est particulièrement doux, cinq euros chacun, pour une chambre d'un très bons standard. Non Danielle, je te vois sourire, il ne s'agit pas du trou sordide au fond des Andes où je me trouvais comme un nabab!
Vite installés nous partons déjeuner dans un établissement qui une fois de plus nous sert des mets succulents, voir photos.
Puis l'atmosphère paisible de la cité nous pousse à flâner. Un temple merveilleux aux sculptures extraordinaires nous offre un moment merveilleux.
Nous trouvons enfin un petit bistrot qui nous sert un café doux à souhait. Nous sommes de vrais nababs dans cette petite ville négligée de notre guide. De plus dans ce café il y a des tas de livres d'occasion dans les principales langues européennes. J'en profite pour en acheter un en anglais qui va très certainement me passionner: Tracks, il s'agit du récit d'une femme qui en solitaire a traversé l'outback australien.
J+20 Mercredi 30 de Nan à Chaiang Muan 70 km
Bonjour tout le monde. Mais au fait c'est qui tout le monde? En effet, depuis trois semaines nous n'avons eu que cinq messages sur notre blog. Snif! Merci à ceux-là et aussi à ceux qui nous lisent? Si vous ne savez pas comment nous faire un petit coucou, je vous explique: en bas de cette page, se trouvent deux lignes en orange, parmi les différentes informations, vous voyez commentaires. Vous cliquez dessus, ce qui fait apparaître les commentaires déjà écrits, et au bas de ces commentaires il y a l'emplacement afin que vous mettiez votre contribution, bien sûr si vous le voulez! Mais sachez que cela fait plaisir, car si nous sommes partis plein d'envie de jouer les Indiana Jons dans les forêts du Laos c'est toujours triste d'être loin de ceux que l'on aime. Et un petit coucou donne du baume au coeur!
Bonjour Mélody, je vais répondre à ta question: concernant ces deux derniers plats que l'on voit, bien évidemment que c'était très bon. Concernant le premier il s'agit d'une belle omelette posée sur une belle montagne de riz à laquelle on a mélangé de petits bouts de poulet et une multitude d'herbes aromatiques, toutes plus goûteuses les une que les autres. Leurs arômes se mélangent et cela donne une explosion de saveurs en bouche, un régal! Quant au second, il s'agit d'une salade composée de multiple légumes crus mais déjà un peu cuits dans le piments ou plutôt les différents piments de la recette. En effet, ils ont en Thaïlande cinquante mille façons d'allumer de gigantesques feux dans la bouche, mais ma foi, c'est un peu ou peut-être très fort, mais c'est bon. D'autre part le piment ça tue les microbes!
Mais je ne t'ai pas tout dit. En effet, le soir on a mangé une soupe merveilleuse, au bouillon assez épais et sucré, au milieu duquel encore une fois une multitude de légumes, très différents du fait de leur consistance, de très tendre à très ligneuse, donnaient un goût merveilleux à cette soupe. Et puis pour finir, on a mangé une énorme glace à la vanille, avec des fruits confits. Ces derniers sont surprenants, car ils deviennent de plus en plus consistants à mesure qu'on les croque.
Bon, quand même je ne te cacherai pas, que la glace à la vanille de chez Bernachon, que je vais de temps en temps manger avec ma tante et Danielle est meilleure. Mais quand je vais chez Bernachon je ne suis jamais tombé sur un "super copain chat"!
Cette journée commence sous les meilleures augures, en effet nous petit-déjeunons avec jambon, bacon, café, tartines, beurre et confiture, ça nous change un peu du riz.
Bien repus, nous quittons cette petite ville qui nous a beaucoup plu; les vingt premiers kilomètres sont "tranquilles" et puis la Thaïlande se rappelle à nous par ses incessantes montées, qui n'en finissent pas de s'accentuer au fur et à mesure que l'on monte. Je verrai même un camion zigzaguer pour franchir les derniers mètres d'une énième côte à plus de 10%.
Cela va durer 25 kilomètres, avec des passages en terre. Il est très étonnant de constater que cet effort ingrat à 5 km/h, je tombe même à 3,5, génère un vrai plaisir, dans cette fournaise. L'esprit est tendu vers le but du soir à atteindre, et vers le but final, qui dans le cas présent est notre point de départ, après une boucle de plus de 4000 km. Mais qu'importe le but, il n'y a que le chemin qui compte (Saint-Exupéry). Sur le chemin on y est en plein, la route qui nous attire et ne nous lâche plus. Je transpire à grosses gouttes, presque à flot continu le long de ces interminables rampes, qui ne montrent jamais leur fin, car derrière chaque virage on monte toujours plus. Il y a une très belle chanson qui parle justement de la route:
http://www.youtube.com/watch?v=tKCPIo9U_Qs
Vers midi nous faisons halte et comme toujours une bonne assiette consistante nous remet de nos efforts du matin. Nous n'avons plus que 25 kilomètres à accomplir. On démarre plein de vigueur, Christian part devant. Après cinq kilomètres un cliquetis inquiétant me fait réaliser que j'ai cassé l'un des rayons de ma roue arrière. Je n'ose plus pédaler en côte de peur d'aggraver le problème avec une casse en chaîne de rayons. C'est donc en courant et poussant mon vélo que je monte. Au sommet de la dernière grande descente vers notre but Christian m'attend. On tente une réparation, j'ai bien des rayons de rechange, mais pas l'arrache-moyen indispensable car la pièce cassée s'encastre du côté des pignons. Donc suite à cette échec, relativement doucement je me laisse glisser jusqu'au village. Là personne en mesure de réparer. Que faire? Nous décidons que demain le plus tôt possible nous prendrons le bus avec montures et bagages pour la grande ville la plus proche, dans l'espoir de trouver un réparateur vélo. Il s'agit de Phayao, ville située une centaine de kilomètres à l'ouest un peu sous le triangle d'or. Pour ajouter au désagréable de cette fin de journée, je m'entaille profondément l'index droit avec le loquet de la porte de la salle de bain de notre guest house. Durant plusieurs heures la plaie saigne fortement dès que je fais un mouvement. Je vous rassure, au moment où j'écris, cette belle entaille est en très bonne voie de cicatrisation.
J+21 Jeudi 31 Phayao en bus
Six heures le bus part. il fait nuit, tout est détrempé, il est tombé des cordes toute la nuit. Pour la saison sèche ça nous semble bien mouillé. A huit heures nous arrivons. Très vite nous trouvons un très bon hôtel, à un prix dérisoire 5 euros chacun, et pourtant avec tout le confort, en particulier une magnifique salle de bain. Nous nous mettons immédiatement à la recherche d'un réparateur vélo. Pas facile à trouver car les deux roues nombreux sont surtout des cyclomoteurs. Mais, malgré la barrière de la langue, avec l'aide de la population nous localisons assez rapidement notre sauveur. Très méticuleux, il accomplit le travail de façon remarquable et me dévoile ma roue parfaitement. Il me demande pour cela 50 bats soit 1,25 euro. Je lui tend un billet de 100 bats et il me remercie lorsque je lui dit de ne pas rendre la monnaie. Pour ma part c'est au centuple que jue le remercie.
Nous passons notre journée à nous promener dans tous les recoins de la partie animée de la ville, grands magasins, marchés couverts et petites échoppes en bordure de chaussée, sans oublier de goûter à un excellent jus de mandarines!
J+22 Vendredi 1février Chiang Rai en bus
Merci d'avoir répondu à notre demande de "petit coucou". Ce matin nous quittons Phayao pour Chiang Rai, 90 kilomètres plus au nord, toujours en bus. On y prend goût! Il s'agit d'un tronçon de 90 km d'autoroute, pas très agréable à vélo, même si en Thaïlande les automobilistes, chauffeurs de car et camions ainsi que les deux roues à moteur sont très attentifs aux vélos.
Au cours des transports, que ce soit en avion ou en bus, le démontage des vélos est toujours un moment pénible. Eh bien! aujourd'hui, pas de tracas, le chauffeur nous aide à monter nos vélos complets dans son bus. Nos montures tiennent donc la place des six sièges à l'arrière du véhicule. Mais contre-partie de l'opération, puisque les six sièges ne sont plus disponibles, au moment de payer, la charmante jeune fille qui se déplace de passager en passager, peu nombreux, nous demande tout simplement de payer huit places, de manière certes un peu déguisée, 150 bats par vélo et 50 bats par passager, ce qui fait 400 bats pour deux. Mais, il faut relativiser, le tout ne fait que 10 euros, chacun de nous deux avec son vélo débourse 5 euros pour 90 kilomètres. Ne pas oublier que le prix du carburant est comparable à celui pratiqué en France.
Vers les 10h30 nous atteignons notre destination, très prisée des Occidentaux. A tous les coins de rue nous entendons parler français. Durant trois semaines nous n'avons pratiquement pas vu d'Occidentaux et d'un coup forte concentration.Les guides touristiques doivent avoir une influence déterminante.Nous nous arrêtons au rond-point de la fameuse horloge dorée, afin de boire un café et de faire le point sur la direction à prendre.
Nous trouvons un point de chute agréable, bien que certaines odeurs en provenance d'un canal en mauvais état, nous titillent un peu les narines. Nous en profitons pour acheter l'outil permettant l'extraction des pignons sur la roue arrière en cas de nouvelle casse de rayon. Au passage le vélociste en profite pour nous affiner quelques réglages. Dans ce magasin, nous rencontrons un vrai baroudeur, qui est en voyage en solitaire avec son vélo pour 7 mois. Il vient de traverser L'inde. Puis après un passage en avion de Dehli à Bangkhok, il a remonté le pays par la frontière birmane. Ensuite il va descendre le Laos comme nous l'envisageons. Puis retour en Thaïlande par Paksé et là, il abat les 700 kilomètres qui mènent à Bangkok et prend un avion pour Chamonix le 7 mars, où il reprend son travail de paysagiste. Il fait des étapes journalières de 150 kilomètres!
Le soir nous nous donnons rendez-vous au marché de nuit. Une foule dense s'y presse. Il nous communique des renseignements sur les routes du Laos, qu'il connait bien. Nous dînons de produits de la mer frits, un peu gras.
Demain, nous séjournerons un jour supplémentaire dans cette ville, ce qui nous permettra de rester trois jours sans rouler. Puis nous monterons vers le triangle d'or, qui est d'après ce que j'ai compris, la zone proche des frontières Birmanie, Thaïlande et Laos. Ensuite en deux jours de vélo nous irons à Chiang Khong après notre boucle dans le nord. Le mardi 5 février nous passerons au Laos pour de nouvelles aventures. On nous les promet différentes et en particulier plus spartiates. Il faut bien dire que jusqu'à présent c'est le grand luxe!
Pour des raisons de commodité de lecture, afin d'éviter un dérouler fastidieux qui s'allonge au fil des jours, le récit de nos tribulations laotiennes je le relaterai dans un nouveau chapitre. Pour le lecteur, toujours le même lien, mais il accèdera directement au texte sur le Laos sans avoir à faire défiler la traversée de la Thaïlande. Mais il pourra toujours accéder à cette première partie thaïe qui se trouvera derrière le récit sur le Laos. Long à expliquer mais très simple dans les faits! Et l'informatique ce n'est pas mon truc! La Wifi sera sans doute beaucoup moins présente, donc des compte-rendus moins fréquents. Il sera temps de voir lorsque nous y serons.
J+23 Samedi 2 février Chiang Rai
Aujourd'hui dernier jour de repos, nous prenons nos vélos pour une petite balade, 30 kilomètres aller-retour pour aller visiter l'un des temples les plus originaux du pays, vraiment très étrange, on aime ou non. Regardez et pensez-en ce que vous voulez!
Bien évidemment en Asie, un grand temple est accompagné de bassins et que trouve-t-on dans ces bassins?
J+24 Dimanche 3 Chiang Rai à Chiang Saen 62 km
Aujourd'hui petite étape pas très difficile, nous faisons 62 kilomètres sans même nous en rendre compte, en moins de trois heures. Nous nous sommes arrêtés devant un drôle d'arbre, nous n'avons pas réussi à déterminer s'il s'agissait d'une ancienne souche pétrifiée, ou d'une construction artificielle. Si c'est le cas elle est vraiment magnifiquement réalisée.
En chemin nous rencontrons un cyclo en solitaire dans l'autre sens. Nous lui faisons signe de s'arrêter et nous discutons un bon moment. Il s'appelle Georges est catalan espagnol et roule depuis 6 mois. Il arrive d'Inde, où entre autre il a traversé L'Himalaya indien. il a trouvé cela absolument fabuleux, un mois et demi entre Cachemire, Ladhak et autres régions de haute altitude, avec un passage à 5400 mètres. Maintenant il rentre tout simplement en Espagne par la route et toute la ribambelle de pays à venir. La notion de fin de voyage est pour lui une idée abstraite qui n'a pas vraiment de sens!
Chiang Saen se trouve sur le bord du Mékong, nous le retrouvons avec plaisir. De nombreux bateaux transportent des marchandises à destination du Laos en face ou plus loin vers la Chine. Une activité intense se développe le long des quais et des immenses escaliers qui y conduisent. Les bateaux m'ont toujours donné une profonde idée de partance. Toutes ces embarcations, qui font de grandes courbes dans le puissant courant du Mékong, exécutent un ballet de toute beauté. Les dockers comme des fourmis s'affairent autour de lourdes charges.
Un petit chapitre pour Jérémy: dis-nous quelles sont les recettes qui t'intéressent et dès que nous maîtriserons la langue thaïe on te fera un compte-rendu détaillé et très précis sur les dosages des ingrédients!
Comme partout en Thaïlande il y a dans cette ville des temples, devant lesquels un bestiaire fourni et faisant appel à la grande imagination puisée dans la religion bouddhiste.
Sur le marché nous avons goûté des superbes fruits aux couleurs vives et agréables à manger, même s'ils ne sont pas très goûteux. Mais malheureusement, nous sommes dans l'incapacité de savoir leur nom. Si quelqu'un peut nous renseigner, nus sommes preneurs!
Nous avons aussi croisé notre premier éléphant, certes pas très gros. Son propriétaire le tenait le plus souvent en laisse sur le trottoir, comme un gros toutou.
J+25 Lundi 4 Chiang Saen à Chiang Khong 55 km
Dernière étape avant le Laos. Notre sortie d'hier soir, que nous attendions avec impatience pour aller manger au marché de nuit sur le bord du Mékong, a tourné court, gros orage oblige. Pour la saison sèche c'est vraiment mouillé, une nuit sur deux grosses pluies et il y a quelques jours fortes pluies dans l'après-midi. Heureusement nous étions au repos à Chiang Rai.
Avec toute cette eau, notre plan initial de traverser le Laos par des pistes est contrarié. En effet, hors routes, déjà pas toujours très bonnes d'après ce qu'on nous a dit, c'est le bourbier assuré. Donc nous resterons sur les routes.
Nous disons ce matin au revoir au patron de notre guest house, il a été adorable. On a fait la connaissance d'un Japonais qui adore les Alpes françaises et qui est un fan inconditionnel de Gaston Rebuffat et de René Demaison. On a parlé des grandes faces mythiques comme la face nord de l'Olan, et nous étions aux anges!
Hier, le patron, lorsque nous sommes arrivés, nous a dit,qu' un cycliste venait de passer la nuit ici. Il nous montre son appareil photo, il s'agit de notre Catalan. Je lui montre à mon tour mon appareil et il voit le Catalan. On éclate de rire!
Aujourd'hui 55 kilomètres, quelques pentes infernales qui vont vers les 15%, prémices du Laos. Des points de vue magnifiques sur le Mékong. Ce fleuve est étonnant, on a vraiment l'impression que par endroits, d'un coup, il subit des pertes. Il perd de sa largeur et de sa puissance et quelques kilomètres plus loin, de nouveau il revient avec toute sa puissance. On a constaté ce phénomène à plusieurs reprises.
Vers 12 heures nous sommes à Chiang Khong. Nous commençons par poser nos affaires dans une guest house, puis nous partons immédiatement dévorer un énorme poulet, des fois qu'on en trouve plus au Laos! Mais il y aussi les poissons du fleuve qui grillent!
Puis, nous allons préparer les documents nécessaires pour notre traversée demain matin dès l'ouverture du poste frontière. Nous espérons embarquer au plus tôt juste après huit heures et commencer à rouler dans la foulée.
Le port, un foisonnement de bateaux, petits et gros, transportant des touristes occidentaux ou des semi-remorques de 30 tonnes. J'adore ce trafic incessant au fil du courant puissant du fleuve.
Demain ce sera notre tour. J'attends avec impatience de me lancer dans ces bosses laotiennes que l'on nous promet infernales!
16:14 Publié dans expérience vécue, voyage à vélo | Lien permanent | Commentaires (29) | Tags : errance, vélo, mékong, thaïlande, laos
15/09/2012
Souvenirs d'enfance, pêche en Provence
Souvenirs de pêche en Provence
Ma jeunesse je l’ai passée durant de longues années au bord de la mer Méditerranée à Saint Raphaël. Notre père avait fait construire une villa dans ce coin du sud de la France, car très probablement cela lui rappelait sa propre jeunesse en Afrique du Nord. Il nous parlait de cette période avec une grande émotion, et nous contait par le détail les pêches miraculeuses qu’il y faisait. Forts de cet atavisme, mes frères et moi avons vécu avec passion durant une dizaine d’années nos vacances à traquer toutes les espèces de poissons de crustacés et autres poulpes dans le golfe de Saint Raphaël et ses environs.
Tout avait commencé alors que nous étions petits et habitions en bord de mer, après être rentrés d’Allemagne où notre père était médecin militaire. A cette époque les parents n’étaient pas traumatisés par l’enlèvement des enfants et notre mère nous laissait partir à l’école à pied à plus de deux kilomètres, et cela même en hiver. Nous partions donc de novembre à février de nuit soit par la route du bord de mer ou par celle qui longeait la voie ferrée. Cette dernière était plus courte. Par contre systématiquement nous rentrions par la corniche, déjà fascinés par la mer et ses vagues. Les jours de tempête, je me souviens des embruns qui nous submergeaient et nous procuraient des émotions fortes. Au cours de nos retours le soir, nous avons mené nos premières actions de pêche. En effet en bord de mer, il y avait des restes de briques, abandonnées sans doute lors de constructions de villas de l’autre côté de la route. Certaines de ces briques, cassées ou entières étaient immergées dans quelques dizaines de centimètres d’eau. Elles possédaient une caractéristique, plusieurs sections creuses. Là résidait tout le secret. Dans ces trous, des poissons s’y cachaient. Généralement il s’agissait de blennies, poissons que localement on appelle « babec », à prononcer impérativement avec l’accent du midi, au risque de ne pas se faire comprendre. Ces poissons n’étaient pas très gros, entre cinq et dix centimètres, tout au plus. Doucement nous rentrions dans l’eau, en évitant toute éclaboussure. Nous nous baissions et avec précaution positionnions nos mains de part et d’autre de la brique pour en boucher les orifices. Nous sortions de l’eau chargés de notre butin, et là sur le sable ou les graviers, nous vidions notre parpaing, le cœur battant. Les premiers filets d’eau s’étant écoulés, si la brique était habitée alors un joli poisson multicolore tombait au sol, tout frétillant. Nous le regardions émerveillés, fous de joie. On le ramassait avec douceur pour éviter de le blesser afin de l’admirer de près, puis nous le remettions à l’eau. Nous le regardions s’enfuir en tortillant sa queue dans les quelques centimètres d’eau près de la grève. Bien évidemment nous rentions bien souvent tout mouillés, et notre mère s’en étonnait. Comment aurait-elle imaginé que nous passions notre rentrée de l’école à retourner des briques dans l’eau !
Ces premières expériences, manifestement ont aiguisé nos instincts de pêcheurs, que chacun de nous a enfouis en lui. Il en est né une véritable passion de la traque de toutes les façons possibles et imaginables à la recherche ces pauvres habitants des mers qui ne demandent rien au genre humain. Notre frère aîné s’est montré particulièrement astucieux pour mettre au point toutes sortes de pièges et de lignes. Nous avons donc commencé à demander à nos parents de nous acheter, des cannes à pêche, des fouines, masques, palmes, épuisette, harpons, moulinets, bateau, rames, puis même un moteur, sans compter les ustensiles comme les pots de verre et les bassines qui nous procurèrent aussi de belles parties de pêche. Bien évidemment tout cela s’est fait progressivement, car lors de ces premières expériences à retourner des briques, je n’avais que six ou sept ans.
Notre frère aîné était, comme je viens de le laisser à penser, l’instigateur de ces séances de pêche effrénées, et bien évidemment il a été le premier à réclamer des instruments de plus en plus efficaces. Bardés de nos premières cannes à pêche, à bouchon puis de moulinets nous nous sommes lancés à la traque de la friture de roche. Cette population de petits poissons est constituée d’une multitude d’espèces : la girelle, le rouquet, le saran, la vache, le sarre, le saint-antoine, le sparaillon et bien d’autres. J’ai volontairement oublié la rascasse, poisson emblématique de la bouillabaisse. En effet, cet habitant des rochers on ne le pêchait généralement pas de cette façon, mais en pêche sous-marine. J’y viendrai un peu plus tard.
Je vais donc dans un premier temps vous décrire cette pêche de la friture de roche. L’appât que l’on utilisait le plus fréquemment était l’escavenne, ver de vase ou de sable. Effectivement, nous les recherchions sous les cailloux en bordure de mer, à marée basse, lorsque le lieu de vie de ces vers est découvert. Certains pourraient me rétorquer qu’en méditerranée il n’y a pas de marée. Mais si ! Certes pas très importantes. Lors des grands coefficients, cela se chiffre en quelques dizaines de centimètres, alors qu’au Mont Saint Michel la montée de l’eau dépasse les dix mètres. Mais cela suffisait pour mettre les escavennes à notre portée. Alors pour attraper ces vers, même presque à sec, ce n’est pas si facile. Il est nécessaire d’avoir acquis une bonne expérience sur leur réaction lorsqu’on retourne le caillou, si on espère s’en saisir. En effet, cette dernière, bien allongée sous sa pierre, se ménage des galeries afin de fuir rapidement au moindre danger. On se positionne au dessus de la pierre, l’un la soulève fermement et rapidement, l’autre détecte l’escavenne d’un coup d’œil, et la capture prestement. Au cours d’une bonne récolte, on pouvait espérer en ramasser une bonne centaine, point de départ d’une excellente pêche à la friture. Mais cet appât n’était pas le seul, bien que le plus pratique. Nous utilisions aussi les piades, bernards l’ermite ou bigorneaux. Trois noms pour un même animal. Cependant, Il y en existe deux espèces, les unes à pattes et les autres à lune. A pattes il s’agit du bernard l’ermite « classique » qui a colonisé une coquille à sa taille et qui se déplace à l’aide de ses pattes et pinces sur le sol dans l’eau ou à l’extérieur sur les rochers découverts. La piade à lune est un petit bigorneau ou bulot de tout petit format, comme ceux que l’on consomme avec une mayonnaise. Nous utilisions aussi les arapèdes, patelles ou chapeaux chinois, que l’ont récupérait à l’aide d’un couteau sur les rochers à fleur d’eau. Comme son nom « chapeau chinois » l’indique, cet animal possède une coquille de forme conique. Il adhère fortement au rocher, à l’aide d’un large pied ventouse qui tient toute la surface de son corps, qui constitue en fait sa partie charnue, musculeuse et coriace, qui tient bien à l’hameçon.
Le lieu privilégié pour pratiquer cette pêche se trouvait dans les rochers qui se situent maintenant derrière le nouveau port. Cette activité est particulièrement agréable pour de nombreuses raisons. Tout d’abord c’est toujours un immense plaisir de se retrouver en bord de mer très tôt le matin. A ces heures matinales, il y fait généralement frais. Un léger vent souffle de la terre vers la mer, phénomène qui s’inversera quelques heures après le lever du soleil, car le sol deviendra plus chaud que la mer. Assister à l’arrivée de l’astre du jour sur l’eau a souvent été pour moi l’une de mes motivations de ces levers matinaux.
La pêche en elle-même est fort ludique. Ces poissons sont dans leur grande majorité voraces et vigoureux. Après avoir lancé la canne, on n’attend généralement pas très longtemps pour avoir les premières touches. Pour plus d’efficacité on met sur le bas de ligne plusieurs hameçons, et de ce fait bien souvent on obtient deux, voire trois prises à la fois. Les touches sont fortes et les poissons se débattent avec vigueur. On ressent de belles sensations dans les mains, et la vue de son sillon de canne se pliant au rythme des coups de queue et de nageoires est un vrai régal. Lorsque le poisson émerge, on est souvent déçu de constater qu’il n’est pas très gros. En effet, il s’est débattu avec une telle ardeur que l’on s’attendait à bien plus gros. Mais cela ne fait rien, la petitesse de la prise est compensée par sa beauté, généralement multicolore, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’une girelle royale aux multiples couleurs étincelantes.
La plupart du temps, cette pêche prend fin vers les neuf heures du matin, lorsque les vents s’inversent, et que la brise vient alors de la mer. Ce retournement est précédé par une période d’une durée de quelques minutes, voire d’un quart d’heure, au cours de laquelle plus un souffle de vent n’agite la surface de l’eau. La mer est d’huile, prenant une teinte gris laiteux, parfait miroir. Il faut en profiter pour donner les derniers coups de canne et se saisir des ultimes poissons. Alors le vent du large arrive et comme par miracle plus une touche, plus un seul de ces habitants des rochers n’est intéressé par l’escavenne qui garnit votre hameçon.
Il est temps de rentrer. La première chose à faire en arrivant à la maison, c’est de préparer cette friture pour midi. On évide chacun des poissons, certains nécessitent d’être écaillés, d’autres non. On met le tout au réfrigérateur, et il n’y a plus qu’à attendre avec impatience l’heure du repas, qui ne saurait tarder. Alors dès que le gong retentit, on sort le plat du frigo, on roule chacun des poissons dans la farine et on les jette tous dans la poêle à frire. Alors habituellement c’était un peu la bagarre, chacun ayant repéré ceux qui lui feraient le plus plaisir. Pour ma part la girelle est le poisson qui a la chair la plus ferme et la plus savoureuse. Certes elle n’est jamais très grosse, même si certaines royales ne sont pas loin d’atteindre les vingt centimètres.
Pour mon père et moi, la girelle est l’un des poissons à la chair la plus fine, et sa pêche est particulièrement agréable, car sa combativité est stupéfiante. Comme je l’ai dit précédemment on s’imagine avoir attrapé beaucoup plus gros. Durant les premières heures de la matinée durant lesquelles elle mord, c’est un festival ! Pour toutes ses raisons de l’avis de mon père et du mien, cette pêche représente la quintessence de l’activité. Ce n’est absolument pas le point de vue de mon frère Marc. Pour lui, si un poisson ne fait pas un minimum de cinq cents grammes, il considère qu’il n’y a pas de pêche. Donc pour lui l’esprit de la pêche réside dans le gros loup, la grosse dorade, poisson qui pour le premier peut atteindre les huit kilos ou plus et quant au second il dépasse les quatre kilos. Combien de fois avons-nous abordé ce sujet à trois jusqu’à la mort de notre père, récente. Bien entendu la discussion était un véritable débat de sourds. Absolument impossible de trouver le moindre point d’entente. Mais quelles parties de rigolades cela nous a procuré. Le sujet n’était jamais épuisé, pourtant jamais renouvelé, mais cela ne faisait rien, pendant quarante ans et plus nous nous sommes lancés nos arguments à la figure, toujours les mêmes, toujours aussi incompris par le camp adverse, mais toujours aussi hilarants pour tous. Le bonheur dans le fond, il ne faut le chercher au bout du monde ! Une bonne discussion de famille sur un sujet de passion commune, le tout mâtiné d’un semblant de mauvaise foi et d’un soupçon d’esprit obtenu, et on se retrouve dans une querelle à la Pagnol sur le Vieux Port, pour la plus grande joie des protagonistes.
Cette pêche aux poissons de roche, accaparait la majeure partie de nos matinées, en dehors des jours de mistral. Mais lorsqu’il soufflait, nous nous tournions vers d’autres techniques pour assouvir notre passion dévorante et exclusive. Je me souviens qu’à l’époque les périodes de mistral n’étaient pas très fréquentes, mais elles pouvaient être très longues, sévissant par tranches de soixante douze heures. On a compté jusqu’à neuf jours consécutifs. Outre nous empêcher de prendre girelles et autres poissons de roche, le mistral restreignait très sérieusement la baignade car l’eau descendait à quatorze degrés.
Donc au cours de ces longs moments ventés nous pratiquions deux pêches, absolument étranges, la pêche au pot et celle au trou. Je vais commencer par vous décrire la première, puis vous révélerai toutes les subtilités de la seconde.
La pêche au pot : cette technique nous permettait de traquer le mulet ou muge. Dans certaines zones peu profondes bien protégées du vent, nous disposions nos pièges dans une quarantaine de centimètres d’eau au maximum. De quoi s’agit-il ? On prend un pot à confiture en verre, vide bien sûr, de plus ou moins grande contenance, on le recouvre d’un chiffon blanc, généralement prélevé sur un vieux drap, on le tend bien, et à l’aide d’un élastique on le maintient fermement. Sur cette surface bien lisse, on pratique un trou de quelques centimètres de diamètre. On remplit le pot d’eau, on y ajoute de la farine, on secoue bien, afin d’obtenir une mixture homogène. On n’oublie surtout pas de bien induire le pourtour de l’orifice avec de la pâte de farine. Il ne reste plus qu’à positionner cette nasse artisanale, bien calée au fond. On rejoint le bord et on surveille en attendant les bancs de mulets. Habituellement cela ne saurait tarder, avant qu’ils arrivent en masse. Par le trou se dégage comme une petite fumée blanche, qui attire les poissons. Rapidement ils se retrouvent sur le piège et commencent à sucer les particules de farine. Tout en le faisant certains s’aventurent par le trou dans le pot. Parfois ils sont si nombreux, que l’on de distingue plus une seule parcelle de blanc du morceau de drap. Sans trop attendre on se précipite dans l’eau pour récupérer le récipient. On plaque une main sur l’orifice pour éviter que certains poissons ne s’enfuient. On rejoint le bord, on vide le tout dans un grand sceau. On récolte jusqu’à une dizaine de poissons. Il n’y plus qu’à recommencer l’opération. Une fois il nous est arrivé d’attraper un poisson deux fois plus long que le pot, la tête au fond, il avait encore la queue qui dépassait largement ! Il nous arrivait d’atteindre le chiffre de 300 mulets en une séance de quelques heures. Nous avons même perfectionné le système, en remplaçant le pot de verre tout simplement par une grosse bassine métallique ! Ce qui augmentait considérablement le nombre et la taille des poissons qui se laissaient piéger. Mais que faisions-nous de tous ces mulets ? Nous ne les mangions que très rarement et en petite quantité, car ce n’est pas un très bon poisson. Mais alors pourquoi les attraper ? Effectivement à cette époque la pêche « No Kill » (excusez cette expression barbare anglaise, qui signifie que l’on relâche les poissons) n’était pas un concept encore à la mode. D’abord cette pêche, au pot ou à la bassine, comme la plupart des techniques employées procure un vif plaisir. Courir dans l’eau sortir son pot de l’eau et voir à travers le verre tous ces poissons piégés nous amusait beaucoup. Nous avions trouvé un débouché des plus agréables pour les gourmands de friandises que nous étions. Nous les troquions contre des cacahuètes caramélisées auprès du père « Chnink ». Ce voisin était vendeur de ce type de produits sur les plages des environs et il fabriquait lui-même sa marchandise. Il en avait donc toujours des stocks importants, et tout autour de chez lui régnait une délicieuse odeur de caramel. De plus comme il avait toute une ribambelle de chats qui eux étaient des consommateurs effrénés de muges, nous repartions avec des pleines boîtes à sucre remplies de cacahuètes caramélisées, souvent bien chaudes ! Le marché était comme diraient nos politiques « gagnant-gagnant ».
Durant ces périodes de vent l’autre pêche que nous pratiquions était « la pêche aux trous ». Pratique tout à fait étrange, qui cependant se révélait fort efficace. De quoi s’agissait-il ? Nous prenions un morceau de bambou de quarante centimètres de long et d’une section d’au moins un centimètre, c'est-à-dire absolument pas flexible. A l’une des extrémités, nous attachions du fil de fer tressé, donc lui aussi bien rigide. Cette partie métallique, ne dépassait pas les vingt centimètres, et était disposée perpendiculairement à l’axe du bambou. Tout au bout de ce drôle d’engin de courte taille à angle droit, nous disposions un gros hameçon, que nous appâtions avec une moule ou un morceau de seiche. Equipés de la sorte nous nous déplacions le long des digues, garnies de grosses pierres et nous enfournions la partie métallique dans les trous. Aussi incroyable que cela paraisse, nous attrapions de belles prises, gros gobies noirs, rouquets, et même belles rascasses. Les touches étaient brutales et nous extrayions littéralement de sous les pierres nos prises, souvent au plus grand étonnement des gens qui nous regardaient, en se demandant ce que nous pouvions bien fabriquer dans quelques dizaines de centimètres d’eau avec nos drôles d’engins à quatre vingt dix degrés. Je me souviens d’un jour alors qu’un père et sont fils, intrigués s’étaient approchés de moi et me regardaient avec curiosité et interrogation. Soudain une touche puissante me tire sur le poignet, je réagis en remontant ma ligne et là sous leur regard médusé monte un énorme poisson de la forme d’un congre, d’un bon mètre. Je le sors entièrement de son trou et lorsqu’il est bien en vue devant mes spectateurs ébahis, il se décroche et retourne à la mer. Ils ont très certainement cru, qu’ils venaient de rêver ou que leurs sens de perception avaient été mis défaut ! Je dois préciser pour la bonne compréhension de la scène, que les digues dont je parle, étaient en fait de petites jetées s’avançant de quelques mètres dans la mer, protégées de pierres de taille moyenne. Cela n’avait rien de comparable avec les grandes jetées de port bordées d’énormes rochers de protection. Non, dans nos coins de pêche tout était petit, bien à l’échelle des enfants que nous étions. Tous ces lieux qui font remonter en moi tant de souvenirs n’existent plus. En effet, malheureusement lors de la construction du nouveau port de plaisance à Saint-Raphaël, ils ont été définitivement détruits. Ils se trouvent maintenant quelque part sous le grand parking situé à l’entrée du port devant l’un des bassins accueillant les bateaux. Je me souviens avoir assisté à l’arrivée du premier camion d’une longue série qui durant de longs mois se sont employés à faire disparaître irrémédiablement les sites marins de notre enfance.
Dans un nouveau chapitre, je vais aborder les différentes activités que nous menions à partir d’un bateau ou d’un engin flottant. Nos premières aventures et expériences de pêche dans ce domaine ont été conduites tout d’abord sur un matelas pneumatique, puis un bateau gonflable, même d’un pédalo que nous louions. Puis finalement de manière plus conventionnelle à partir du bateau que notre père nous a acheté, dans un premier temps à la rame et ensuite à la force d’un moteur.
Le matelas pneumatique ne nous permettait que quelques incursions à proximité des côtes. En fait, nous nous déplacions sur des fonds de quelques mètres tout au plus. Allongé sur l’engin, la tête dans l’eau à l’aide d’un masque nous repérions les poissons posés au fond et laissions descendre l’appât devant leur gueule et les ferrions dès qu’ils l’avaient attrapé. Je me souviens d’un jour, ayant effectué une mauvaise manœuvre avec ma ligne, l’hameçon s’est pris dans le matelas pneumatique et nous avons bien évidemment coulé !
Lorsque nous avons eu des embarcations de plus grande dimension, nous avons commencé à nous aventurer plus loin des côtes, et cela de jour comme de nuit. Ces pêches en bateau nous permettaient de prendre des poissons de plus grande taille, que nous allions pêcher dans des eaux plus profondes. La mer méditerranée a la particularité de posséder de grandes profondeurs assez rapidement dès qu’on s’éloigne de la côte. Par endroits au milieu de ces fonds presque abyssaux, il y a des remontées de fonds alors que la distance à la côte est importante. En particulier au large de Saint-Raphaël il existe un de ces reliefs sous-marins que les pêcheurs appellent « le sec de Fréjus ». Le fond y est de l’ordre de 80 mètres. Pour le rejoindre nous passions sur des gouffres de plusieurs centaines de mètres, où il était exclu que nous puissions lancer nos cannes. Mais situer ces remontées de fond regorgeant de poissons, n’était pas chose aisée, vu la distance à la rive, et nous ne possédions pas encore à cette époque de GPS. Nous nous débrouillions par un système de triangulation entre le clocher de Fréjus et quelques autres points entre le Dramont et Agay. Nous arrivions à nous repérer grâce à ces caractéristiques du rivage, mais le souvenir précis de ces différents jalons s’est estompé. Bien évidemment lorsque nous nous rendions avec notre petite coquille de noix de trois mètres, dans ces zones en haute mer ou presque, nous étions complètement en dehors de la réglementation maritime. Longueur du bateau et puissance du moteur deux données qui nous interdisaient d’après la loi de nous éloigner de la côte. Mais comme cela ne suffisait pas en terme d’infractions, nous n’avions ni bouée de sauvetage, ni fusée de détresse et pas la moindre réserve au cas où nous serions bloqués en mer sur une longue période. En effet, ce que nous redoutions le plus lors de ces équipées au large, c’était une venue brutale du mistral comme cela arrive assez fréquemment. Dans ce cas nous aurions été poussés au large vers les côtes d’Afrique du Nord. Nous aurions dans ce cas espéré éventuellement pouvoir nous échapper en mettant la barre à l’est dans le but de tenter un accostage au cap du Dramont, combattant ainsi la dérive du vent nous entraînant plein sud, bien au-delà de ce fameux promontoire. Mais rien n’était moins sûr. Heureusement, le cas ne s’est jamais produit, et nous ne saurons jamais si notre manœuvre de secours était viable ou non. Le plus étonnant, c’est que parfois notre père nous accompagnait avec enthousiasme. Il ne semblait pas vraiment considérer qu’il y avait danger. S’il en était conscient, ce qui me semble probable, il l’acceptait tout simplement. Peut-être que son vécu durant plusieurs guerres, auxquelles il avait participé activement, lui faisait voir la vie sereinement et avec philosophie. Plusieurs de ses amis qui possédaient de gros bateaux n’osaient pas se rendre sur ces lieux de pêche et poussaient de hauts cris lorsque nous leur racontions nos épopées. De toute évidence, ils avaient raison de se méfier. Mais maintenant une cinquantaine d’années plus tard, que de merveilleux souvenirs me reviennent lorsque je me remémore ces départs, cap au large sur notre frêle embarcation. Parfois le matin au lever du soleil la côte est baignée dans une légère brume, et de ce fait nos repères de triangulation à terre se perdaient dans une uniformité grise de la côte. Souvent nous étions seuls sur le lieu de pêche donc pas de bateau pour essayer de se recaler. Alors à l’estime nous nous positionnions et si nous n’étions pas sur le « sec de Fréjus » nos lignes qui se déroulaient au-delà des cents mètres de fonds nous le signalaient. Par approximations successives nous finissions toujours par arriver sur notre coin de pêche.
Le bateau nous servait aussi à aller poser un palangre (nous utilisions le masculin alors que le dictionnaire emploie le féminin, mais pour moi le masculin, représente une réminiscence de notre enfance, je continuerai donc à l’employer!) le soir, que nous récupérions le lendemain matin. En quoi consiste un palangre ? Il s’agit d’un corde ou grosse ligne à laquelle sont suspendues des lignes munies chacune d’un hameçon. Le tout reposant sur le fond. Les hameçons espacés decinq mètres étaient de grande dimension. Généralement nous en mettions cent, donc notre palangre mesurait cinq cents mètres. Nous utilisions comme appâts de larges morceaux de calamar ou de seiche, ou encore des poissons de taille déjà respectable d’une vingtaine de centimètres. Nous nous rendions un peu avant la tombée de la nuit derrière le Lion de Terre, petite île à proximité du rivage, et dans une dizaine de mètres d’eau entre bancs de sable et d’algues nous déroulions le palangre et l’abandonnions pour quelles heures. Toute la nuit nous rêvions de ce qui allait mordre. A peine le jour levé nous nous précipitions sur notre bateau afin de relever notre pêche. Le matin, même en été il fait assez frais, car auxaurores le vent de terre est souvent assez fort et relativement frais, donnant à la mer une teinte bleue sombre. Dès que nous repérions la bouée balisant le palangre, nous bouillions d’impatience. Le flotteur rapidement ramené sur le bateau, nous commencions à remonter la longue ligne. Au bout d’une nuit dans l’eau, ordinairement la plupart des appâts avaient été mangés par des poissons, des crabes ou autres habitants des fonds. Alors commençait le moment le plus intéressant de cette pêche, nous regardions avec avidité vers les profondeurs pour apercevoir ce qui remontait. Des reflets blancs encore lointains nous donnaient de grands espoirs. Parfois lorsque les poissons étaient de grande taille, nous sentions les touches directement dans la ligne alors que la prise était peut-être encore à cent mètres. Le temps de remonter les cinq cents mètres nous prenait une bonne demi-heure voire plus, mais que le plaisir était vif, aiguisé par une curiosité dévorante. L’un de nous tirait le corps principal, l’autre se tenait prêt à alpaguer le gros poisson qui s’apprêtait à faire surface. Mais tous deux, nous avions les yeux fixés le long de cette corde qui s’enfonçait vers les profondeurs, encore toute auréolée des merveilleuses surprises masquées qui nous attendaient. Comme je l’ai dit, le gros poisson est annoncé par des reflets blancs, que nous distinguions par intermittence, du fait des mouvements du poisson et de la transparence variable de l’eau à cause des risées du vent qui opacifiait par instants la surface de l’eau. Ces moments d’attente dans l’incertitude nous ont procuré beaucoup de plaisir de joie et des coups d’adrénaline. Alors que j’écris ces souvenirs quarante ans plus tard, je sens ces mêmes émotions m’envahir devant mon clavier, et j’en ai le cœur qui bat. Nous échangions nos supputations sur le poisson qui remontait : un sarre, non plutôt un congre, un gros marbré ? Et puis l’instant de vérité arrivait. Bien souvent il s’agissait d’un gros congre, anguille de mer, qui avoisinait le mètre. Nous attrapions aussi quelques belles autres prises. Nous ramenions cela triomphalement à notre mère, qui déjà était soulagée de nous voir revenir vivants de nos escapades et ensuite se saisissait de notre pêche afin de nous réparer de bons repas.
Elle était experte en cuisine, comme d’ailleurs en beaucoup d’autres domaines, mais je n’écris pas une biographie de ma mère. Je vais simplement rappeler l’une de ses recettes, aussi étrange que cela paraisse, le saucisson de poulpe. Avant de vous compter comment nous procédions pour cette pêche, je vous décris sommairement la confection de ce plat dont nous faisions notre quotidien, ou presque, tellement nous en attrapions. Après l’avoir bien battu, afin de le ramollir, on le découpe en morceaux, on le cuit au court-bouillon, bien assaisonné aux herbes de Provence, que l’on bourrait en grande quantité dans la marmite. Une fois la cuisson terminé, on met le poulpe dans un chiffon, on en dispose les morceaux tout en longueur, on les enveloppe bien. On ficelle le tout en serrant bien fort. On obtient de la sorte un produit qui a la forme d’un saucisson empaqueté dans une serviette. On laisse sécher vingt quatre heures, et puis c’est prêt à la consommation. On débite alors des tranches comme dans un gros saucisson de Lyon, et c’est fameux.
Nous les attrapions en pêche sous-marine, activité qui nous prenait beaucoup de temps et d’énergie. En effet, les eaux bien que relativement chaudes, lorsque nous restions des heures à traquer en plongeant pour regarder sous les pierres tout ce que l’on voyait, on finissait par éprouver de fortes déperditions de chaleur. Bien souvent, nous sortions de l’eau tout grelotant, les lèvres bleues et la peau couverte de chair de poule. Alors nous nous allongions au soleil pour emmagasiner de nouvelles calories, puis nous repartions pour une deuxième plongée, beaucoup plus courte, notre résistance ayant des limites.
Je reviens aux poulpes. Ces animaux lorsqu’ils étaient en pleine eau, nous les attrapions facilement. Nous ne les tirions même pas au fusil harpon ou à la fouine, nous nous en saisissions et les ramenions au bord. Je me souviens d’un jour en avoir attrapé un, et voulant continuer à pêcher, je me suis contenté de me le mettre autour du bras, comme il m’arrivait parfois de le faire. Mais cette fois-ci après m’avoir bien enserré le biceps de ses tentacules, au lieu de rester bien sagement, il s’est mis à me mordre profondément dans le muscle. Comme il était de belle taille et que je l’avais laissé se positionner en toute quiétude, je n’arrivais pas à le décrocher. De son bec pointu il y allait de bon cœur. La douleur devenait très vive et il redoublait d’ardeur alors que j’essayais de le décoller de ma peau. En désespoir de cause, j’ai nagé le plus rapidement possible vers le bord, ce qui a pris quelques minutes de douleur aigüe. Enfin à terre j’ai pu le saisir et le maîtriser et l’arracher de mon bras. J’avais un beau trou bien profond qui m’a laissé une cicatrice durant des années. Je n’ai plus jamais recommencé ce mode de transport des poulpes !
Par contre lorsqu’ils ne se déplaçaient pas en pleine eau, ils se cachaient dans leur trou, et là pour les attraper ce n’était pas facile du tout. Leurs trous étaient caractéristiques, tous construits sur le même schéma. Un amoncellement de pierres de petite taille devant une cavité sous un gros rocher. Nous détections ces habitats très facilement, car les cailloux amassés étaient de couleur vive, lisses, tranchant sur les roches environnantes couvertes d’algues. Nous nous approchions et voyions les deux yeux du poulpe au centre. A son tour dès qu’il nous apercevait, il rabattait sur lui à l’aide de ses ventouses toutes les pierres possibles en se retirant au plus profond de son abri. Nous plongions et essayions de le harponner au mieux. Nous laissions le fusil harpon planté et remontions à la surface. Il nous fallait de nombreux plongeons à le manipuler, le tourner, le secouer pour enfin réussir à le décoller de sa caverne et le remonter. Parfois il se trouvait à quatre ou cinq mètres de profondeur, ce qui nécessitait de longues périodes en apnée afin de réaliser toutes les opérations pour le sortir. Bien souvent au cours de ces actions, nous avions la tête qui tournait après une longue succession de descentes.
Mais au cours de ces séances de pêche sous-marine en apnée nous ne pourchassions pas uniquement les poulpes, mais tous les poissons. Chacune des espèces avait ses habitudes et ses réflexes. Par exemple le racao, joli poisson multicolore qui pouvait atteindre une belle taille, fuyait au ras du fond en direction d’un rocher ou d’un banc d’algues pour se cacher. Généralement, il s’arrêtait dès qu’il n’était plus en vue directe de son poursuivant. Nous repérions donc précisément l’endroit où nous l’avions vu disparaître. On prenait notre souffle en surface et nous plongions en fixant ce point sachant qu’il n’était pas loin, immobile se croyant sauvé. Nous descendions en effectuant le moins de gestes possibles, et bien souvent, entre les algues ou juste dans une cavité rocheuse nous le distinguions. Alors il fallait évaluer précisément la distance à laquelle on allait tirer. En effet trop loin, la vitesse de la flèche s’amortissant rapidement, il s’enfuyait avant d’être touché, trop près, alors il réalisait qu’on l’avait découvert et il disparaissait pour de bon avant que nous ayons appuyé sur la gâchette. Exceptionnellement il m’est arrivé après avoir vu disparaître un racao dans des posidonies, de ne pas le voir une fois avoir plongé et cependant de tirer au juger à travers le champ d’algues au point exact de sa disparition, et de le harponner. Au son produit je savais si je l’avais attrapé avant de l’avoir vu. En effet, lorsque nous touchions notre cible, outre le fait de voir la flèche perforer le poisson, un son caractéristique de fréquence rapide était généré, comme un froissement de papier épais.
On recherchait tout particulièrement, la rascasse. Elle représente le symbole du poisson de Méditerranée et la base d’une bonne bouillabaisse. Lorsqu’elle était vue, elle était prise, car immobile. Mais il était très difficile de l’apercevoir, car toujours cachée sous de gros rochers dans de vastes cavités, et sa couleur mimétique la rendait pratiquement indétectable. Donc nous plongions sous de gros rochers, les poumons gonflés d’air et nous scrutions tous les recoins avec attention. Parfois nous la distinguions directement et d’autres fois, elle avait la mauvaise idée en nous voyant de se déplacer de quelques dizaines de centimètres, alors que nous ne l’avions absolument pas détectée, ce qui llui était fatal. Mais une fois au bout du fusil, il nous fallait faire bien attention car ce poisson de roche est couvert de grosses épines venimeuses, dont la piqure est douloureuse.
Les soles et autres limandes, poissons vivant sur de vastes bancs de sable nécessitaient aussi une grande vigilance, car leur mimétisme avec le sable était total. On distinguait la forme du poisson plat caractéristique sur l’étendue sableuse et jusqu’au moment où nous l’avions au bout de la flèche, nous ne pouvions jamais être sûr qu’il s’agissait d’une sole ou bien d’un simple dessin sur le sable.
Je pourrai vous parler d’une multitude d’autres poissons avec leurs habitudes bien spécifiques que nous avions appris à connaître. Tout l’intérêt de cette pêche, outre la beauté des fonds marins et de l’eau qui était très claire à cette époque, consistait à rivaliser d’astuces avec ces multitudes de poissons, qui bien souvent après nous avoir nargués nous échappaient.
Nous pratiquions aussi une pêche interdite et qui laissait par contre bien peu de chances aux poissons, la pêche sous-marine de nuit. Le fusil harpon dans une main, une forte torche étanche dans l’autre nous écumions les profondeurs obscures. Le long pinceau lumineux fouillait l’eau, les cavités et les algues. Les poissons restaient étrangement immobiles et il nous suffisait de nous approcher et de les tirer. Certaines espèces, comme le sarre, extrêmement difficiles à approcher de jour, devenaient des proies très faciles après le coucher du soleil. Notre mère n’était pas toujours rassurée de nous voir partir et nous enfoncer dans la nuit pour des activités dans l’eau et de plus dans l’illégalité alors que nous n’avions pas quinze ans. Cependant son petit côté rebelle, faisait qu’au fond d’elle-même, une fois son angoisse surmontée, elle était fière de nous et riait de bon cœur à la narration de nos « exploits ». Il nous est arrivé à plusieurs reprises de passer pas très loin de l’interception par la police maritime qui patrouillait de temps en temps, à bord d’un bateau qui s’appelait, je crois me souvenir, le capitaine Blazy.
Cette pêche nocturne était parfois très impressionnante, en particulier lorsque nous la pratiquions autour du Lion de Mer, petit rocher situé à huit cents mètres de la côte. Nous le rejoignions avec notre barque à la rame sans aucune lumière. Nous scrutions la surface, en essayant au maximum de ne pas nous trouver sur la trajectoire de gros bateaux dont nous distinguions très nettement les lumières. A quelques reprises nous nous sommes fait de belles frayeurs en voyant des embarcations rapides foncer dans la nuit directement sur nous. Mais cela ne nous arrêtait pas. Je crois même que cette traversée, aux risques de collision bien réels, faisait pour nous partie du jeu. Pour rien au monde nous nous serions privés de cette prise d’adrénaline à l’aller comme au retour. Mais il est vrai qu’au moment de renter, souvent tardivement en plein milieu de la nuit la mer était déserte.
Une fois le rocher, le Lion de Mer, atteint, l’un de nous se glissait dans l’eau équipé, l’autre le suivait de près en ramant le plus doucement possible, pour ne pas effrayer les poissons et ne pas nous faire remarquer d’éventuelles personnes se trouvant sur l’île. Les fonds étaient immédiatement très importants, trente mètres et plus. Le faisceau de notre torche éclairait les immenses parois blanches qui s’enfonçaient dans le noir absolu des grandes profondeurs, d’autant plus sombres de nuit. Que cela était impressionnant, bien souvent avec notre imagination débordante, on pensait à de gros monstres attirés par notre lumière, sortant de leurs abîmes et se jetant sur nous. La pêche nous la pratiquions donc le long de cette immense falaise qui s’enfonçait à perte de vue. Lorsque nous détections un poisson, souvent une rascasse rouge, dont la couleur trahissait la présence sur cette roche blanche, nous plongions pour l’avoir à portée de tir. Le fait de descendre en apnée vers ces fonds insondables, tout angoissés, le regard fixé sur notre cible, nous éprouvions des sensations très fortes. Une fois le poisson tiré, le plongeur remontait, du bateau tout proche le frère prenait le fusil et en passait un autre chargé et la pêche continuait. Je garde de ces séances nocturnes des souvenirs forts, et parfois je me demande si je n’ai pas rêvé. Un soir alors que nous étions en pleine action, nous avons distingué un bateau que nous pensions être le capitane Blazy. Toute affaire cessante cap au large et par un grand détour en passant par l’autre petite île de la baie, le Lion de terre nous prenons la fuite. Alors que nous sommes en pleine mer, que sous nous se trouvent de grands fonds d’une centaine de mètres, d’un coup une immense lumière nous prend en son centre. Un projecteur de grande portée nous aurait-il désignés comme cible ? Manifestement non. Un sous-marin alors ? En effet, la lumière ne vient pas du haut mais du bas. Nous sommes au milieu d’une immense gerbe lumineuse qui monte des profondeurs, alors que sur la mer la nuit est épaisse. Grosse trouille ! Mais qu’est-ce que c’est ? Le sous-marin va nous renverser ? Tout autour des bruits de clapotis se font entendre, le sous-marin fait-il surface ? Nous réalisons alors que cette lumière a été produite par un banc de gros poissons dérangés sans doute par notre passage et qui se sont précipités à la surface, alors qu’ils étaient à une dizaine de mètres de profondeur. En effet, l’explication est simple, tout mouvement dans l’eau de nuit génère un déplacement de planctons qui s’illuminent. Nous sommes habitués à ce phénomène, mais à faible ampleur. Autour de nos palmes de nuit de petites lucioles sont présentes, entraînées en courbes gracieuses par le déplacement. Elles nous accompagnent en permanence. Donc un banc important de gros poissons, qui subitement se mettent en marche à grande vitesse, génère une multitude de points de lumière en mouvement, qui donnent l’impression d’un énorme spot lumineux nous prenant en chasse. De ce soir, nous nous souviendrons longtemps mon frère Marc et moi.
Nous avons vécu d’autres expériences où l’adrénaline coulait à flots. Une nuit sombre, alors que l’orage se prépare, nous décidons de partir quand même sur notre bateau. Mon frère me dit que par ce temps électrique les poissons mordent encore plus. Nous longeons la côte. Les premiers coups de tonnerre particulièrement violents accompagnés de gigantesques éclairs se répercutent sur la mer dans un grondement qui n’en finit pas. Au loin, nous voyons un éclair frapper la corniche et tous les lampadaires s’éteignent. La nuit devient encore plus épaisse. Nous commençons à sentir que ça risque de chauffer pour notre matricule. Nous accostons sur un petit rocher à partir duquel nous comptons pêcher. Je suis à l’avant. J’amortis l’arrivée du bateau sur le caillou. J’ai un pied sur le rocher et l’autre à bord. Alors un terrible coup de tonnerre au milieu d’un flash de grande puissance nous percute littéralement. Le bateau fait un bond, nous nous retrouvons tous deux dessus, à plusieurs mètres de notre point de débarquement envisagé. Que s’est-il vraiment passé ? Nous ne savons pas. Je me souviens d’un mouvement brusque de recul, provoqué par quel mystère ? Nous gardons un souvenir confus de ces quelques secondes où manifestement la foudre nous a frôlés. Même mon frère qui est un acharné, dur à faire changer d’avis a décidé de rendre les armes ce soir-là et de rentrer sagement se coucher.
La nuit nous pratiquions aussi la pêche au congre à la canne. Nous n’y allions pas très souvent car le congre, espèce de gros serpent de mer ne nous attirait pas particulièrement. Mais il y avait un inconvénient majeur, c’est que la nuit nous nous faisions dévorer par les moustiques. Cependant, de temps à autre prenant notre courage à deux mains nous allions sur le Lion de Terre et taquinions les congres et autres murènes. Les touches étaient toujours conséquentes et nous avions la sensation d’avoir un tracteur au bout du fil lorsque nous en ferrions un. Sur cette île, outre les moustiques nous avions à faire face aux rats. Ils avaient toutes les audaces et venaient jusque dans nos sacs nous voler nos appâts.
Des souvenirs durant cette période de notre enfance, que nous avons passée au bord de la mer, j’en ai bien d’autres. Je me souviens en particulier de ce jour où me baladant seul sur la promenade qui domine la mer, je regardais de l’autre côté de la baie en direction du massif des Maures. Un orage était en cours, de gros nuages noirs écrasaient les montagnes de leur masse chargée de menaces. Je contemplais les éclairs illuminer le ciel. Soudainement là-bas de l’autre côté de la baie à une vingtaine de kilomètres, un immense éclair particulièrement brillant s’est dressé, et s’est matérialisé à l’effigie humaine. À ma grande stupeur la Vierge éblouissante m’est apparue, monumentale dans le ciel, visage incliné vers le sol, auréolée d’un voile lumineux. Cette immense apparition sans doute de courte durée s’est imprimée profondément en ma mémoire et j’en conserve un souvenir précis, encore très présent. Qu’ai-je réellement vu ? Je ne donne pas d’explication à cette expérience vécue il y a plus de quarante ans, mais n’en conteste pas la réalité, l’acceptant pour ce qu’elle est. Cela s’est passé alors que devant moi s’étendaient les vastes espaces, théâtres de nos passions de jeunesse.
La pêche, nous la pratiquions le plus souvent en mer. Cependant, de temps en temps nous nous y adonnions en rivières et lacs. Du côté d’Agay un petit cours d’eau au régime méditerranéen, dont je ne me rappelle pas du nom venait de l’Estérel et se jetait en mer. Nous y traquions les chevennes et autres petits poissons blancs dans les grandes mares qui apparaissaient en période d’étiage. Parfois à la main sous les cailloux nous les cherchions, et il nous arrivait de nous saisir de serpents, ce qui nous remplissait d’effroi. Heureusement jamais nous n’avons été piqués. Le lac artificiel de Saint Cassien, nous a aussi apporté de belles satisfactions, le plus souvent au cours de pratiques franchement illicites. Je me souviens de parties de pêche avec masque et fusil harpon, ce qui est strictement interdit en eau douce. Dans ces temps anciens, le barrage était récent et l’eau encore très claire, ce qui permettait avec un masque d’obtenir une bonne visibilité. Un jour mon frère Marc a plongé en direction de l’une des vannes du barrage, où se tenait un énorme brochet, qu’il a tiré. Mais ce dernier s’est enfui et s’est décroché de la flèche. Nous étions vraiment inconscients, car si les techniciens avaient ouvert la vanne, cela l’aurait irrémédiablement conduit à la noyade par aspiration vers le fond et entraîné en direction des turbines. Mais il y avait un dieu pour les imprudents cette fois-là encore!
Vers le bout de ce lac, là où l’eau est peu profonde, en hiver la surface est gelée, nous y traquions les brochets à la main. Nous nous avancions sur la glace et les voyions par transparence sous la couche de glace pas très épaisse. Nous faisions un trou, y plongions le bras et allions prendre de beaux brochets à la main. Mais dans une eau à zéro degré les doigts s’engourdissaient très vite et rapidement nous étions incapables de faire pression sur les poissons que nous saisissions, et de ce fait tout engourdis qu’ils étaient, ils réussissaient à nous échapper. Cependant nous en capturions assez pour remplir notre bassin, qui se transformait en vivier. Et au cours de ces actions pas très glorieuses, j’en conviens, nous n’avons jamais été surpris par un garde-pêche.
Voilà pourquoi encore maintenant et assidûment, lorsque je m’approche d’un plan d’eau douce ou salée, je ne peux m’empêcher d’en scruter les recoins à la recherche de ses habitants. Et c’est toujours avec le même plaisir que je découvre d’un pont une truite qui ressemble à s’y méprendre aux cailloux sur lesquels elle fait du surplace en attendant une proie, ou alors d’un quai quelques bars ou dorades qui passent furtivement entre des bateaux arrimés dans un port. Heureux, ceux dont les grandes joies et passions, qui ont conditionné leur jeunesse, les habiteront jusqu’au dernier souffle. Malheureux ceux, que ces vagues de jubilation venues de l’enfance, n’atteignent plus, car elles sont un puissant réconfort et antidote aux épreuves de la vie.
11:19 Publié dans expérience vécue, pêche | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : méditerranée, girelle, pêche, rascasse, congre, palangre, saint raphaël
19/08/2012
Oisans Sauvage Passion d'une vie
Oisans Sauvage Passion d'une vie
Le massif de l’Oisans restera pour moi cette région montagneuse privilégiée, que j’ai appris à connaître dès mon plus jeune âge, grâce à mon père, qui nourrissait une passion pour cette terre sauvage du Haut Dauphiné. Cependant, cette préférence ne tient pas à la précocité de ma découverte, mais bien aux caractéristiques extraordinaires de ce territoire. Sans vouloir les énumérer, je me contenterai de laisser courir l'écriture au fil des émotions, que fait naître cette région chez l'amoureux de la nature, de la montagne et des grands espaces.
Sa diversité liée à son immensité, en fait un massif aux multiples visages, du nord au sud, forts différents. Pour s’en convaincre deux points d’observation, l’un au nord le plateau d’Emparis, et l’autre au sud à partir de Champoléon, vous révèlent deux aspects opposés. Du premier endroit, le regard embrasse les extraordinaires faces nord de la Meije et du Râteau, parois sombres, auréolées de neige même au cœur de l’été, s’élevant majestueusement par delà de vastes glaciers chaotiques, bardés d’impressionnantes crevasses.
Du sud, au contraire vous découvrez une immense vallée sèche qui vient buter sur le Sirac et son interminable crête en dents de scie qui approche les 3500 mètres d’altitude. Là, au cœur de l’été tout n’est que roches arides, écrasées de chaleur. On pourrait s’imaginer dans un désert, bien loin de nos régions tempérées. Ces deux caractères d’une même région m’ont toujours fasciné. Le long de la Durance qui borde ces montagnes à l’est on est déjà dans le midi, presque en Provence. Le thym et d’autres herbes aromatiques embaument les chemins et les pierriers.
Par contre, lorsque vous descendez du col du Lautaret, les prairies et les austères parois vous rappellent que vous êtes dans les Alpes du nord, où règne une climatologie différente. Pourtant, il s’agit d’une même et unique région montagneuse, le massif des Ecrins ou de l’Oisans. Deux noms pour un même espace. Les Ecrins, car il s’agit du sommet culminant, et qui de plus dépasse les 4000 mètres. On l’appelait aussi, il y a fort longtemps le massif du Pelvoux, à l’époque on pensait, à tort, que ce sommet plus visible que les Ecrins était le point culminant. L’origine du nom Oisans, quant à lui, se réfère à la peuplade qui vivait dans ces contrées avant la conquête romaine. Deux dénominations pour une même région aux deux visages, rien de plus naturel !
Après avoir regardé ces montagnes de leur périphérie, rentrons en leur cœur. Deux vallées grandioses nous conduisent au centre de ce sanctuaire. D’un côté la vallée de la Bérarde et de l’autre celle de Vallouise. Tout en cheminant le long de chacune de ces routes remontant ces vallées, lentement les points de vue s’affinent et les grands sommets deviennent toujours plus imposants. Pêle-mêle, apparaissent la Meije, la Barre des Ecrins, l’Ailefroide, le Pelvoux, et de nombreuses autres éminences rocheuses ou neigeuses. Ces deux axes d’entrée sont en été très fréquentés. Mais, dès que vous vous éloignez des routes, des chemins et des rares escalades à la mode vous vous retrouvez seuls ou presque face à ces immensités de roche et de glace.
En matière d’escalade les usages et les pratiques ont évolué. Avec le développement d’une multitude de voies de varappe à proximité des routes en fond de vallée aussi bien à la Bérarde qu’à Vallouise, les grimpeurs désertent les grandes voies d’alpinisme. En effet, le jeu n’est pas le même. D’un côté un excellent rocher avec de très courtes marches d’approche, de l’autre de grandes parois austères aux approches interminables, souvent défendues par des glaciers particulièrement hostiles en été, lorsque la glace dure et dénudée de toute trace de neige barre l’accès au rocher. Pour se confronter aux premières, un lever tardif suffit, par contre pour aller à la rencontre des secondes, un réveil très matinal s’impose, suivi d’une gigantesque marche que l’on commence de nuit dans la caillasse. Ce départ aux aurores constitue un préalable indispensable, car l’expédition sera longue. Dans le premier cas, on est plus à la recherche du joli parcours technique, et dans le second plus à la quête d’une confrontation à la nature sauvage, par définition hostile à l’homme. Là, un jugement sûr et le sens de la lecture du rocher sont indispensables, afin de mettre de son côté de bonnes chances de réussite. Mais, il n’est pas question de juger une pratique à l’aune de l’autre.
Je reviens au cœur du massif de l’Oisans et tout particulièrement vers un groupe de montagnes que j’ai regardé depuis ma plus tendre enfance et dont je n’avais gravi jusqu’à ce jour aucun des sommets. Il s’agit de cette immense arête qui s’étire sur plusieurs kilomètres, dont les pointements frisent les 4000 mètres sans toutefois les atteindre. Tout au long de cette dentelle de pierre, on égrène des noms qui font rêver : Pelvoux avec ses deux cimes, Puiseux et Durand, le Pic Sans Nom (qui a quand même un nom !), le Coup de Sabre et la longue arête des Ailfroides avec leur terrible et sombre face nord-ouest, qui s’élève d’un jet sur 1,2 kilomètre de roche à pic. Cette immense vague de pierre domine le glacier noir, ainsi nommé car en été il est entièrement recouvert de débris morainiques, qui lui donnent cette couleur noire. Je l’ai à plusieurs reprises remonté les yeux levés vers ces pics acérés, presque inaccessibles, en songeant aux récits épiques des alpinistes qui les premiers se sont lancés à l’assaut de ces faces. 
Sur l’autre bord de ce glacier j’avais il a déjà longtemps gravi deux montagnes célèbres, tout d’abord le pilier sud des Ecrins qui culmine à 4102 mètres, et le Pic Coolidge plus modeste avec ses 3775 mètres, mais qui constitue un belvédère de tout premier plan pour admirer les grands sommets qui l’entourent. Cela m’avait laissé, au cours de longues marches, tout le loisir de contempler ce décor extraordinaire.
Cet été, Christophe me propose d’aller escalader la face sud du Coup de Sabre. Cela fait déjà très longtemps que je n’ai pas fait une voie de cette ampleur en haute montagne. Certes, au cours de ces dernières années nous avons gravi ensemble des voies techniquement aussi difficiles, voire plus, mais qui ne nécessitaient pas une telle marche d’approche de plus de 1700 mètres et qui atteignaient une altitude plus modeste. Je me suis empressé d’accepter la proposition, et voilà comment nous nous retrouvons au village d’Ailefroide en partance pour le refuge du Sélé, lieu d’où nous partirons demain matin pour notre ascension.
Tout au long de ce parcours sur sentier en ce début d’après-midi de chaleur, des souvenirs anciens me reviennent en mémoire au fur et à mesure de notre progression. Je me souviens d’une magnifique course à ski de randonnée en direction de la pointe des Bœufs Rouges, par des conditions de neige fabuleuses, qui nous permettaient une progression rapide. Je me remémore aussi l’ascension du très étroit couloir du Pelas-Vernet, qui se cache au fond d’une faille profonde. Tout cela remonte à plus de trente ans, cependant les souvenirs sont très présents et précis. Certaines expériences vous marquent de façon indélébile au-delà des jours qui s’écoulent. Une vie est balisée un peu à la manière d’une côte dans le brouillard, ponctuée de phares afin de permettre la poursuite de sa route vers un futur peuplé d’incertitudes. Le temps passe vite !
Voilà aussi ce que je viens chercher en acceptant la proposition de mon guide. Je suis à la recherche du souvenir, faisant revivre des sensations fortes éprouvées dans ce massif montagneux, il y a déjà bien longtemps. Tout à ma réflexion, nous avançons rapidement et en deux heures et demie nous atteignons le refuge du Sélé. C’est la première fois que je m’y rends. Ces dernières années, je ne fréquentais plus trop les refuges, de peur de la surpopulation, entraînant des nuits très inconfortables, dans la chaleur des dortoirs et dans le bruit des ronfleurs. Mais les modifications des habitudes des randonneurs et des grimpeurs, ainsi que des conditions d’enneigement ont amené à une fréquentation beaucoup moins importante de nombre de refuges de haute montagne. Cela n’est pas pour me déplaire, bien que ce soit fort triste pour les gardiens de ces refuges, qui exercent ce métier avec conviction, un peu à la manière d’un sacerdoce.
Ce soir, nous sommes une petite dizaine, ce qui est très peu en pleine saison estivale. Une cordée part pour la traversée du col du Sélé. Etant donné le faible enneigement et la longue distance sur glace vive cette randonnée représente à mon sens un véritable calvaire. Très logiquement les candidats ne se bousculent pas. Deux grimpeurs envisagent une escalade dans la face sud de Sialouze, réputée pour son rocher de grande qualité, ce qui est tout à fait remarquable pour l’Oisans, dont la réputation est plutôt liée au rocher incertain. Un guide et son client ont jeté leur dévolu sur la voie normale d’Ailefroide. Avec ces derniers, à cinq heures du matin nous partirons ensemble, nos chemins étant communs les premières heures. Cela ne fait pas grand monde pour cette bâtisse à large capacité. Demain soir, au grand désespoir du gardien, ils ne seront que trois, alors que nous sommes presque au week-end du 15 août, traditionnellement l’un des plus fréquentés.
Le repas du soir sera animé, discussion intéressante sur la montagne et autres sujets à connotation plus professionnelle. Nous aurons droit à du chamois en sauce, je ne sais pas s’il a été braconné dans le coin ? A la fin du repas le gardien, fort sympathique, nous fera un sérieux appel pour nous offrir un génépi maison. Mais nous résisterons et ignorerons son invitation. En effet, il détient une fameuse réputation, dont certains grimpeurs ne se sont pas relevés, étant redescendus du refuge avec une sérieuse gueule de bois, en oubliant jusqu’à la paroi pour laquelle ils étaient venus !
4heures30 lever, petit déjeuner sans entrain avec du pain pour le moins plus très frais, agrémenté d’un peu de beurre et d’une minuscule portion de confiture. A ces moments très matinaux, la faim n’est pour le moins pas très forte. Je me force donc à engloutir quelques tranches de pain. Dans le refuge nous nous équipons de nos baudriers dans un léger cliquetis métallique, dû aux mousquetons qui s’entrechoquent.
Nous attaquons la marche d’approche de nuit. Très vite le chemin conduit dans de petites barres rocheuses. Seul le halo de la lampe frontale permet de discerner les quelques mètres qui nous entourent. Ces marches sur terrain raide de nuit, alors que l’on vient juste de se réveiller, que les muscles sont encore froids et les mouvements mal assurés, sont impressionnantes et pas toujours très agréables. Dans une nuit opaque on s’imagine se promener au-dessus de vides abyssaux, toujours un peu tendu à l’idée de faire un faux pas, qui vous précipiterait vers une mort probable. Il n’en faut pas plus pour que le cerveau se réveille franchement et que la vigilance devienne extrême, à la recherche de prises de pied et de main au milieu des ténèbres. Cependant ces marches de nuit, un peu à tâtons, entouré d’immenses parois dont on ne distingue que les gigantesques silhouettes noir d’encre, qui se dessinent sur les étoiles, font partie intégrante des émotions que l’on vient chercher dans ces quêtes de sommets de haute montagne. On avance dans sa minuscule bulle de lumière, un peu à l’aveugle au milieu de ce décor d’immenses parois peuplées d’à-pics que l’on côtoie, à la manière d’un funambule qui ne distinguerait pas toujours très bien le filin sur lequel il est en équilibre. Ces absences de références précises, au milieu d’ombres qui migrent et se modifient au fil de vos pas font naître des illusions qui peuvent procurer de vrais vertiges, les informations fournies par les yeux et celles fournies par l’oreille interne pouvant différer. Voilà ce que représentent pour moi ces départs nocturnes, sur ce qui n’est plus des chemins et pas encore de l’escalade à proprement parler.
Heureusement, le jour ne tarde pas à se lever et cela rend la progression plus agréable. Les montagnes révèlent enfin leurs formes véritables. Éperons, faces et étendues glaciaires se différencient lentement dans une pénombre de moins en moins intense. Le ciel passe du noir profond au bleu, et enfin une teinte rouge sombre prend le dessus. Ce rouge devient de plus en plus vif, et cède à son tour devant le jaune, annonce imminente de l’apparition du soleil. Les faces rocheuses, par leurs teintes, en commençant par le sommet et avec un certain décalage dans le temps, suivent l’éclairement amorcé dans le ciel. De noires, elles virent au gris puis le rouge à son tour passe par tous les dégradés, pour enfin déboucher sur la véritable couleur de ce gneiss de l’Oisans, qui révèle une multitude de couleurs de l’ocre au vert pâle dû à certains lichens, sans oublier le rouge couleur rouille généré par certains oxydes de fer. Les glaciers dévoilent leurs véritables conditions. Ayant pris de l’altitude nous pouvons les observer du haut. Très nettement les parties de glace vive tranchent par leur froide couleur métallique bleutée sur les parties enneigées, plus blanches, quoique saupoudrées de débris de poussière dus à l’érosion très active dans ces zones de fortes amplitudes thermiques.
Après avoir contourné un vaste éperon, nous dépassons l’ancien refuge. Cette apparition d’une époque révolue nous plonge une centaine d’années dans le passé. Nous nous attendrions presque à voir sortir quelques alpinistes à chapeau, chaussés de chaussures à clous et portant des cordes en chanvre. Mais non, rien ne bouge, seuls peut-être les esprits des premiers ascensionnistes de ces cimes de l’Oisans se cachent encore parmi ce décor fantastique ? Un vaste vallon se découvre, et devant nous se dressent l’Ailefroide, le Coup de Sabre, le Pic sans Nom et son avant-poste l’aiguille de Sialouze. Le lieu est étrangement calme, Alors que 1500 mètres plus bas la vallée grouille de touristes, nous sommes seuls à contempler ce spectacle de la montagne qu’incendie le soleil. Il fait bon, pas un brin d’air. D’un pas alerte nous franchissons les quelques centaines de mètres qui nous séparent du glacier. Lorsque nous l’atteignons, nous chaussons les crampons pour parcourir une glace dure mais heureusement peu raide. Rapidement elle cède la place à la neige, ce qui rend notre progression plus confortable. Plus nous approchons du pied de la paroi, plus elle nous semble immense du haut de ses presque 400 mètres. La neige se redresse en finale, alors que nous touchons au rocher.
Le départ de notre escalade n’est pas évident à trouver. En effet, on recherche toujours le premier piton qui indique le démarrage. Dans le cas présent il se situe à une quinzaine de mètres du sol et ne se distingue pas très bien. Christophe l’identifie cependant assez rapidement, après quelques tâtonnements dans une pente de neige raide. Nous soufflons, car le gardien nous a dit que la veille une cordée d’Anglais n’avait pas réussi à localiser le départ.
Nous enlevons nos crampons et nos chaussures de montagne, et enfilons nos chaussons d’escalade L’opération est assez aisée, car la neige fait un replat juste avant le rocher. Ce n’est pas toujours le cas, et parfois il faut faire tout un tas d’acrobaties dans une pente raide, en faisant attention de ne pas tomber et de ne pas laisser filer crampons ou chaussures dans la pente ou pire dans une crevasse. Rien de tel aujourd’hui, et c’est sans stress particulier que je me prépare.
Christophe attaque la première longueur et arrive à bout de corde sans avoir trouvé de vrai relais pour me faire venir. Assuré sur un seul piton il me demande de démarrer. Dans cette première longueur le rocher est constitué d’un granit sans grain assez glissant. La sensation est désagréable aux pieds, car justement ces derniers manquent d’adhérence. Mais l’escalade n’est pas trop difficile et le passage n’oppose pas de vraie difficulté. Après une vingtaine de mètres, je marque l’arrêt à mon tour, pour que Christophe reprenne sa progression à la recherche d’un vrai relais. Après une longue dalle à faible inclinaison, il trouve enfin ce qu’il cherche. Et tout au long de notre escalade, nous n’aurons plus de mauvaise surprise et les points d’arrêts sécurisés par au moins deux pitons se succéderont régulièrement. Après les cent premiers mètres, le granit glissant laisse soudainement la place à un joli gneiss coloré, au gros grain sur lequel les chaussons d’escalade font merveille.
La paroi est toujours très raide, pas très loin de la verticale, même par petites sections surplombante. L’itinéraire reste bien balisé par les pitons en place. Cependant ce rocher demande de la recherche dans le positionnement, car les prises bien souvent ne sont pas directes. Il faut alors recourir à des tractions en opposition sur des fissures que l’on prend latéralement ou par en dessous. Cela demande des efforts importants dans les doigts et les avant-bras. Pour moi qui n’ai pas un gros entraînement cela va virer dans la onzième et dernière longueur à la ‘ bagarre de rue’ et c’est à la limite des crampes dans les doigts que je vais me hisser sur ce sommet qui frôle les 3700 mètres d’altitude à un mètre près.
La vue y est saisissante de toutes parts. Là-bas au nord dans le lointain le Mont Blanc affiche sa silhouette, toute de blancheur, si caractéristique. Juste à nos pieds l’immense glacier noir déroule sa surface de cailloux. Juste en face la gigantesque face sud des Ecrins nous domine de plus de 400 mètres. Nous sommes encadrés le long de notre arête, d’un côté par le pic sans Nom et de l’autre par l’Ailefroide. Loin au sud le Sirac déploie sa grande crête si particulière. La fatigue a fait son effet et tout content de me trouver en ce lieu aérien, j’ai du mal à m’alimenter. Cependant je dois me forcer, car une longue descente en rappel nous attend. Bien souvent, les accidents arrivent au cours de ces manœuvres du fait du relâchement de la vigilance dû à la fatigue.
Christophe se lance dans le premier rappel, puis vient mon tour. Un dernier regard circulaire du haut de ce pic et je me laisse glisser le long de la corde. Ces opérations de descente sur un vide de plusieurs centaines de mètres sont toujours impressionnantes, bien que généralement techniquement faciles. D’où l’importance de ne pas se laisser gagner par la routine qui peut conduire à l’erreur, que l’on croirait impossible, et qui malheureusement se produit, même au détriment des plus forts. Et c’est ainsi que l’on se retrouve précipité dans le vide pour un dernier grand vol. Nos onze rappels se passent sans incident, si ce n’est une corde bloquée au cours du premier, et une petite manœuvre à quinze mètres du glacier, du fait de notre corde trop courte de cinquante centimètres pour rejoindre le dernier piton, ce qui a impliqué un petit pas d’équilibriste sans assurance.
Enfin nous voilà de retour sur la neige. Durant notre escalade la glace sous-jacente a bougé, et l’une de mes chaussures posée à même le sol s’est déplacée, enfoncée dans une petite dépression. Il n’aurait pas fallu grand-chose pour qu’elle soit précipitée dans la rimaye, profonde crevasse à la séparation de la glace et du rocher. Je n’ose imaginer comment j’aurais redescendu ce glacier avec une seule chaussure de montagne, les chaussons d’escalade, n’étant pas du tout, mais alors pas du tout prévus à cet effet. Mais la montagne s’est montrée encore une fois clémente à mon égard.
Il ne nous reste plus qu’à nous lancer dans une immense descente de 1700 mètres de dénivelé, en passant par le refuge, afin de retrouver la voiture tout en bas dans la vallée. A 19 heures nous atteignons le refuge. Plus que 1000mètres de dénivelé à descendre. Ils vont me sembler très longs. La montagne a été désertée par les randonneurs, montés pour la journée au refuge. Les chamois ont repris possession des lieux et ils ne sont pas farouches du tout. Nous les approchons à quelques dizaines de mètres et ils continuent sans trop d’inquiétude à brouter herbe et feuillage. Une mère et son petit, juchés sur une légère crête juste au-dessus du chemin nous regardent passer avec curiosité. La nuit nous surprendra dans la descente, que nous finissons par trouver interminable. Dans les passages en forêt, la pénombre se fait bien réelle. Enfin entre les troncs d’arbres, nous voyons apparaître les lumières du camping. Ça y est nous en avons fini, la voiture nous attend bien sagement. Il est 21heure30. Depuis cinq heures du matin, nous ne nous sommes pratiquement pas arrêtés et c’est avec plaisir que je m’assois dans mon véhicule. Il ne nous reste plus qu’à retourner à Gap qui est distante de 80 kilomètres. La nuit est particulièrement limpide et nous sommes le 11 août, période des pluies d’étoiles filantes. J’en verrai une belle alors que je conduis. Dernier petit clin d’œil de la nature au cours de cette journée bien remplie.
Alors que je suis rentré chez moi depuis deux jours, je prends le (vieux) guide du massif des Ecrins de Lucien Devies et Maurice Laloue. Pour moi ce livre de couleur rouge, édité en 1946, représente une véritable bible du massif. A le lire, c’est toute l’histoire de la découverte de ces montagnes que l’on suit. Les dessins des parois à l’encre sont très précis. Page 61, sur une demi-feuille le Pic Sans Nom, entouré de la Pointe Puiseux et du Pic du Coup de Sabre, affiche sa grandiose face nord. Le Pic du Coup de Sabre est dénommé Petit Pic Sans Nom. Une correction à l’encre bleue rectifie cette erreur d’appellation. Je reconnais cette écriture, c’est celle de mon père qui avait acheté ce livre en 1956. Je sais que son esprit est encore là-haut. Il m’avait demandé d’aller répandre ses cendres sur un sommet de la région. Il avait finalement changé d’avis, de peur que je prenne des risques en accomplissant ses dernières volontés. Cette rectification à l’encre bleue, d’une écriture ferme et droite, est la preuve, qu’au cours de cette plongée de ces deux derniers jours au cœur de ce sanctuaire, il était là, et qu’il participait à mon plaisir, bien que ma pratique de l’escalade extrême lui ait toujours provoqué une certaine crainte pour mon intégrité physique.
15:35 Publié dans escalade, expérience vécue, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ecrins, pelvoux, paroi, coup de sabre, refuge du sélé, escalade, glacier noir
11/08/2011
Le cèpe et les autres quand ils se montrent
Le cèpe et les autres
Depuis ma plus tendre enfance les champignons me fascinent. Cela tient à notre père qui nous a toujours emmenés dès que nous avons été en mesure de marcher à travers les forêts des nombreuses régions que nous avons habitées, et les déménagements furent nombreux. Cette passion des forêts m’est donc restée, et plus tard à mon tour, devenu grand et autonome et ayant quitté le foyer parental cette passion a continué à m’habiter et je cours toujours les bois à la recherche de ses hôtes à pied.
En ces périodes de changements climatiques les pousses selon les années sont aléatoires et capricieuses. Mais globalement cela n’est pas si mauvais. Cette année 2011 s’annonce miraculeuse et si l’automne est aussi producteur que ce mois d’août, on pourra parler d’année excellente voire exceptionnelle. L’année dernière 2010 a aussi été un bon cru, en tout cas dans les Vosges. Mais malheureusement j’ai suivi cela de très loin. Ne me trouvant pas en Europe à cette époque, je me suis contenté des photos que l’on me faisait parvenir par le net, sans doute afin de me faire regretter mes grandes envies irrésistibles de voyage au long cours.
Les récoltes annuelles précédentes avaient été médiocres. La dernière cueillette exceptionnelle remonte à 2006. Cette année, dès le mois de juillet les cèpes furent abondants et la pousse se répéta jusqu’au mois d’octobre, c'est-à-dire sur quatre cycles de lune. Eh oui je suis un fervent adepte de l’influence de la lune sur l’apparition de ces habitants des forêts, des champs et des taillis. Je considère qu’en dehors de la période de lune montante, il n’y a point de salut.

Cette passion s’est vraiment révélée lorsque nous habitions à Fribourg en Allemagne. Les cueillettes régulières en forêt noire m’ont marqué de façon permanente. Tout d’abord la jeunesse, j’avais huit ans, et les grands sapins sombres de ces immenses forêts m’impressionnaient mais sans hostilité. Je rentrais dans un monde mystérieux et comme notre père n’était pas particulièrement peureux, il m’arrivait de me retrouver seul de longs moments sans que mes appels n’aient de réponse. Mais cela ne m’empêchait pas de rester concentré sur la recherche de la chanterelle et du cèpe. Peut-être que de cette époque m’est restée cette quête de l’originalité du voyage que ce soit à pied ou à vélo dans les recoins secrets et peu courus de notre planète. Nous faisions des cueillettes conséquentes que notre mère mettait toute sa science à cuisiner.

Il me reste une image forte de cette période. Nous étions en forêt dans une zone relativement dégagée sous de grands sapins, et mon père pousse un cri et me dit « regarde ». Je lève les yeux et que vois-je à une cinquantaine de mètres ? Deux énormes cèpes, avec mes yeux d’enfant je les trouvais d’autant plus gigantesques. Le plus petit approchait sans doute le kilo et le plus gros faisait le double et mesurait dans les quarante centimètres. Rien que de me remémorer cette scène, une joie intense n’envahit, alors que cela remonte à presque cinquante ans.

Dans mes grandes balades en forêt je suis toujours à la recherche de ce vécu, dans l'attente de le revivre. Voilà pourquoi je ne peux pas regarder une prairie, une broussaille, un bord de chemin, une rive de ruisseau ou une forêt sans immédiatement essayer d’y repérer un quelconque cryptogame, qui s'y cacherait. Bien évidemment, tous les champignons n’ont pas la même valeur et ne présentent pas le même intérêt, ni ne procurent le même plaisir à la cueillette. Le roi des champignons pour moi reste le cèpe. Sous cette appellation je regroupe trois espèces très proches, le boletus edulis ou cèpe de Bordeaux, le boletus aereus ou tête de nègre et le boletus pinicola ou bolet des pins. Ce dernier champignon, au port puissant et charnu, n’a rien à voir avec le cèpe des pins du midi ou pissacan. Contrairement à ce dernier qui est frêle, il s’agit d’un champignon qui présente toutes les caractéristiques du cèpe de Bordeaux, en plus trapu et avec des couleurs tirant un peu plus sur le brun rouge.

Au cours de ma carrière de chercheur, les récoltes miraculeuses n’ont pas été très nombreuses. Je me souviens de quelques jolis paniers de giroles grosses parfois comme des assiettes à dessert, des longues séances de ramassage de la chanterelle d’automne en bordure d’Atlantique dans la région d’Arcachon, de quelques jolis paniers de morilles en Alsace, d’une magnifique journée au val d’Aran en Espagne à chercher un champignon rare le tricholome de la Saint Georges ou vrai mousseron. Il s’agit d’un beau et fort champignon blanc à l’odeur prononcée de farine, qui se cache dans les herbes drues des alpages de montagne. Il s’y dissimule tellement bien qu’il faut parfois y aller en tâtant du bout des doigts le tapis végétal, et à la sensation on décide ou non de regarder ce qui s’y cache. Toutes ces expériences passées me laissent des souvenirs impérissables à la hauteur des profondes joies que m’ont procurées de grandes ascensions ou de longs voyages à vélo.

Et bien entendu j’ai gardé pour la fin le cèpe. Là, les belles cueillettes déclenchent un plaisir difficilement exprimable. On rentre dans la forêt haletant, chargé d’espoir à la recherche de la première grosse tête qui poindra de la terre ou des épines de conifères. Une silhouette apparaît, le rythme cardiaque monte en flèche, une joie débordante commence à bouillonner, on se précipite et souvent la déception se révèle avec le rapprochement, car on réalise qu’il s’agit d’un cèpe d’une espèce moins prisée ou d’un champignon autre. Mais ces fausses alertes ne font que renforcer la vigilance. On se déplace à pas mesurés, scrutant les endroits propices, les lisières bien aérées et bien exposées au soleil, les éclaircies en milieu de forêt, là où la mousse, les bruyères ou les myrtilles s’épanouissent. Les myrtilles, elles me font penser surtout aux Vosges, et là il ne s’agit plus de myrtilles mais de brimbelles. Si vous employez ce terme vous serez directement adopté par les habitants du Thillot ou de Cornimont.

Le plaisir du toucher, je pense en particulier à la tête de nègre ou bolet bronzé. Une fois qu’il est aperçu, le plaisir commence. En effet, le saisir procure une sensation particulièrement intense. On part à la découverte du pied qui plonge sous les feuilles ou la terre. Les doigts suivent cette chair ferme, et parfois ils n’en finissent plus de descendre à la recherche du point où ils exerceront une pression délicate pour sortir ce magnifique champignon dans son intégralité, sans l’abîmer. Le toucher du cèpe, lorsqu’il est ferme et son pied conséquent, représente la plus belle émotion du chercheur de champignons, empreinte de sensualité tactile et de surprise. Une autre espèce très différente procure un plaisir similaire quant à la découverte de la longueur du pied et à la prise en main. Il s’agit du tricholome équestre que l’on appelle aussi canari, du fait de sa couleur jaune, ou bidaou dans le sud-ouest. C’est d’ailleurs dans cette région qu’on le rencontre fréquemment, dans les pinèdes en bordure de plage au milieu les zones de mousse, dans laquelle son pied plonge en s’épaississant.

Ce mois d’août 2011 a commencé sous les meilleurs hospices. J’ai eu la chance de faire quatre cueillettes extraordinaires, les trois premières dans les Vosges et la quatrième dans le massif du Pilat dans la Loire. Et nous ne sommes que le 10 août, que d’espoirs en perspective d’ici la fin de l’automne! Tout a commencé dans le massif vosgien. Arrivant un après-midi du tout début du mois d’août chez mon beau-frère au Thillot, ce dernier me montre sa récolte du matin constituée de chanterelles d’automne et de quelques petits cèpes. L’alerte est donc donnée, ces chanterelles d’automne à cette époque bizarre ! Mais les cèpes, cela arrive les bonnes années. Suite à ces révélations je me précipite en fin d’après midi dans la forêt toute en pente au-dessus de chez lui, et le festival commence. Le lendemain j’y retourne à la périphérie des endroits de la veille et rebelote, je rentre à nouveau avec un plein panier. L’endroit semble peu couru. En effet mon beau-frère m’a dit que les deux redoutables chercheurs qui écumaient le coin depuis plus d’un demi-siècle n’étaient plus en mesure de s’aventurer dans ces pentes raides. Je n’irais pas jusqu’à dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, il s’agit simplement des générations qui se succèdent.

Après ces deux belles cueillettes la pluie est venue et nous avons laissé passer deux jours. Le matin avant de rentrer à Lyon nous faisons un tour en forêt à trois, afin que je leur montre les coins dans lesquels j’avais fait de si belles rencontres les jours précédents. Et là, les conditions météo exceptionnelles, orageuses avec pluie et chaleur, ont déclenché une pousse aussi miraculeuse que rapide. D’abord nous ne sommes pas ressortis de la forêt avant midi, adieu le départ pour Lyon dans la matinée, mais nos paniers étaient plus que pleins. À trois nous avions bien quinze kilos de cèpes magnifiques et durs.

Fort de cette expérience vosgienne extraordinaire, nous rentrons dans l’après-midi à Lyon. Vu ce qui pousse dans les Vosges, pourquoi le même phénomène n’aurait-il pas lieu dans la région lyonnaise? Je me précipite chez mon frère et lui conte mes exploits. Nous tombons rapidement d’accord et décidons de tenter notre chance dans le mont Pilat le lendemain matin.

Nous y voilà. Le chemin est très raide. Rapidement nous tombons sur les premiers cèpes, dans des coins où généralement nous en trouvons peu ou pas. Cela nous donne tous les espoirs pour notre « spot » qui se trouve beaucoup plus haut. Nous y arriverons après un certain temps, car de toutes parts les bolets bronzés nous ralentissent. Une fois sur notre place, à perte de vue ou presque les gros chapeaux ronds et noirs tout frais pointent juste hors des épines de sapin. Incroyable, de notre vie nous n’avons jamais vu cela ! Des champignons gros comme le poing, durs fourmillent. Ils sont tellement fermes, que la lame du couteau ripe parfois au moment de couper la pointe du pied. On a vraiment la sensation de récolter des patates. Plaisir fou ! Dans ces moments, tous les sens sont aux aguets. Sommes-nous seuls, va-t-on voir surgir des concurrents qui vont attaquer notre pousse miraculeuse par l’autre bout ? Laisser le moins d’indices possibles. Bien recouvrir les traces qui révèlent la coupe d’un gros pied bien blanc. Essayer de faire disparaître les restes de grattage des pieds avant de mettre nos prises dans le panier, afin de ramener le moins de terre possible. Une fois le panier bien plein, enlever son t-shirt, afin d’essayer de masquer cette récolte miraculeuse. Un chercheur ne donne jamais ses coins !
Une fois de plus en une semaine nous revenons fortement chargés. Aujourd'hui, mon frère et moi portons chacun un grand panier et un sac de supermarché aux larges dimensions. Nous ployons sous la charge, les muscles des bras tétanisés par le poids de la multitude de cèpes. Pourvu qu'en descendant nous n'en trouvions pas d'autres, car où les mettre? Le cèpe rend le chercheur frénétique! Nous redoutons de glisser dans la pente très raide par endroits et de voir notre précieuse récolte dévaler au hasard des accidents de terrain. Il faut amortir les secousses dues au déplacement, afin d'éviter le tassement des champignons en fond de panier ou de sac. Tout se passera au mieux et sans avoir rencontré âme qui vive, nous atteignons la voiture et nous cachons rapidement nos trésors dans le coffre. Nous laissons alors une immense vague de joie nous envahir. Pourquoi le cèpe procure-t-il une telle montée de plaisir?
Et ce n'est que la première phase, car s'en occuper en les grattant, les couper, les faire sècher, les mettre au congélateur tel quel, ou les faire rissoler à la poêle avec une odeur de persil et d'ail qui monte, fait partie de la deuxième phase du rite lié au cèpe! Et en finale bien sûr les manger apporte une autre gamme de plaisirs, d'autant plus intenses que le vin a été bien choisi et s'harmonise avec bonheur à ce miracle de la forêt!

Le soir à la télévision on ne parlait plus que de champignons, et de cèpes en avance de trois semaines. Je pense que dès le lendemain les hordes se sont lancées dans les bois. Par chance j’ai eu l’occasion d’être un peu en avance grâce à l’indice donné par mon beau-frère, ce qui m’a permis de faire des cueillettes extraordinaires et la dernière et quatrième je la qualifie tout simplement de plus belle de ma vie !

15:52 Publié dans champignons, expérience vécue | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cèpe, chanterelle, girole, bidaou, mousseron
06/05/2011
Montagne de Reims, les Faux de Verzy
Les Faux de Verzy
Verzy est un petit village sur la bordure est de la montagne de Reims, charmante petite agglomération de la plus prestigieuse région viticole de France, voire de la terre ! Tout le monde ne sera peut-être pas d’accord. Même si l’on préfère un bon rouge de Bordeaux ou de Bourgogne, ou un excellent blanc comme un Condrieu ou un Pouilly Fuissé, sans parler des vins étrangers qui battent parfois leurs homologues français dans des dégustations à l’aveugle, reconnaissons que le champagne et ses bulles sont le symbole universel de la fête. Outre un magnifique vignoble s’étalant à son pied, ce village recèle une curiosité rare, qui se cache au cœur de sa forêt domaniale, une population d’arbres, appelés Faux de Verzy.

Il s’agit d’une colonie exceptionnelle de hêtres aux formes extraordinaires. Les branches et les troncs, prennent les allures et les angles les plus incroyables et ressemblent à des éclairs pétrifiés. Non seulement leurs structures sont vraiment originales, mais leurs branchages s’incurvent jusqu’au sol, ce qui ajoute à l’étrangeté de ce peuplement d’arbres. On les appelle aussi hêtres tortillards. Lorsqu’ils ont leur feuillage, ils s’apparentent à de grosses boules vertes posées à même le sol. Début mai, alors que les feuilles sont toutes neuves, leur vert tendre s’enlumine aux rayons du soleil, pénétrant les frondaisons des grands arbres qui les entourent, et alors ces hêtres étranges donnent un air mystérieux à la forêt, comme s’il s’agissait de quelques cachettes magiques protégeant les lutins de la forêt.

Je me souviens, il y a fort longtemps les avoir vus en hiver. A cette saison seuls leurs squelettes, tels de grosses toiles d’araignée mal agencées, s’élèvent dans la forêt grise et froide, ce qui produit une forte impression. Par contre comme en ce début mai 2011, lorsque ils ont leur frondaison, leur silhouette n’est plus du tout la même. Je vous conseille donc d’aller les contempler une fois en été et une fois en hiver.
Leur population dans la forêt domaniale de Verzy est estimée à huit cents. On trouve aussi ces hêtres tortillards dans quelques autres régions d’Europe, mais en nombre bien moins moindre. Le site de Verzy, du fait de l’importance de sa population de Faux, semble le seul lieu susceptible d’assurer la viabilité de l’espèce, et par conséquent il constitue une richesse exceptionnelle.

Mais d’où proviennent ces arbres mutants ? Ce phénomène peut de même s’étendre au chêne et au châtaigner. Peut-être au pin ? En effet je me souviens avoir vu des pins tout à fait étonnants par leurs zigzags le long du courant du Huchet petit cours d’eau situé à une cinquantaine de kilomètres au sud d’Arcachon. Revenons à Verzy. Les premières descriptions connues de ces étranges habitants de la forêt datent de 1664. Il semblerait que l’emplacement des Faux corresponde avec le positionnement des anciens jardins de l’abbaye, qui fut fondée au VII siècle, une centaine d’années après que saint Basile, évangélisateur de la Lorraine se soit fait ermite en ces lieux. Depuis elle a disparu, car vendue comme nombre d’autres édifices religieux à la révolution comme biens nationaux. Elle fut détruite peu après, ses pierres étant commercialisées par le marchand de biens qui s’était porté acquéreur.

Y-a-t-il un lien entre les moines et les Faux. Ces ecclésiastiques les auraient-ils mis en terre dans leur jardin et entretenus ? Ces arbres ont un patrimoine génétique particulier. Ils peuvent parfois se reproduire par graines la faîne chez le hêtre, mais rarement. Plus généralement ils se reproduisent par deux phénomènes distincts.

Le drageonnage : derrière ce mot barbare se cache tout simplement l’apparition d’un bourgeon à partir d’une racine. Ce bourgeon se développant, il donne naissance à un autre arbre, qui va couper ses liens par racine avec son géniteur et il devient arbre à part entière.
Le marcottage : les branches, lorsqu’elles touchent le sol, prennent racine et à leur tour donnent naissance à un arbre qui s’émancipera à la recherche de son autonomie.

Voilà si vous passez dans le coin et les occasions ne manquent pas, le champagne, le fort de la Pompelle, haut lieu de la guerre de 14-18, où tout simplement lors d’une liaison, ce qui était notre cas, revenant de Belgique, prenez le temps de faire un détour et d’aller musarder en forêt vers ce petit coin de paradis très curieux, vous ne le regretterez pas.
13:20 Publié dans expérience vécue, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verzy, hêtre tortillard, montagne de reims
17/04/2011
Le Grand Colombier et vélo-route du Rhône
Grand Colombier et vélo-route du Rhône
Un projet que nous avions prévu de longue date a trouvé sa réalisation au cours de trois jours du mois d’avril 2011. Le point principal de cette balade consistait en la montée du Grand Colombier à vélo, col mythique des cyclistes. D’ailleurs le mot col n’est pas à vraiment approprié, car la route passe pratiquement à la cime de cette montagne. Ce sommet d’altitude modeste, un peu plus de 1500 mètres, exactement 1501 pour le point le plus haut de la route, n’en est pas moins redoutable, car il s’élance d’un seul jet de plus de 1200 mètres au-dessus de la vallée du Rhône. Le point de vue est franchement époustouflant, sur les Alpes, le Rhône et le lac du Bourget qui se situe quelques kilomètres au sud.
Afin de pleinement profiter de notre petite aventure nous décidons à deux de partir de Crémieu, aller dormir au pied de notre objectif, puis dans un deuxième temps le gravir et au cours d’une troisième et dernière étape rentrer à Crémieu en suivant en partie la fameuse vélo-route du Rhône.

Ce petit voyage de trois jours nous a permis de réaliser un cumulé de 221 kilomètres, les distances par étape étant les suivantes: 80, 54 et 87 kilomètres.
Le premier jour à travers une nature en plein éveil nous rejoignons par de jolies régions vallonnées le Bugey et nous engageons dans ses reliefs prononcés. Pas mal de côtes, mais de petites routes accueillantes dans une atmosphère printanière particulièrement agréable, nous permettent d’effectuer ces 80 premiers kilomètres avec beaucoup de plaisir. Au sommet d’une côte apparaît en face de nous l’objet de nos désirs. Masse imposante

s’élevant au-dessus du Rhône, sur laquelle nous essayons de trouver le tracé de la route qui la sillonne en partant de Culoz. Mais nous sommes encore loin et ne discernons pas vraiment le chemin qui devrait nous conduire au sommet. Après avoir contourné la ville de Belley, nous sommes rapidement à Culoz. Cette étape est un peu plus longue que prévue et nous avons eu le vent de face tout du long, ce qui ajoute à la difficulté. Pour ma part je n’avais pratiquement pas pédalé depuis plus de quatre mois et je ne suis pas mécontent d’arriver. Evelyne avait réservé deux places au gîte communal. Nous nous rendons à l’office du tourisme, où nous recevons un accueil de premier plan. On nous remet une clef et après un dernier petit coup de collier sur une route particulièrement raide nous y voilà. Quelle n’est pas notre surprise une fois à l’intérieur, une petite chambre à quatre manifestement occupée, et un grand dortoir de 16 places dans un foutoir indescriptible, des sacs et des habits partout. Nous ne sommes pas en mesure d’identifier si certaines des couches sont disponibles. En effet un groupe de parapentistes parisiens, a envahi les lieux. Il ne nous faut pas longtemps pour tomber d’accord et partir à la recherche d’un autre lieu pour passer la nuit. De retour à l’office du tourisme, la dame toujours aussi serviable nous indique un hôtel à cinq kilomètres en bordure du Rhône. Nous y serons très bien logés, et il constituera notre base pour les deux jours à venir.
Le lendemain matin après une bonne nuit enfin nous partons à l’assaut de cette montagne impressionnante qui nous bouche tout l’horizon. Nous démarrons en suivant le Rhône sur quelques kilomètres en empruntant une piste peu confortable, qui me rappelle un peu les pistes d’Amérique du sud, cependant en meilleur état. En effet la grosse différence, là on peut s’arrêter de pédaler et le vélo continue sur sa lancée en ralentissant doucement. Sur les pistes du Pérou ou de Bolivie quand elles sont mauvaises, il faut en permanence forcer sur les pédales, sous peine d’un arrêt immédiat comme si le vélo était collé à la piste.

De retour dans la petite ville de Culoz nous entamons la montée de dix huit kilomètres qui va nous conduire au col tant désiré. Le départ entre les maisons est particulièrement raide, ensuite l’inclinaison diminue, et la route fait de larges lacets sur un immense flanc de montagne. Le temps semble vouloir se mettre au beau. De grandes déchirures bleues apparaissent dans la couverture nuageuse, des rayons de soleil nous réchauffent par intermittence. Nous prenons rapidement de la hauteur et la ville apparait un peu comme si nous la survolions en avion. La montée en forêt est agréable à cette époque, où l’on voit que la nature évolue très vite. Partout le vert tendre des jeunes pousses domine. Nous sommes tranquilles, très peu de circulation. Nous croisons un cycliste qui vient du sommet et qui en guise d’encouragements nous lance « à la descente c’est plus facile ».

Après une dizaine de kilomètres, la chaussée se redresse et maintient une inclinaison à quatorze pour cent sur trois kilomètres. Je trouve cette section très difficile et me traînant entre quatre et cinq à l’heure il me faut presque trois quart d’heure pour en arriver à bout. Cela me semble long, cette sensation étant accentuée par la vitesse quasiment nulle qui me demande cependant de gros efforts. Evelyne, elle ne semble pas souffrir. Elle me distance facilement, mais de loin en loin elle m'attend.
Cet obstacle passé de nouveau la route affiche une pente plus humaine. Le temps se couvre à nouveau et la température baisse, le bout des doigts et des pieds nous pique. Enfin le col et ses 1501 mètres. Quelques plaques de neige sont présentes de part et d’autre de la route. Nous ne nous attardons pas et bien emmitouflés nous nous engageons dans la descente sur le versant est, réputé le plus difficile à la montée. Le topo annonce des passages à vingt deux pour cent. A la descente cela ne nous pose pas vraiment de problème, si ce n’est qu’il ne faut pas se laisser embarquer par des vitesses trop importantes sur une route étroite couverte par endroits de résidus de bois et sciure, laissés par les forestiers qui entretiennent la forêt.
Une fois au pied de la montagne nous mangeons notre casse-croûte dans un petit village près de la fontaine. Nous ne nous attardons pas car le vent, le froid et les nuages ne nous invitent pas à la contemplation. Rapidement nous rejoignons Culoz, notre point de départ. De la fontaine à cette même fontaine de cette petite ville mon compteur affiche quarante trois kilomètres, dont un peu plus de dix huit de montée. Contents de notre effort nous entrons dans un café afin de nous réchauffer. Nous engageons la conversation avec des personnes du cru, qui nous parlent en particulier de la cueillette des champignons dans la région. Tout étonné j’apprends que la truffe y est relativement abondante et qu’elle peut parfois y atteindre de belles tailles. J’apprends de même que les premières morilles ont poussé cette année.
Après un moment d’échange bien agréable nous rejoignons notre hôtel en bordure du fleuve. J’en profite pour discuter avec un pêcheur qui attrape quelques belles perches en pêchant au ver. La journée aura été bien remplie et demain nous comptons rejoindre Crémieu en suivant en partie la vélo-route du Rhône. Notre dernière étape ne devrait pas être loin d’une centaine de kilomètres.
Ce soir comme la veille le dîner est gargantuesque dans notre hôtel « les Palières », au demeurant fort sympathique.
Vendredi matin, la nuit a été froide. Le beau temps se maintient mais le vent une fois de plus va nous être opposé toute la journée. Nous allons avoir l’occasion de tester sur une soixantaine de kilomètres la vélo-route du Rhône. Les premiers kilomètres sont effectués sur une piste caillouteuse, mais rapidement une jolie route goudronnée, aménagée pour les cyclistes va nous permettre une progression très agréable, au vent de face et au froid près. Le plaisir n’en demeure pas moins intense. Pratiquement personne sur le bord

du fleuve en ce matin. Furtivement un chercheur de morilles se glisse dans les bois le couteau à la main. Un couple d’un certain âge en tandem nous croise. Dans certaines sections la piste serpente à proximité immédiate de l’eau. Le vent froid donne une couleur bleue métallisée à l’eau qui frissonne en surface. Par endroits le fleuve s’étale sur de larges zones, là où se trouvent des barrages. A plusieurs reprises nous passons de grands étangs voire des lacs contigus au Rhône. Bien que nous soyons en période de vacances, nous ne voyons vraiment personne, sans doute le froid est responsable de la désaffection momentanée des lieux. J’imagine qu’au milieu de l’été, en pleine canicule, ces grands plans d’eau doivent s’animer d’une foule de baigneurs et d’adeptes des sports nautiques.

Dans un village charmant, Bruyère, possédant un remarquable four à pain, nous effectuons quelques emplettes pour le pique-nique. Une vieille dame nous aborde. Elle nous dit qu’à l’époque de sa jeunesse, elle était une grande pratiquante du vélo-tourisme. Avec son mari, elle chargeait les enfants sur le porte-bagages ou dans une remorque et elle partait à la découverte de la France. C’est avec une grande nostalgie qu’elle nous regarde reprendre notre chemin. Encore quelques passages magnifiques au milieu de véritables explosions de fleurs de toutes parts et nous arrivons à Grollet. Là des tables nous invitent à la halte de midi avec un beau soleil nous accordant ses faveurs.

Nous prenons notre temps, sentant que ce court périple de trois jours est trop rapidement proche de son terme. Nous nous verrions bien continuer, par exemple poursuivre notre route en compagnie du Rhône jusqu’à la mer Méditerranée, et puis partir rejoindre du côté de Montpellier le canal du Midi. Il nous emmènerait jusqu’à Bordeaux. Mais ne rêvons pas trop, notre route va quitter le fleuve et nous conduire à Crémieu.

Là, je laisserai Evelyne et rentrerai chez moi à Lyon. Ces trois jours passés auront été une parenthèse fort agréable, où contacts à la nature et efforts physiques se sont alliés à merveille pour notre plus grand bonheur. Mais nous savons qu’il ne s’agissait là que d’un prélude, car au mois de mai nous partirons deux semaines à la découverte des Causses et des Cévennes, c'est-à-dire de grands espaces sauvages aux pentes multiples, qui nous apporteront à coup sûr dépaysement et plaisir de l’effort intense.

20:41 Publié dans expérience vécue, voyage à vélo | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : grand colombier, rhône, culoz, bugey, crémieu