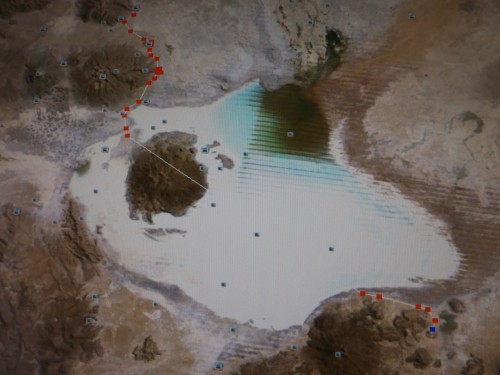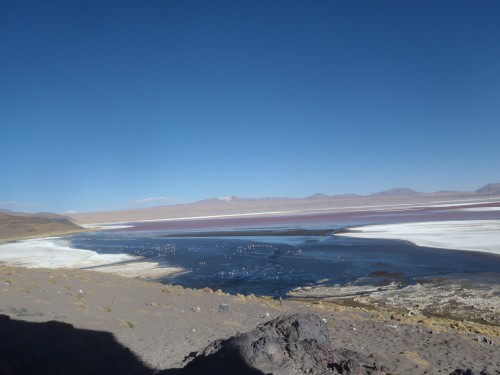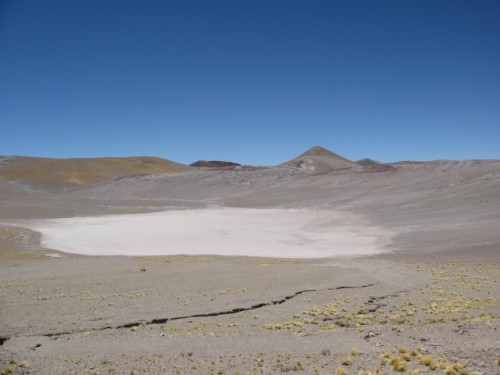08/01/2015
Traversée de l'Atacama à vélo
Un voyage de deux mois à vélo à travers le désert de l'Atacama de Arica au nord du Chili jusqu'à Santiago sa capitale, en passant par la Bolivie et l'Argentine sur une distance d'à peu près 3600 kilomètres, à travers l'une des plus arides régions du monde, est un projet enthousiasmant que nous nous apprêtons à entreprendre à partir du 16 octobre, sur une période de deux mois Flora et moi.
Pour celles et ceux qui ne prendraient pas le temps de suivre ce voyage dans les détails, je rajoute une synthèse de 5 minutes de ces 40 jours sur la planète Mars:
https://www.youtube.com/watch?v=CvVUzUv-gDw
Elle est suissesse, elle a la grosse pêche physique et comme moi est fascinée par ce coin de la planète. Elle a renoncé à son projet initial, le parcourir en véhicule 4X4, choisissant de l'affronter à la loyale à la force des mollets et au moral, les deux étant intimement liés. Partir de cette façon sans se connaître, ayant simplement communiqué par le net et avoir déjeuné ensemble un jour dans la magnifique ville d'Annecy peut apparaître un peu comme un jeu de roulette russe. Mais il ne faut pas longtemps pour se jauger et juger de la motivation de l'autre. Le challenge lorsque la barre est assez haute se charge de vite souder l'équipe, chacun tendu vers le but à atteindre, sachant que l'entraide devient un besoin vital. Si la fin du chemin en elle-même ne représente rien de particulier, les efforts deux mois durant en vue d'y parvenir devraient créer l'esprit du chemin de l'aventure à laquelle nous aspirons.
Le vélo dans ces coins reculés rend à la planète sa dimension. Se soumettre de cette façon aux caprices du temps, du vent, du froid, du sable et peut-être de la neige sans savoir où l'on va pouvoir s'arrêter et poser sa tente si possible à l'abri de bourrasques furieuses et subir les aléas du ravitaillement tout particulièrement sur les mille premiers kilomètres, cela crée les conditions qui nous attirent irrésistiblement, mais qui nous inquiètent aussi un peu. Ne pas se perdre, assurer dans tous les cas le minimum en particulier l'eau, bien prendre garde aux longues nuits durant lesquelles la température descend en-dessous de moins dix et bien d'autres choses.
Dans quinze jours l'aventure démarre. J'ai un peu de mal à l'imaginer, bien au chaud dans mon salon.
Dans un premier temps la préparation de l'itinéraire permet de rêver sur des cartes absolument extraordinaires dévoilées par Google earth. Cette région d'Amérique du Sud vue du ciel ressemble à la lune voire à la planète Mars, que l'on appelle aussi la planète Rouge.
Je me donne encore une semaine de vacances dans les Vosges entre cueillette des cèpes et pêche à la truite dans le dernier lac encore ouvert à cette activité après le 15 septembre, le lac des Corbeaux. En fin de semaine prochaine, retour à Lyon et préparation du matériel, du vélo et de quoi réparer la casse; les habits, le couchage, la tente, le réchaud et les gamelles, les appareils photo, l'intégration des données dans le GPS et plein d'autre choses. Les bagages devront être le moins lourds possibles, mais ce sera autour des 25 kilogrammes.

Sur cette première photo notre itinéraire est matérialisé en rouge, et se développe sur 3500 km. On constate que nous allons rester pratiquement tout le long dans des zones désertiques. Juste au nord de la trace rouge on distingue une tache bleue allongée, il s'agit du lac Titicaca, à la frontière du Pérou et de la Bolivie.
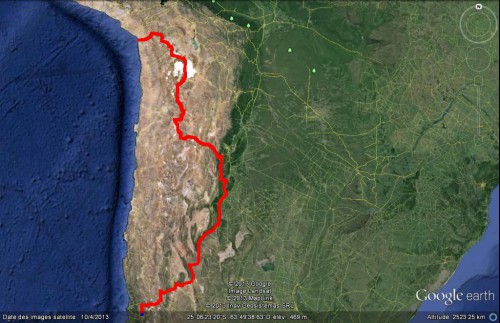
L'itinéraire complet plus en détail

Le trajet de Arica à San Pedro de Atacama qui se développe sur plus de mille kilomètres dont 800 de piste et de sel. Il est détaillé sur les trois vues suivantes.
Cette première partie devrait nous prendre trois semaines. Elle représente la plus difficile, par le fait que nous serons en permanence en altitude(à part le début de la montée partant de la mer et nous conduisant à 4500m) au-dessus de 3600 mètres, et souvent au-dessus de 4000, et parfois frisant ou dépassant de peu les 5000 en particulier dans le sud Lipez. La difficulté sera aussi directement liée à la quasi-absence de route goudronnée et parfois à la disparition de la piste dans le sable et les pierres. Le ravitaillement devra être étudié avec minutie car les quelques villages traversés ne seront pas en mesure de nous proposer un réel choix d'aliments. Nous allons compter sur un stock de pâtes et de riz. Cependant nous espérons rencontrer de loin en loin dans ce nul part des petits restaurants improbables où nous pourrons manger à l'abri du vent, et éventuellement trouver un toit afin d'éviter de dormir dehors.

La première partie du trajet d'Arica au salar de Coipasa sur une distance d'à peu près 500 km dont plus de la moitié hors route goudronnée.

La seconde partie du voyage, sans doute la plus étonnante sans être la plus difficile. Entièrement en dehors des routes, uniquement sur pistes ou directement sur le sel des deux salars de Coipasa et Uyuni, sur une distance de 300 km. L'altitude des salars est de 3600 mètres.

La troisième partie de notre périple, le sud Lipez, passage de 400 km; à part l'arrivée à San Pedro de Atacama par route goudronnée, nous serons sur des pistes sableuses où parfois il faudra pousser les vélos, l'altitude rapidement après avoir quitté le salar d'Uyuni se situe entre 4000 et 5000 mètres, avec un court passage au-dessus de cette dernière altitude.

La quatrième partie de notre voyage de San Pedro de Atacama à Salta nous fera passer par le paso Sico la frontière du Chili et de l'Argentine. Nous retrouverons des pistes et peut-être des routes goudronnées!
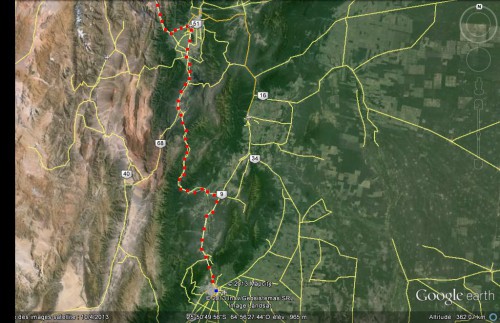
La cinquième partie de Salta à San Miguel de Tucuma 300km
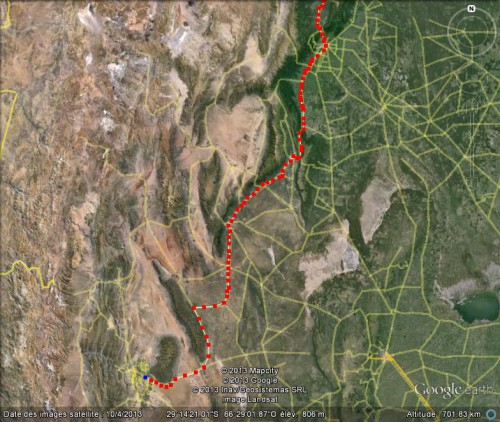
La sixième partie de San Miguel de Tucuma à San Juan 700 km

Dernière partie de la Rioja à Santiago du Chili
Je reviens plus précisément sur la partie de notre voyage qui a trait aux salars de Coipasa et d'Uyuni, ainsi que sur la région du sud Lipez.

Les traits jaunes matérialisent les frontières entre le Chili à gauche, la Bolivie en haut et l'Argentine à droite et en bas.

Au centre de la vue ci-dessus les deux taches blanches sont les salars de Coipasa et d'Uyuni, celui du haut le plus petit a une superficie de 2500 km2 et une largeur de soixante kilomètres et le second Uyuni s'étend sur 12000 km2 et dans sa grande largeur dépasse les 150km.
Ci-dessus le salar de Coipasa d'une superficie de 2500 km2 et de soixante kilomètres de large.
La zone entre les deux salas de Coipasa et de Uyuni, le chemin matérialisé est d'environ 70 kilomètres.

La Laguna Colorada
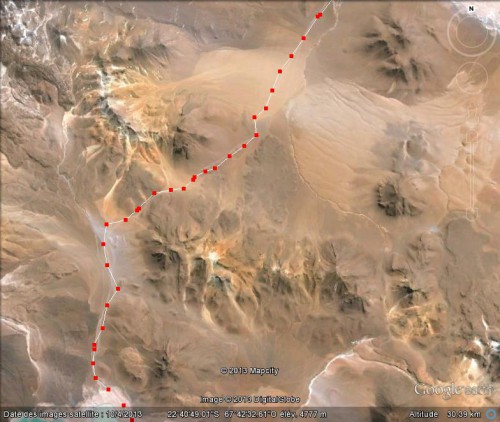
Désert de Dali

La Laguna Verde et le volcan Licancabur qui frôle les 6000m, ce sera la fin du sud Lipez. la route en bas de l'image est goudronnée et en 2000 mètres de dénivelé elle conduit à San Pedro de Atacama
Ci-dessus différentes vues de la région la plus envoûtante que nous allons traverser, le sud Lipez. 400 km de piste et de sable entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Le rêve de tout cyclo-rando. Ceux qui en reviennent en parlent comme d'une expérience unique dans le vent le froid l'altitude, les pistes instables, mais l'incroyable beauté de l'une des régions les plus sauvages de notre planète.Terre perdue semée de lacs salés aux couleurs changeantes, du vert au rouge en passant par le bleu et le jaune, parmi lesquels jaillissent des volcans pour certains actifs et qui montent jusqu'à 6000 mètres. Dans cet enfer subsistent les flamants roses et les Vigognes, ainsi qu'un drôle de gros lapin à la queue en tire-bouchon, la viscache. Au cours de mes périples à vélo, lorsque j'ai rencontré des cyclistes lancés dans un tour du monde, le coin qui les a le plus fortement marqués c'est justement ce bout de Bolivie perché à la frontière chilienne. Tous, sans exception, cette traversée ils en parlent comme d'une révélation, et l'on comprend que c'est la plus forte expérience à vélo qui les a marqués de façon indélébile.
J-2 lundi 14 octobre
Les sacs sont pratiquement bouclés. J'ai mis mon vélo en carton. C'est toujours une opération qui demande du temps, car dans les transports aériens les bagages sont malmenés, et les vélos sont des engins fragiles. Notre parcours aérien va nous mener de Lyon à Madrid puis à Santiago du Chili et enfin à Arica près de la frontière péruvienne. Cela fait trois transferts, ce qui augmente d'autant les risques de casse. En confectionnant mon paquet j'ai à l'esprit toutes les manipulations que cela va nécessiter. Il ne faut pas trop y penser!
Ensuite j'ai préparé mon sac avec le matériel pour cette aventure, de quoi camper par grand froid, les habits, le matériel de réparation du vélo et le reste. Cela fait un peu moins de vingt kilos. En route, il faudra selon les tronçons ajouter jusqu'à 10 kilogrammes entre l'eau et la nourriture. Donc une addition rapide me permet d'évaluer le poids de ma monture avec moi dessus à 110 kilogrammes.
L'élément le plus lourd, la tente représente 3,1 kilos. Mais cet abri sera essentiel dans la réalisation de notre aventure. En effet, il faut s'attendre à des températures basses en-dessous de -10 et des vents violents. Donc ,une tente adaptée aux conditions très difficiles (en particulier résistance au vent) est essentielle afin d'assurer des conditions de sécurité minimales.
Le vélo comme moyen de voyager laisse libre cours à tous les espoirs d'aventure, en nous permettant une vraie confrontation avec la nature. Cela me rappelle mes lectures, en particulier les fabuleux écrits d'Ella Maillart, "croisières et caravanes" et "oasis interdites", pour n'en citer que deux. Dans les années trente elle arpentait les grands déserts d'Asie à pied et à dos de chameau. Elle narre cela de façon remarquable. En hiver, durant de longues semaines elle dormait en se protégeant du froid et des intempéries en se collant au corps de son chameau. Ces récits m'ont fortement marqué et cette envie de traverser de grands déserts, comme nous allons le faire, je la dois en partie à cette Suissesse, qui représente l'une des plus grandes exploratrices de tous les temps. Les déserts attirent par les conditions extrêmes qui y règnent. Ce qui m'interpelle et me fascine aussi, ce sont les noms qu'ils portent. Les plus grands sont largement pourvus en a, Sahara, d'Ad Dahna, Atacama, Taklamakan, respectivement situés en Afrique, dans la péninsule arabique, en Asie et Amérique du sud. Je me souviens d'une époque où je partais pour une mission de plusieurs mois en Arabie. Je m' y étais rendu à bord d'un avion militaire Hercule. Il ne volait pas très haut et nous avons traversé toute la péninsule arabique de la mer Rouge jusqu'au golfe Persique. J'étais resté fasciné, le front collé au hublot assis sur un missile, des heures à regarder défiler ces terres mystérieuses comme n'appartenant pas à notre planète. Cette expérience m'a aussi fortement marqué et sans doute l'envie de me plonger dans ces régions "hors de notre Terre" n'y est pas étrangère.
J
Ce matin je suis allé chercher Flora à la gare de la Part Dieu. Puis nous avons mis son vélo en carton. Le voisin nous a donné un bon coup de main pour desserrer ses pédales, en s'aidant d'un bras de levier d'un bon mètre. A 14h les vélos étaient sur le toit de la voiture et mon frère nous emmenait à l'aéroport. Sans problème nous avons pu les faire embarquer.
J+1
Nous sommes en transit à Santiago après un long voyage de 13 heures et nous avons 12 heures d'attente avant de faire la dernière partie de notre trajet en avion pour notre mise en place à Arica; Les bagages et les vélos à la consignes, quand même 40 euros pour deux, nous sommes partis faire un tour au centre ville où nous sommes en train de déjeuner dans un petit restaurant. On a profité de l'occasion pour faire du change en monnaies chilienne et argentine, mais pas de possibilité d'avoir des bolivaros. On espère à Arica, car à la frontière à Parinacota, il ne faut pas y compter. Nous avons aussi prospecter pour voir les possibilités de trouver de quoi emballer les vélos lors de notre retour, certain pour moi par Santiago et possible pour Flora. Les vélos procurent un moyen de voyager fabuleux mais procurent aussi beaucoup de soucis pour les faire accepter dans les avions.
Ce matin, la vision de l'avion alors que nous traversions le Andes pour passer d'Argentine au Chili était fabuleuse. Nous avons pu admirer l'Aconcagua dans toute son immensité. Bien entendu la première pensée qui vient à l'esprit c'est l'exploit moult fois répété par les pilotes de l’aéropostale, Guillaumet, Mermoz, Saint Ex et les autres, qui vers les années 1930 franchissaient cette immense barrière que je contemple bien au chaud dans notre boing 787. Eux, il leur arrivait de sortir à pied de la chaîne montagneuse, suite à un crash, après avoir bataillé des jours dans la neige, animés d'un farouche instinct de survie. il faut lire le "Mermoz" de Kessel.
Notre dernière partie du voyage s'est bien commencée sans problème pour l'embarquement de nos vélos.
J+2
Tout début de ce vendredi 19 nous arrivons à 0h15 à Arica. Pas de chance nos sacs étaient dans les derniers à sortir de l'avion, mais nos vélos dans les premiers et les cartons étaient en bon état, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été maltraités au cours de ces trois changements entre Lyon et Arica.
Par contre pour trouver un taxi voulant prendre ces volumineux paquets, nous avons bien cru que nous n'y arriverions pas. Il s'en est fallu de peu que nous nous mettions à les remonter dans la nuit afin de parcourir les 18 km qui nous séparent de la ville. Pas terrible, surtout qu'il s'agit sur une partie de la terrible panaméricaine que j'avais expérimentée sur 600 km en Équateur, expérience dont on se souvient, mais c'était de jour, j'imagine difficilement ce que cela donne à deux heures du matin.
Mais un chauffeur de taxi a eu pitié de nous et a téléphoné à un de ses copains qui est venu avec une camionnette, et voilà comment à deux heures du matin nous nous sommes retrouvés dans un lit après 33 heures de voyage.
Lever 7h15. Petit déjeuner sympa, mais nous n'avons pas vraiment faim. En effet, nos organismes n'ont pas encore bien pris en compte les six heures de décalage.
Ensuite, opération de remontage des vélos. Tout se déroule pour le mieux. Apparemment ils n'ont absolument pas souffert. Il faut reconnaître que nos grands cartons qui nous ont permis de ne pas démonter les roues arrières sont très pratiques même si pour le transport ils nous causent plus de soucis.
Premier contact avec la ville. Elle est vraiment dans le désert, qui la cerne de toutes parts. Par endroits, on a vraiment l'impression qu'il veut déferler à travers les rues. Notre première préoccupation, faire les réserves suffisantes pour la première partie de notre voyage, 1000 km au cours desquels les possibilités de ravitaillement risquent d'être faibles, même si nous espérons trouver de loin en loin des lieux improbables, où il sera possible de manger une platée de riz ou des pâtes.
Les commerces sont nombreux, nous trouvons des cartouches de gaz. Nous achetons trois kilos de riz et quelques sacs de pâtes ainsi que tout un assortiment de denrées, salées et sucrées. Sur les trois semaines à venir nous devrions passer la moitié des nuits dehors, donc notre fond de nourriture devrait nous permettre de tenir. En effet nous ne pouvons pas nous permettre de trop prendre car le poids est un ennemi redoutable. Nous allons chacun avoir des charges aux environs des 25 kilos, et la première côte fait deux cents kilomètres et 4600 mètres de dénivelé.
Nous sommes allés nous promener au bord du Pacifique regarder les pêcheurs qui tiraient leurs filets à partir de barques en tout point semblables aux pointus de Méditerranée. Je n'étais pas le seul intéressé. En effet des phoques suivaient les bateaux en attente d'un poisson rejeté.
Arica vue des hauteurs surplombant la mer
J+3 66 km 1550 mètres de dénivelé
Nous petit-déjeunons, les vélos sont chargés. L'aventure va commencer. On nous a mis en garde contre la difficulté de la route à venir du fait de l'interminable montée. Le propriétaire de l'auberge qui nous reçoit connaît remarquablement sa région. Il nous parle avec passion de tous les géoglyphes, ces immenses dessins à même la caillasse dans le désert. Il nous fait part de ses réflexions et de son expérience sur le mal des montagnes, la pouna. Elle n'est pas due simplement à l'altitude mais aussi aux forces telluriques du coin. Par exemple il nous affirme qu'à Putre, petite ville pas loin de la frontière avec la Bolivie, où nous passerons, bien que l'altitude ne soit que de 3500 mètres, il y ressent la pouna, alors que plus au sud au salar de Souriré à 4200 mètres il n'en ressent pas les effets! Nous verrons.
Nous commençons par longer l'océan Pacifique sur 12 kilomètres puis nous pénétrons dans le fameux désert de l'Atacama. La route est enserrée entre d'immenses dunes aux teintes multiples. Les 38 premiers kilomètres sont presque plats, 400 mètres de dénivelé. Un restaurant avant le début des grandes pentes. Nous nous y arrêtons, mais il n'est que 11H30, donc rien n'est cuit. On se contente d'un sandwich.
Nous reprenons notre route et de suite une immense rampe fait tomber la moyenne à 5 voire 4km/h. En effet, nous sommes très lourds, car nous avons une quinzaine de jours de nourriture en prévision des déserts boliviens. Mais il nous faut d'abord franchir ce premier obstacle avec un passage à 4600 mètres. Une montée de presque 200 km. On essaie de ne pas trop penser.
Une dizaine de kilomètres plus loin un autre restaurant. Il est 13H30, donc tout est cuit, et nous nous régalons. La patronne nous affirme que le prochain point de ravitaillement se trouve à 30 kilomètres. Nous partons donc pas très chargés en eau, avec l'intention de bivouaquer vers la moitié du trajet et demain vers les 10 heures pouvoir nous ravitailler. Mais l'information s'avérera fausse, le prochain point est à 62 kilomètres et 1700 mètres plus haut à 3200 mètres d'altitude.
Nous partons donc confiants dans des pentes gigantesques au milieu des camions. Mais les chauffeurs sont très courtois avec nous et nous gratifient de grands bonjours. Les bords de la chaussée sont très raides. Va-t-on trouver un endroit où poser la tente?
Vers les 19h, une petite gorge en amont. Je vais jeter un coup d’œil. A une centaine de mètres de la route une petite plage de sable, idéale pour notre tente.
Rapidement elle est montée, le camping gaz est mis en œuvre et nous mangeons une bonne platée de riz et sombrons dans le sommeil.
J+4 lieu de bivouac à Zapehuria altitude 3200, 45 Km 1800 mètres de dénivelé
Après une nuit longue et réparatrice nous attaquons confiants en direction de cette station à 14 km. Elle n’est pas là, nous faisons huit kilomètres supplémentaires. Sur le bord de la chaussée un 4X4 arrêté. Le propriétaire nous dit que le prochain point d’eau est à plus de vingt kilomètres. Nous n’avons plus une goutte d’eau, il fait plus de trente degré et la pente est très raide. Avec nos vélos lourdement chargés en matériel et nourriture en prévision des pistes désertes à venir, nous nous traînons à six à l’heure. Je lui demande de l’eau. Il n’en a pas. A ce moment un camping-car freine. Sa plaque d’immatriculation est française, le 83 montre que le couple qui est à l’intérieur vient du Var. Je réitère ma demande. Le véhicule vient se garer et voilà comment nous remplissons toutes nos bouteilles, ce qui fait plus de sept litres.
Nous discutons un peu avec ces gens qui sont sur la route depuis treize mois. Puis chacun reprend sa route, eux vers le bas et nous dans cette pente infernale. Et la chaleur de plus en plus terrible qui se concentre comme dans un four le long de ces parois claires. Rapidement nous faisons une pause et le réchaud est mis en action pour des pâtes. Mais la chaleur est tellement pénible que nous replions vite tout et reprenons notre ascension. Il est hors de question de pouvoir s'assoupir, on a vraiment l'impression de cuire.
Vers les 17h nous rencontrons un camion en panne. Le chauffeur me demande si j'ai de quoi réparer. Je sors tout ce que j'ai pour réparer un vélo. Mais un camion ce n'est pas un vélo! Cependant notre camionneur ne perd pas sa bonne humeur et la conversation va bon train. Pour lui expliquer qu'un homme et une femme qui voyagent ensemble ne vivent pas ensemble est presque mission impossible. Il nous raconte sa vie entre deux "ports" La Paz et Arica!
On l'abandonne à son sort. La pente faiblit. Nous sommes sur un immense plateau. Mais rien à l'horizon. Puis soudain derrière une bosse du terrain le havre salvateur se révèle .
Nous y trouvons une chambre et mangeons très bien. Puis nous nous enfonçons dans un long sommeil de 10 heures.
J+5 Zapehuria à Putré 32 km altitude 3400, dénivelé 732 mètres
Après les efforts des deux premiers jours nous décidons de faire une étape courte. En effet, commencer à tirer comme nous venons de le faire avec des charges de trente kilos, alors que nous sommes partis pour un voyage de deux mois ce n'est pas très bon.
La route s'humanise. Aux côtes pas très longues et pas toujours raides succèdent des parties plates et des descentes. Les grands volcans sont de plus en plus présents. Ils sont enneigés de frais.
On nous a dit que vers les 4000 il avait neigé la semaine dernière. Paradoxe de ces pays, un jour on étouffe et le lendemain il neige. Nous surplombons Putré en passant un col à l'altitude de 3550 mètres. D'un joli point de panorama nous contemplons la ville et le trajet qui nous mènera à la frontière 1000 mètres plus haut. Nous y rencontrons un motard australien qui parle couramment le français du fait de sa mère.
Arrivés à Putré un peu après midi nous trouvons une auberge "Hostal Cali" très accueillante. En plus elle est pleine de chats qui se vautrent partout et qui n'arrêtent pas de faire miaou-miaou.
Je crains que le prochain point de contact internet ne soit à San Pedro de Atacama après 900 km de piste et vingt jours. Mais il n'est pas impossible que nous ayons une bonne surprise demain à Tombo Quémado ou dans une semaine à Sabaya avant d'attaquer le salar de Coipasa. Mais je fais le max pour donner des nouvelles, mais pas de panique s'il y a un silence de vingt jours. Merci Bertrand et bises à tous.
Nous somme arrivés à San Pedro de Atacama
Bonjour nous venons de terminer la première partie de notre périple. 1000 km dont 800 de pistes dans des conditions parfois difficiles. On a poussé les vélos dans le sable et la caillasse volcanique entre 50 et 60 km.
Deux bivouacs d'anthologie entre 4600 et 5000 mètres d'altitude. Un passage dans une fournaise collés dans une espèce de talc avec 45 degrés du côté de Sacabaya. Un camion improbable nous a sortis de ce sale pas.
Le sud Lipez c'était vraiment la planète Mars sur 400 km. L'épreuve a été facilitée par deux qualités de Flora, un moral d'acier et une puissance digne d'un tracteur. Demain j'essaie de vous raconter ces vingt jours de folie et surtout de vous mettre de belles et surprenantes photos entre lagunes multicolores et mers de sel ou momies de plus de 5000 ans conservées dans ces montagnes les plus sèches du monde.
Je reprends le fil de notre aventure là où je l'avais laissé il y a 15 jours:
L’étape après Putré nous a conduits à passer un col à plus de 4600 mètres dans un décor magnifique, deux volcans à plus de 6000 mètres couronnés de neige. Le cumul du dénivelé depuis notre départ du niveau de la mer à Arica s’élève à plus de 5700 mètres. Le passage de frontière s’effectue sans difficulté. Notre arrivée à la tombée de la nuit dans la ville frontière bolivienne de Tombo Quemado dans un froid et un vent terribles est pour le moins patibulaire. Ces villes frontières fourmillent de personnes prêtes à vous arracher une sacoche ou plus. Les cyclos lourdement chargés sont particulièrement vulnérables. Mais à deux on s’organise, et mon expérience du vol quasiment à l’arrache, que j’ai subi il y a quatre ans au Pérou a été très formatrice. On détecte de ce fait plus facilement les individus qui ont l’intention de s’emparer de nos affaires. Je vais cependant y laisser mon compteur de vitesse pour un oubli de quelques minutes sur la table du «restaurant» où nous avons mangé une platée de riz. Ce qui m’a forcé à mieux utiliser mon GPS afin de connaître les kilométrages effectués.
Après une nuit fort médiocre nous dégarpissons au plus vite de cet endroit sordide. L’équipement des vélos se fait sous haute surveillance d’un voleur qui guette la moindre inattention de notre part pour s’enfuir avec une partie de nos affaires. Flora pige vite le processus d’action de ce sordide individu et elle le maintient à distance pendant que je descends les bagages.
Les vingt premiers kilomètres sont rapidement avalés sur une piste roulante bien qu’il nous faille un peu pousser les vélos dans les pentes trop raides pour nos charges importantes. Dans le deuxième village, nous recherchons un point d’eau. Le lieu semble désert. Cependant nous détectons un mouvement dans une cour. Nous demandons de l’eau. Gentiment un homme nous remplit nos bouteilles vides. Il en profite pour nous indiquer un chemin plus court. Enfin les vélos chargés nous prenons le large. Le premier point de mon GPS nous donne la direction des pistes plein sud que nous allons suivre durant 800 km. Il est toujours assez inquiétant de se lancer comme cela à travers des régions réputées les plus arides du monde, avec comme seules indications des points GPS «piochés» sur Google earth. Quant à la nourriture et à l’eau on ne peut que se fier à nos estimations pleines d’incertitude.
L’information s’avérera complètement erronée du fait de la confusion entre le village de Sacabaya et la laguna de Sacabaya. Après quelques kilomètres nous allons être piégés dans des sables inconsistants au milieu d’une immense plaine bordée de grands volcans, dont l’un émet de ses flancs des panaches de fumée blanches. La température devient infernale. Notre moral en prend un sacré coup. Comment imaginer que nous allons traverser 800 kilomètres dans cet enfer absolument pas adapté au vélo?
Un camion, le seul que nous verrons de la journée nous dépasse et nous met en garde quant au piège dans lequel nous nous enfermons. Dans un premier temps nous refusons son aide. Quelques kilomètres plus loin nous réalisons que nous n’aurons pas l’énergie de nous sortir de ce terrain mouvant, de plus terrassés par une chaleur accablante. Dans le lointain nous distinguons le camion à l’arrêt. Nous allons dans sa direction. Il se met en marche et vient vers nous. Nous l’arrêtons et acceptons son aide. Il nous conduit vers ce fameux village de Sacabaya, au milieu de nulle part, à travers un terrain totalement inconsistant de poussière blanche.
Ce village du bout du monde est incroyable. Il y a un petit poste militaire qui contrôle les mouvements improbables. La frontière chilienne n’est pas loin, et les deux pays ne sont pas amis, depuis qu’au 19 ème siècle la Bolivie au cours d’une guerre a perdu son accès à la mer entre le Pérou et le Chili.
Nous débarquons avec nos vélos dans ce lieu étrange écrasé d’une chaleur suffocante. Qu’allons nous faire? Les militaires et le chauffeur nous regardent comme des bêtes curieuses et pas très sensées. Après un moment d’attente, on nous propose un logement dans un hôtel fermé sans eau ni électricité qui n’a sans doute jamais vu un client.
Nous attendons devant la porte fermée à clef un improbable propriétaire. Alors que nous commençons à désespérer un femme s’approche et nous propose de la suivre. Elle va nous offrir le gîte et le couvert pour une somme modique. Un problème de résolu. Mais comment allons nous sortir de cet enfer de poussière inconsistante? Alors le chauffeur vient nous avertir qu’à 5 heures, c’est à dire dans deux heures il part pour Négrillos, justement notre itinéraire y passe. Nous acceptons avec empressement son aide. Alors que nous préparons nos bagages, il nous dit de ne pas nous presser, car son départ est différé, puis il nous annoncera dans la soirée qu’il partira le lendemain matin très tôt. Après une nuit à ruminer nos incertitudes et à douter de nos capacités à affronter le défi de l’Atacama, nous nous préparons au départ en camion. Mais rien ne vient. Nous partons aux renseignements. Nous apprenons par personne interposée que le départ est prévu pour midi, puis pour 14 heures.
Alors que nous commençons à douter sérieusement de la fiabilité du chauffeur, il nous annonce qu’il partira à 15 heures et cette fois en direction de Sabaya à proximité du salar de Coipasa. Nous n’hésitons pas et acceptons l’offre, cela nous recalera sur un terrain moins mouvant où nous pourrons décider de la suite de notre projet. Mais le moral n’est pas haut et nous pensons bien abandonner pour prendre la direction du bord de l’océan Pacifique et cela même quasiment avant d’avoir engagé le combat. Après un transport de plusieurs heures dans un décor dantesque, nous voilà à Sabaya. Le moral remonte un peu, et nous décidons sans réelle conviction de nous remettre dans le course. Nous faisons quelques provisions chez l’hôtelier épicier en prévision de la traversée des salars de Coipasa et d’Uyuni et du sud Lipez, ce qui représente une distance de plus de 600 kilomètres par des pistes réputées infernales. Je me dis que si cela se passe mal nous aurons la possibilité de nous échapper soit vers la ville d’Uyuni ou cent kilomètres plus loin en direction de la frontière chilienne.
Nous voilà donc partis lourdement chargés en direction de Villa Vitalinia petit village sur la route donnant accès au salar de Coipasa. Tout se passe pour le mieux, la vingtaine de kilomètres est effectuée rapidement sur une piste acceptable. Une fois en ce lieu, nous complétons nos réserves d’eau. Je suis toujours étonné de constater que dans ces villages en plein désert, à proximité d’une mer de sel on trouve des robinets qui délivrent une eau fraîche de bonne qualité, mystère de la nature. Des ouvriers en plein travail nous saluent. Ils nous indiquent un chemin direct pour le salar. Nous voilà mettant le cap plein sud vers ce premier miroir blanc de 50 km qui s’ouvre devant nous. Commence alors ce genre d’expérience qui reste gravée en soi pour la vie.
Les roues crissent sur cette surface de sel. Je sais que cette entrée se fait par une zone humide, mais l’assurance des ouvriers quant à la dureté du sol nous a enlevé toute hésitation. Effectivement, le sol ne se dérobe pas sous nos pneus, même si parfois nous traversons des flaques. Les vélos se couvrent de sel, qui s’accroche en gros conglomérats un peu partout. Nous louvoyons entre des mares parfois importantes sur une vingtaine de kilomètres. Puis toute trace d’eau disparaît et nous voilà sur un sol dur, tout accaparés par le plaisir fou de traverser un lieu aussi insolite. Nous sommes seuls, aucun mouvement de véhicule. La vue porte loin. Mon GPS indique qu’il reste plus de trente kilomètres pour atteindre la rive sud qui semble cependant si proche. Lentement elle se rapproche. Il est important de sortir par une zone stabilisée afin d’éviter des efforts surhumains de poussage, les roues enfoncées dans des alternances de sable et de sel, qui bordent les abords des déserts de sel. Nous rejoignons un chemin, sableux en bordure sud . La chaleur est forte. Un village, nous y entrons, il est désert. Sur la place centrale, en réalité sur la zone sableuse qui en tient lieu un robinet. Nous en profitons pour faire un peu de lessive et nous nettoyer ainsi que les vélos, couverts d’une gangue de sel. La chaleur est terrible. Mais où est donc le chemin du village de Luca que mon GPS donne dans le sud est pour vingt kilomètres? Il nous faut absolument une indication. Nous partons doucement à travers les rues ensablées. Un chapeau immobile dans la fournaise, il dépasse d’un mur. Y a-t-il une tête dessous? Je l’interpelle par un «per favor» dans ce silence troublé uniquement par le vent, qui comme chaque après-midi monte en puissance. Effectivement, mon appel a un effet. Le chapeau pivote puis s’élève et une tête tirée du sommeil dans la torpeur ambiante nous regarde et répond à nos questions. Il nous faut repartir en direction du salar. Nous voilà à nous battre contre le sable qui obstrue le chemin. Vers les 18 heures nous décidons de nous arrêter et de monter la tente dans une légère dépression creusée par les eaux lors des rares précipitations. La tente est spacieuse. Nous avons de bonnes réserves d’eau et de nourriture. Une belle platée de riz est vite préparée et aussi vite engloutie. Le moral remonte après cette journée où nous avons effectué plus de 80 kilomètres dont 47 sur le sel.
Assister à la venue de la nuit dans un lieu aussi insolite s’apparente plus à un rêve qu’à la réalité.
Bien que nous soyons bien installés, l’effet de l’altitude plus de 3600 mètres se fait ressentir sur la qualité de notre sommeil. Au matin dans un air immobile nous déjeunons rapidement et plions vite notre matériel et nous voilà en route pour Luca que mon GPS donne à 10 kilomètres. Nous y voilà. A la recherche d’eau, une femme nous donne une indication et nous nous présentons devant une cour. Un homme nous invite à entrer. Il nous offre un plein seau du liquide précieux. Nous en remplissons nos nombreuses bouteilles. Nous lui demandons si nous pouvons faire une lessive, car nos habits sont complètement imprégnés de
sel. Son épouse nous prête une bassine et nous voilà lancés à neuf heures du matin dans la plus improbable lessive de notre existence. On nous vend même deux bananes que nous dégustons avec grand plaisir.
A dix heures après des remerciements chaleureux nous reprenons notre route. Elle escalade les hauteurs au sud du village. Cependant une trace directe à travers un «golfe» en bordure de salar nous laisse envisager un raccourci possible. Alors la chance nous sourit, un véhicule s’arrête et nous voyant dans l’hésitation le chauffeur nous confirme que si nous suivons cette trace à travers cette zone de sel et de sable nous arriverons à Alcaya, le lieu que nous cherchons à rejoindre. Comme souvent dans ces bordures de salar les parties très roulantes et les parties ensablées alternent. Globalement nous avançons de façon satisfaisante. Mais la chaleur devient infernale. Vers midi nous quittons définitivement la zone du salar pour la terre ferme. Il fait horriblement chaud, mais rien pour s’abriter. Flora remarque une buse qui passe sous la piste. Il n’en faut pas plus et nous voilà allongés à l’intérieur à la recherche d’un peu d’ombre à nous faire cuire une gamelle de riz. La situation me fait penser au livre de Bernard Ollivier.
En effet, lors de sa traversée du désert de l’Atlamakan en Asie il recourt aussi aux buses sous la route à la recherche d’un peu d’ombre. Sous notre piste nous profitons de ce moment de répit. Un bruit de moteur. De toute évidence il s’agit d’un deux roues. Je sors de notre trou et monte sur la piste. Le véhicule s’arrête et nous engageons la conversation. Le conducteur m’indique que le village d’Alcaya se situe à quelques kilomètres. Nous décidons donc de nous y rendre malgré la terrible chaleur qui nous écrase. Effectivement deux kilomètres plus loin sur notre gauche apparaît l’un de ces villages typiques, figés dans la désolation et l’absence apparente de vie. Nous y entrons. Dans une cour je vois deux femmes. Nous nous rendons au centre, où de drôles de constructions attirent notre attention. Il s’agit du fameux musée précolombien, qui retrace l’histoire d’une civilisation disparue il y a cinq mille ans d’après ce l’on nous expliquera. Pour le moment personne, tout est fermé et j’ai mal à la tête en proie à un début d’insolation. Je pars à travers le village à la rencontre des deux femmes entraperçues. Gentiment l’une d’elles m’accompagne jusqu’à la maison du couple qui pour une période de deux semaines gère ce site. L’épouse nous fait visiter le musée qui recèle quelques restes de cette civilisation perdue, puis le mari nous propose une visite de la ville morte dans la montagne. Nous acceptons mais seulement à partir de 18 heures en espérant que la chaleur devienne supportable. Ils nous invitent à prendre une douche, et nous découvrons de ce fait qu’il y a de quoi loger deux fous égarés dans cette fournaise. Il ne nous en faut pas plus pour profiter de cette occasion inespérée qui nous évite un bivouac dans des conditions difficiles.
A 18 heures, après avoir savouré la délicieuse omelette confectionnée par la maîtresse des lieux nous partons pour une incroyable visite dans la montagne sur les traces d’une civilisation disparue. Le guide et Flora marchent allègrement, pour ma part j’ai du mal à avancer encore sous l'emprise d’un coup de chaleur. Ce que nous découvrons est tout simplement stupéfiant. Une ville étrange, immense toute de pierre à flanc de montagne. Les constructions ressemblent à de petites borilles semi-enterrées. Il n’y a pas de porte, seulement un orifice à section carrée d’une quarantaine de centimètres de côté qui permettait aux habitants de se glisser dans leurs habitations. Cela me semble effrayant et je ressens tout le poids de la claustrophobie à l’idée de me faufiler à l’intérieur. Mais le plus surprenant provient des sépultures qui recèlent des momies conservées dans des conditions étonnantes de par les millénaires. Cela est dû à l’hygrométrie presque nulle de ces montagnes les plus arides de la planète. Absolument stupéfiant. Les images se passent de commentaires! Cette civilisation aurait été anéantie par la chute d’un météorite à quelques dizaines de kilomètres. On peut effectivement voir un cratère de belle taille pas très loin.
Le lendemain départ matinal malgré un quiproquo dû au fait que nous sommes restés à l’heure chilienne qui diffère de celle de Bolivie. La journée commence par un poussage des vélos sur une piste dure mais trop raide pour que nous restions sur nos montures très lourdes. Arrivés au col qui nous domine après une petite heure, devant nous se dévoile le salar d’Uyuni, le plus grand de la planète. Nous restons subjugués par le spectacle. La petite ville de Salinas est vite atteinte. Il s’agit d’une bourgade où le marché sur la place centrale donne une activité inhabituelle dans ces coins reculés.
Comment vous parler en quelques mots des cinq cents kilomètres suivants, parcourus en onze jours entre le plus grand salar du monde Uyuni et la traversée du sud Lipez haute terre entre 4000 et 5000 mètres, où le climat touche au paroxysme, grand froid la nuit, de la glace dans la tente, et des températures fortes la journée et puis ce vent terrible qui se lève systématiquement vers les onze heures pour ne s'apaiser qu'une heure après la venue de la nuit. Et encore ces poussages de vélos à l'infini dans le sable et les champs de lave. Un jour nous avons poussé 8 heures d'affilé dans la tourmente et une montée terrible avec un passage au-dessus de 4700 mètres presque jusqu'à la tombée de la nuit. Mais Flora indestructible ouvrait le chemin. Et puis ces rencontres de fous animés par la même envie de dépassement qui rigolent dans les pires situations. Une nature aux teintes inimaginables, on croirait qu'un spécialiste a retouché les couleurs des montagnes du ciel, des nuages et des lagunes. Les quelques photos ci-dessous vous donneront un bref aperçu de ce que furent ces jours de joie intense dans l'effort.
Sur cette dernière photo nous sommes Flora et moi avec Daniel un Allemand voyageant au long cours jusqu'à la Tierra del Fuego. Nous effectuons les derniers kilomètres presque à reculons tellement nous avons l'impression de terminer une expérience d'une rare intensité au milieu de ces hautes terres boliviennes.
Dans quelques kilomètres le goudron et après une descente de 47 kilomètres, 2200 mètres plus bas à 2400 mètres d'altitude la ville très touristique de San Pedro de Atacama. La prochaine étape le Passo Sico à plus de 4000 mètres va nous conduire en Argentine, à la découverte d'une autre partie de ces immensités désertiques de l'Amérique du Sud.
Sur le lien suivant vous pouvez lire le compte-rendu spécifique que j'ai fait concernant cette traversée de 10 jours du Sud Lipez:
Notre traversée du Sud Lipez à vélo
J'allais oublier: on a vu Moustaki
Donc après une journée et demie passée dans le village de San Pedro de Atacama, le Sud Lipez ne nous a pas calmés, mais au contraire notre envie de repartir dans ces grands déserts est plus forte que jamais et sur les 500 kilomètres à venir nous n'allons pas être déçus! L'aventure sera à la hauteur de ce que nous venons de vivre précédemment.
10 Novembre Départ pour le Paso Sico
Ce col va nous donner accès à l’Argentine. Depuis San Pedro de Atacama deux chemins sont possibles le Paso Jama et le Paso Sico. Les deux sont de redoutables obstacles. Nous choisissons ce second col car d’une part nous avons déjà parcouru les 42 derniers kilomètres du précédent à la sortie du sud Lipez, et d’autre part il est réputé plus facile, bien que asphalté uniquement sur les 85 premiers kilomètres de la montée qui en comprend 216. Et je ne parle pas de la descente en Argentine, où nous ne retrouverons le goudron après San Antonio de los Cobres, c’est à dire 135 kilomètres plus loin, sans parler des portions qui par la suite ne sont pas asphaltées.
Nous partons donc à l’assaut de ce col assez tardivement, vers les 9h30, du fait des démarches douanières qui doivent se faire impérativement à San Pedro de Atacama, alors que nous ne quitterons le pays véritablement que trois jours plus tard. Nous prenons un bon rythme sur la route goudronnée. Nous longeons le salar d’Atacama qui s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Sans incident nous arrivons dans le village de Socaire vers les 17h après 86 kilomètres et 800 mètres de dénivelé.
Nous sommes tout étonnés de cette distance parcourue, en pensant aux minuscules distances que nous effectuions dans le Sud Lipez en poussant nos vélos toute la journée, parfois à peine 20 kilomètres et généralement de l’ordre d’une trentaine. Très gentiment un homme nous accompagne pour trouver un logement. Ce n’est jamais très simple, mais nous finissons par avoir satisfaction. Le soir le restaurant attenant nous confectionne une excellente platée de spaghettis, mais nous en aurions bien mangé deux fois plus.
Le lendemain départ matinal, nous espérons monter rapidement. En effet, nous sommes à 3200 mètres d’altitude et la Paso Sico, bien qu’encore fort éloigné ne culmine qu’à 4060 mètres. Mais ce que notre carte ne nous dit pas, car pas assez précise, c’est qu’avant de l’atteindre il nous faudra d’abord passer trois points hauts dont deux dépassent les 4600 mètres. Nous sommes lourdement chargés, en particulier 7 litres d'eau chacun, car nous savons que nous avons peu de chance d’éviter un bivouac. Les deux premières heures sont longues, cloués sur place dans une pente raide en terre. Vers midi le vent va se lever et par moments souffler en furie. Nous ne nous en plaignons pas car il nous pousse.
Par moments il soulève de tels nuages de poussière que nous sommes littéralement aveugles, et nous devons nous immobiliser. Nous dépassons allègrement les 4200 mètres avant de replonger vers des lagunes d’une beauté stupéfiante. Nous commençons vers les 15 heures à nous demander où nous allons bien pouvoir nous arrêter pour la nuit dans ces éléments déchaînés. Vers les 17 heures sur le bord gauche de la route à quelques centaines de mètres un énorme rocher d’une dizaine de mètres de haut semble présenter un écran contre ce vent rageur. A son pied nous découvrons un petit espace sableux, qui correspond parfaitement aux dimensions de notre tente. Le lieu est parfait, l’altitude est un peu supérieure à 4200 mètres. Une fois bien installés nous pouvons assister à l’évolution des couleurs dans ce monde stupéfiant de l’Atacama. Au sol une herbe rase à la couleur jaune avivée par le soleil rasant se découpe sur le rouge sombre des montagnes qui l’entourent. Le tout rehaussé de touches de blanc éclatant, d’une part dû aux quelques névés qui subsistent et d’autre part du fait de la couleur de la roche qui par endroits s’apparente plus à du talc qu’à de la pierre. Absolument fantastique. Nous nous disons que tous les efforts consentis sont bien payés, de pouvoir assister bien installés dans notre tente à ce spectacle unique de la nuit qui vient sur ce désert de l’Atacama.
11 novembre
Après une nuit confortable malgré le vent qui a soufflé par intermittences et parfois très fort nous sommes d’attaque pour une nouvelle journée avec la ferme intention de passer en Argentine. Le Paso Sico n’est qu’à quarante kilomètres, mais ce que nous ignorons, c’est qu’avant de l’atteindre il nous faudra d’abord franchir deux passages au-dessus de 4600 mètres par des pistes pas très bonnes, pour ne pas dire plus, et le poussage sera long dans la première partie.
Donc vers huit heures après un petit déjeuner à base de flocons d’avoine nous nous mettons en route pleins d’entrain. Très vite la piste devient exécrable, et de plus elle monte dans le ciel. Deux heures plus tard nous atteignons le Camp el Laco à 4600 mètres. S’y trouve un ensemble de bâtiments. Flora a la géniale idée d’aller voir si nous pouvons nous y approvisionner en eau et éventuellement acheter quelques denrées. Il s’agit d’une base de mineurs. Ils nous invitent à un petit déjeuner gargantuesque, qui nous remet d’aplomb, car nos rations congrues ne sont pas vraiment adaptées aux efforts que nous effectuons. Nous passons une heure exquise à manger comme des ogres dans une douce chaleur.
Chez les mineurs je n'ai pas eu le temps de faire la photo qu'on avait tout mangé!
La reprise n’est pas trop dure, le vent est modéré et le soleil darde des rayons généreux. Cependant la pente continue à monter vers le ciel et pourtant le camp est à 4600 mètres. Enfin nous arrivons au sommet de cette bosse et nous découvrons de l’autre côté un salar de plus, tout à fait splendide dans ce monde minéral. Sur le bord, minuscule, le poste frontière chilien. Nous l’atteignons, un dernier contrôle et nous continuons en direction de l’Argentine, encore fort éloignée. Le point frontière est à 25 kilomètres et le poste argentin 11 kilomètres plus loin. Avant de quitter les douaniers chiliens nous leur demandons de l’eau. Ils nous offrent une bouteille de 1,6 litre, c’est toujours cela en plus en cas de nouveau bivouac.
La piste est un enfer, nous poussons sur plusieurs kilomètres. On se dit que jamais nous ne serons en mesure d’atteindre ce fameux Paso Sico. La piste ne s’améliore pas et commence à repartir dans le ciel. Mais le décor est tellement surréaliste que nous sentons à peine nos efforts, même si nous sommes quelque peu inquiets de la moyenne ridicule de notre déplacement.
Puis la délivrance arrive. Au sommet de cette nouvelle bosse, la piste s’améliore et nous nous engageons dans une descente d’une extraordinaire beauté, parmi des roches multicolores, de hautes dunes et des salars qui virent au rose. Dans un immense cratère plusieurs cônes de terre offrent un spectacle d’un esthétisme parfait. Bien loin vers le bas un gigantesque salar se dessine.
Cette région gigantesque est loin des dimensions européennes. Notre vitesse sur une piste dure est tout à fait satisfaisante et rapidement nous atteignons ce fameux Paso Sico, qui n’est pas à proprement parler un col, mais plutôt une plaine d’altitude.
11 kilomètres plus loin le poste argentin. Les formalités sont rapides. Dans ce coin de désert nous sommes les seuls à nous présenter à la frontière. Manifestement les 36 kilomètres de piste entre les deux postes chilien et argentin se sont pratiquement pas utilisés. Nous n'y avons pas vu un seul véhicule. Il est déjà 16h30, et nous demandons aux douaniers s’ils peuvent nous héberger pour la nuit. Ils refusent. Ils nous donnent cependant une bouteille d’eau. Ils nous indiquent un village à 18 kilomètres où nous pourrons trouver un hébergement. Ce qui est embêtant, c’est que ce n’est pas notre route. Ils nous certifient que le village se trouve sur un autre itinéraire qui n’est pas plus long et qui rejoint la route de Salta cinquante kilomètres plus loin.
Il ne nous en faut pas plus pour nous lancer dans une course effrénée pour essayer de rejoindre ce village avant la nuit. Même si le vent est avec nous, cela commence assez mal, une terrible piste en tôle ondulée qui de plus monte. Après quelques kilomètres nous nous demandons si nous n’avons pas réagi trop impulsivement. Mais il est trop tard pour faire demi-tour, donc nous forçons sur nos pédales malgré la grosse journée que nous avons déjà derrière nous. Par miracle la piste s’améliore et le vent persiste en notre faveur. Vers 18 heures nous atteignons ce village étonnant de Catuan, minuscule enfermé dans une gorge désertique. Nous y trouvons un logement rudimentaire et faisons quelques courses dans un mini-market qui n’a pas grand chose à offrir. Le coin est très dépaysant. Nous nous disons qu’il est préférable de loger chez l’habitant que de monter notre tente sans contact avec la population.
12 novembre
Départ vers les 8 heures après nous être confectionné notre petit déjeuner. Il fait bon, le soleil chauffe et le vent est nul. Le matin dans ces hautes terres est toujours agréable. On a du mal à imaginer que la nuit y soit si hostile. Après quelques kilomètres qui nous laissent pleins d’espoir quant à la facilité de cette portion de route non prévue, nous tombons sur les premières difficultés et elles sont de taille, une piste qui monte et qui est entièrement sablonneuse. Il s’ensuit une épuisante séance de poussage. En trois heures nous n’effectuerons que 13 kilomètres. Notre étape du jour en comporte 45. De plus pas une voiture, nous sommes vraiment sur une piste presque à l’abandon. Ce qu’il y a de plus épuisant nerveusement sur ce type de chemin, c’est de ne jamais savoir quand le sable commence et où il va s’arrêter. Parfois après cent mètres on peut remonter sur les vélos mais voilà qu’ à nouveau il faut pousser sur plusieurs kilomètres et tout cela dans une pente qui ne faiblit pas. La roue avant a tendance à se mettre de travers, entraînée par le sable pulvérulent. Les efforts pour la remettre dans l’axe sont épuisants. Avec cela l’altitude continue de monter alors que nous sommes déjà à plus de 4000 mètres. Loin devant nous, nous distinguons une crête. De toute évidence c’est par là que passe notre itinéraire pour rejoindre la route nationale qui va vers Salta. Enfin après plus de trois heures le point culminant vers les 4300 mètres est atteint. Comment va être la descente?
Un peu sableuse mais nous réussissons à prendre un bon rythme et enfin dans le lointain, à l’aide des jumelles de Flora, nous apercevons les véhicules qui lèvent des nuages de poussière sur la route que nous convoitons. Un salar de grandes dimensions nous en sépare. Nous le traversons sur une piste dure et le plaisir de se trouver dans ces environnements inhabituels est très grand.
Malgré l’immensité qui se développe devant nous, notre vitesse qui doit frôler les 20 km/h nous laisse envisager de rejoindre rapidement cette fameuse nationale que nous avons quittée hier soir au poste de douane. Nous y sommes vers 13 heures. A l’abri d’un mur en ruine nous faisons une pause casse-croûte, thon, pain et une demi-pomme. Le lieu est désolé, complètement à l’abandon. On se croirait vraiment dans ces cités construites à la va-vite lors de la ruée vers l’or et désertées quelques temps plus tard du fait des espoirs déçus d’enrichissement du fait du défaut de filons rentables.
La nationale est une affreuse piste sablonneuse molle qui alterne avec des passages redoutables de tôle ondulée. Deux états de la route qui sont un enfer pour le cycliste. Notre but de ce jour, le village de Olatacapo est distant de huit kilomètres. Il nous faut une bonne heure sous une chaleur forte pour les franchir. Les cinq cents derniers mètres pour accéder aux maisons sont impraticables et nous voilà à nouveau à pousser. Nous trouvons un hébergement et sommes satisfaits que cette étape prenne fin vers les 15 heures, car les jours précédents nous sommes restés dix heures sur ou à côté de nos vélos.
13 Novembre Olatacapo à San Antonio de los Cobres 60 km
Après une bonne nuit nous décidons de partir de bonne heure car l’étape de la journée fait plus de 60 kilomètres. Cela peut paraître peu, mais vu l’état de la fameuse RN 51 nous nous attendons à une étape que je qualifie de peu tranquille. Et je suis loin d’imaginer ce qui nous attend. En effet mon GPS donne la ville de San Antonio de los Cobres vers les 3900 mètres. J’en déduis que nous aurons peu de montée. Là, je me trompe très nettement. En effet il nous faudra passer un col à 4560 mètres d’altitude, et la piste est franchement horrible, sable en permanence et tôle ondulée très fréquemment. 31 kilomètres de montée, ils me semblent interminables. J’en arrive même à me demander ce que je fais là dans ces pentes infinies. Mais le col est enfin atteint et la descente ne pose pas vraiment de problème même si nous nous faisons secouer très sérieusement.
Ces grandes randonnées à vélo ont ont un côté étrange. Alors que l’on passe des heures à se traîner le long de pistes sablonneuses ou dans des pentes trop raides pour rester sur nos montures, eh bien dès que la phase suivante se présente, on oublie du passé, tout du moins tout ce qui nous a demandé des efforts épuisants, pour ne se souvenir que des paysages à couper le souffle.
14 Novembre San Antonio à Campo Quijano 130 km
Aujourd'hui nous allons renouer avec la route asphaltée, mais d'abord vingt kilomètres de piste. Cette dernière n'est pas mauvaise et nous n'aurons pas à pousser nos vélo dans le sable. Puis enfin le goudron, ce que cela est bon. Rapidement nous atteignons le Abra Blanca, col qui frôle les 4000 mètres. Alors s'ouvre à nous une descente gigantesque, qui va nous permettre d'effectuer plus de 130 kilomètres ce jour. Dans un premier temps le vent nous est favorable, mais dans l'après-midi il s'inverse et redouble de vigueur. Après un moment d'hésitation nous reprenons notre descente en appuyant sur nos pédales. Avec Flora nous nous relayons en tête face au vent rageur. Nous prenons goût à cet effort. Une dernière section de piste de 22 kilomètres et nous arrivons vers les 18h dans la petite ville de Campo Quijano.
Nous quittons la piste pour l'asphalte
Encore 22 km de piste, mais après nous devrions rester sur le goudron pour des centaines de km
Nous ne sommes plus qu'à une vingtaine de kilomètres de la ville de Salta. Mais nous avons décidé de ne pas nous y rendre. Nous mettrons le cap directement sur Cafayate.
15 Novembre Campo Quijano à Coronel Moldes 70 km
Nous sommes un peu déboussolés, d'une part du fait de quitter les pistes sur lesquelles nous évoluons entre 4000 et 5000 mètres depuis quatre semaines pour retrouver l'asphalte et la civilisation, et d'autre part du fait de la température modérée le soir et la nuit, alors que nous étions habitués au grand froid et aux moins dix degrés au lever du jour. Plus besoin de grosse couverture et de se coucher tout habillé. Au contraire il fait vite chaud et un simple drap suffit.
Nous nous levions tôt pour pouvoir rouler un maximum sans vent, il est toujours là et en plus il semble défavorable alors que généralement il était notre allié. Mais ce que nous allons devoir combattre maintenant ce sont les chaleurs suffocantes. En effet, au-delà de midi les quarante degrés seront dépassés, et de plus le vent fera virevolter des nuages de poussière. Donc on a l'intention de rouler de 6h à midi et de se trouver un coin à l'ombre pour l'après-midi.
Donc, fort de ce précepte nous démarrons ce matin seulement à 8H30. De plus suite à une erreur d'itinéraire, notre carte au 1/2 000 000 ne permet pas le détail, nous faisons une distance supplémentaire sans doute d'une bonne quinzaine de kilomètres. Mais dans le fond cela n'est pas plus mal, car cela nous évite la dernière portion de piste. Nous n'avons pas dû perdre beaucoup de temps. Que nous avons l'impression d'aller vite sur cette route asphaltée. Nous menons à tour de rôle et les kilomètres défilent. Deux petites pauses pour manger un gâteau une pomme et se désaltérer et nous sommes à Coronel Moldes un peu après midi.Nous avons abattu de l'ordre de 70 kilomètres. Mais il est vrai que les derniers dans la chaleur et contre le vent étaient fatigants. En dehors du grand plaisir d'avoir l'impression d'aller très vite, tout en faisant attention à la circulation parfois assez dense, nous n'avons rien remarqué de particulier sur ce tronçon. Nous ne sommes plus dans le même voyage qu'au cours des quatre semaines précédentes. Nous espérons cependant que la route jusqu'à Cafayate sera plus pittoresque que notre étape du jour. Je vous en reparlerai sans doute dans deux jours car cette ville est distante de 130 kilomètres. Mais si le démon de la défonce nous prend et que le vent trouve cela rigolo et nous aide, ce sera peut-être demain! Mais ne rêvons pas trop!
16 Novembre Coronel Moldes à Cafayate 128 km
Départ à 6h, il fait encore nuit. Après une brève hésitation nous nous lançons. A cette heure la ville est endormie et la route est déserte ou presque. Démarrer comme cela au petit matin et très agréable du fait du trafic nul ou presque et de la fraîcheur. Les conditions sont idéales pour pédaler. Attention seulement aux chiens que l’on voit tardivement dans ce jour tout juste naissant. La première bourgade de la Vigna est vite atteinte, 23 kilomètres en une heure. On comprend que nous avons toutes les chances de rejoindre Cafayate si les conditions se maintiennent, absence de vent et ciel couvert. La route s’insinue dans des gorges magnifiques. Sur 80 kilomètres une multitude de formations rocheuses et terreuses va nous étonner à chaque virage et à chaque montée. Le rouge prédomine. Une rivière au flux presque nul s’étale et donne l’illusion d’un large cours d’eau, car le sable du lit est mouillé.
Le vent nous est favorable et à 13H30 nous arrivons à Cafayate, petite ville touristique, dont la réputation provient de son vignoble, en particulier de son vin blanc. Allons-nous le tester? Pas si sûr car demain il nous faut rouler et ils ne vendent pas de demi-bouteille!
Le fait de rouler de cette façon en partant avec le jour est agréable à plus d’un titre et cela permet de passer tranquillement l’après-midi à se reposer en déambulant sans se presser dans la ville et puis aller s'asseoir à la terrasse d’un café à regarder la vie locale. Dans ces conditions on est bien en forme pour enfourcher nos montures dès le jour naissant le lendemain avec l’intention de dépasser encore une fois les 100 kilomètres. Cependant nos ambitions risquent d'être contrariées par un col de plus de 3000 mètres d'altitude qui s'annonce sur notre route. La grande étape risque plutôt d'avoir lieu le lendemain jusqu'à Concepcion.
Une fois arrivés à Cafayate nous avons élu domicile dans un petit hôtel sympa qui met à notre disposition une cuisine. Nous partons immédiatement faire des courses, légumes, œufs, sardines, pain et fromage de chèvre. Flora confectionne une grosse salade que nous accompagnons d’une énorme platée de pâtes. Nous engouffrons tout cela de bon appétit.
Le moral est au beau fixe. Si les conditions de route se maintiennent, vent pas trop gênant, et chaleur raisonnable comme aujourd’hui, nous envisageons de rouler jusqu’à Mendoza puis Santiago sans jamais avoir recours au bus. Pour le moment nous n’en sommes pas encore là. Nous avons décidé de rejoindre la Rioja, ville distante d'à peu près de 500 kilomètres et de faire un point à ce moment.
17 Novembre Cafayate Aimaicha de la Valle 75 km
Aujourd’hui nous allons rouler sur le mythique Ruta 40. Nous quittons Cafayate à 6H20 après que je sois retourné récupérer ma frontale oubliée sous l'oreiller. A la sortie de la ville les vignes s'étirent sur plusieurs kilomètres. Hier nous avons bu un excellent blanc d'ici.
La route en ce dimanche matin est déserte et nous avançons rapidement. Nous en profitons pour faire un petit détour de quelques kilomètres par une piste afin de visiter un ancien site indien. Il s'agit d'une multitude d'enclos aux murs de pierre qui s'étalent le long d'un grand flan de montagne. Nous n'avons pas bien compris ce que cela représentait. Il s'agit du site indien de Quilmes.
Vers midi nous arrivons dans la petite cité de Aimacha. On a l'impression qu'elle reste complètement en dehors des circuits touristiques.
18 Novembre Aimaichi à Tafi del Valle 57 km
Départ 6h, il fait frais. Une longue montée de 28 km nous attend, le dénivelé est de l'ordre de 1100 mètres et le point haut se situe à 3050 mètres. Il nous faut plus de 4 h pour franchir l'obstacle. Nous redescendons ensuite rapidement sur la petite ville de Tafi, qui est sympathique bien que très touristique.
19 Novembre Tafi del Valle Concepcion 100 km
Ce matin départ 6h. Il pleut nous sommes tout étonnés. On hésite, plutôt j' hésite car Flora veut foncer sans se poser de questions. Il fait nuit la route est mouillée, mais nous partons. Un peu plus loin on s' arrête quelques minutes dans un abri-bus car la pluie s'intensifie. Mais avec le jour cela va s'arranger. Ce matin nous allons perdre deux mille mètres d'altitude par une longue descente dans une gorge verdoyante, Après un mois de désert cela est étonnant d’être entouré de verdure.
Il va m'arriver un drôle d'incident, le roulement à billes de ma pédale gauche va casser à 12 kilomètres de Concepcion. Mais je vais réussir sans trop de difficultés à pédaler seulement avec l'axe de la pédale. Heureusement, j'ai pu en acheter une nouvelle paire en arrivant en ville.
La route est très passante et nous sommes dans des plaines de basse altitude. Cela me rappelle un peu les 700 kilomètres que j'ai effectués en début d'année entre Paksé au Laos et Bangkok, lors d'un périple de 4000 kilomètres autour du Mékong. J'avais trouvé du plaisir à rouler sur des routes très passantes, même sur autoroute, on abattait de l'ordre de 130 kilomètres par jour. Mais voilà aujourd'hui, Flora ne l'entend pas comme cela et ne trouve plus d'intérêt à pédaler dans ces conditions dangereuses. Nous prenons donc le premier bus pour Mendoza. Il nous faut la nuit pour y parvenir.
20 et 21 Novembre Mendoza
Nous passons deux jours de repos à Mendoza. La ville est agréable, bien arborée. Nous somme au centre ville dans une auberge de routards. L'ambiance est agréable, même si la nuit ça parle fort très tard. Demain nous reprenons la route pour notre dernière étape de 400 km jusqu'à Santiago.
Agent du Mossad prêt à l'action
Gloire à l'armée des Andes pour l'indépendance de l'Argentine
22 novembre Mendoza à Villavicencio 50 km
Nous décidons de passer par la route 52 et non la nationale 7. Certains nous la conseille d'autres non. Comme toujours lorsqu'on pose une question, on a toutes les réponses possibles. Déjà le fait que la circulation soit faible est un argument de poids en faveur de notre choix.Avec le recul de deux jours, ni Flora ni moi ne regrettons notre décision, bien que le chemin soit beaucoup plus difficile, route de terre sur plus de 40 kilomètres et le passage d'un col avec 2300 mètres de dénivelé.
Donc ce matin à six heures nous quittons notre auberge et prenons la route au lever du jour. A cette heure matinale nous n'éprouvons aucune difficulté car le trafic est quasiment nul. L'agglomération n'est pas très grande et en dix kilomètres nous sommes en pleine nature. Une gigantesque ligne droite part à l'assaut des Andes. En une vingtaine ou trentaine de kilomètres, tout en montant, elle nous conduit dans une petite gorge. Nous la suivons sur dix kilomètres et arrivons à la maison de la réserve naturelle de Villavicencio. Nous nous arrêtons pour visiter. Le gardien nous informe que l'hôtel un kilomètre plus loin est définitivement fermé. Nous qui pensions passer une bonne soirée, de plus avec des eaux thermales, eh bien non! Ce sera un bivouac à manger nos pâtes. Heureusement que nous avons toujours quelques provisions au fond des sacoches, car aujourd'hui nous sommes vraiment pris au dépourvu. Cet hôtel on en a entendu parler partout, et google earth l'annonce en gros. Mais voilà, afin de protéger la zone le gouvernement vient juste de prendre des mesures drastiques dont la fermeture du restaurant, l’hôtel quant à lui ne fonctionne plus depuis 1978!
Aujourd’hui nous avons vu des vigognes différentes de celles que l’on a côtoyées dans les hauteurs de l’Atacama. Nous avions l’habitude d’animaux d’assez petite taille, un peu plus d’un mètres et sans doute une vingtaine de kilos, très gracieux aux couleurs qui se fondaient bien dans le décor. Alors que là nous sommes en présence d’animaux beaucoup plus gros, d’une hauteur de deux mètres, beaucoup plus massifs et à la tête noire. De plus il y avait sur le bord de la route des panneaux annonçant «faune sauvage» avec une belle effigie de puma.
23 Novembre Villavicencio à Uspallata 57 km.
Départ 6h30, sans transition nous sommes engagés dans une montée de 28 kilomètres. La route escalade un grand flanc de montagne et nous conduit à un col à 2958 mètres d'altitude. Pour aujourd'hui il nous reste à peu près 1300 mètres de dénivelé à franchir. La route sera sur sa plus grande partie non goudronnée, ce qui apporte un petit air d'aventure à la montée. Les points de vue sont magnifiques. D'ailleurs, vu la dizaine de minibus de touristes qui nous doubleront au cours des cinq heures de la montée, l'endroit est réputé. Enfin le col, de là la vue s'étend à l'ouest sur les Andes et en particulier sur l'Aconcagua. Une belle descente de 28 kilomètres nous conduit à la petite ville de Uspallata. Sans trop de difficulté nous trouvons un hôtel pour la nuit.
24 Novembre Uspallata à Los Penitentes 64 km 1000 m de dénivelé
Nous partons un peu avant 6 heures. Il fait encore nuit. La circulation est très faible, nous sommes dimanche. Nous espérons qu’elle le restera. Mais non, rapidement le nombre de poids lourds va augmenter, malgré le jour férié. De plus le vent va se mettre de la partie . Il souffle en rafales et nous l’avons en plaine figure. Cela rend notre étape difficile. Nous évoluons dans un cadre superbe entourés de grandes montagnes de toutes les couleurs. Vers 13 heures nous arrivons dans une petite station où nous trouvons un hébergement dans un refuge qui de toute évidence sert de point de départ pour l’Aconcagua.
25 Novembre Los Penitents à Los Andes 97 km
Départ un peu après 6h car nous avons discuté avec Diego l'un des employés du refuge. Ce matin pas de vent, qu'il fait bon pédaler. Nous sommes entourés de hautes montagnes couvertes de glaciers. Le tunnel à la frontière de l'Argentine et du Chili se situe à l'altitude de 3200 mètres. Avant de l'atteindre nous surveillons sur notre droite le lieu où nous aurons un magnifique point de vue sur l'Aconcagua.
Une fois au tunnel, nous sommes pris en compte par un véhicule, car il est interdit aux vélos. Une fois de l'autre côté nous arrivons rapidement au poste frontière commun aux deux pays. Les Chiliens sont toujours assez pointilleux et il faut leur montrer tous nos aliments. Ils nous confisquent notre morceau de fromage. Une fois ces formalités terminées nous nous lançons dans une immense descente jusqu'à Los Andes, petite ville où nous arrivons vers les 16 heures.
La guerre des Malouines a laissé des traces!
26 Novembre Los Andes à Santiago 92 km
Aujourd'hui c'est la dernière étape de notre périple. Nous allons pédaler une dernière fois avant de nous séparer. Flora va partir vers le sud du Chili et moi je vais rentrer en France. C'est toujours un peu triste que l'on aborde l'ultime étape d'une belle aventure.
Mais très vite nous allons être plongés dans le feu de l'action, et pas le temps de se poser des questions métaphysiques. En effet ce dernier tronçon se fait en partie par autoroute, interdite aux vélos et parfois il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence et pour couronner le tout ce matin nous sommes partis par un matin gris brouillardeux. On n'a pas chaumé, un peu le stress aux fesses. Cette autoroute présente un tunnel. On l'a évité en prenant une belle route qui monte de 500 mètres et nous a permis de nous élever au-dessus de la nappe de brouillard. Lorsque nous sommes redescendu vers l'autoroute le temps était au beau. de plus sur les 18 kilomètres restant par autoroute il y avait une belle bande d'arrêt d'urgence, mais à plusieurs reprises de gros panneaux interdit aux vélos. Nous avons pris la sortie vers la ville de Colina comme une délivrance. Une dernière halte où nous avons mangé une dernière fois ensemble, puis encore 35 kilomètres pour arriver au cœur de Santiago. Circulation intense, l'agglomération compte 6 millions d'habitants. Flora qui ne perd pas de temps, s'arrête devant une quincaillerie, on achète du carton pour emballer nos vélos, elle pour le bus vers le sud et moi en prévision de l'avion. Nous roulons encore un peu ensemble avec nos rouleaux de carton sur nos sacoches arrières. On a presque le gabarit d'une voiture! Puis vient le moment où nos chemins se séparent. On reprend chacun ses affaires, on partage la caisse commune, une bise et s'est reparti chacun de son côté.
Mon souci premier, changer mon billet d'avion, ce qui se fera dans la foulée l'après-midi même et de trouver un logement. Je retourne à l'hostal Condell où j'avais déjà séjourné il y a quatre ans après une traversée de trois mois entre Équateur, Pérou, Chili et Bolivie. La patronne peut m'héberger une nuit, mais me trouvera un point de chute pour la nuit suivante.
J'ai emballé mon vélo dans le morceau de carton que j'ai acheté.Le paquet n'est pas terrible du tout. Le carton est fragile et casse. Je mets beaucoup de ruban adhésif, qui n'a d'adhésif que le nom et je renforce le tout avec de la ficelle. Ces retours avec vélo sont toujours assez délicats à gérer.
Pour finir j'adresse un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis et tout particulièrement à ceux qui ont pris le temps de nous mettre un ou plusieurs petits mots. En effet, on a beaucoup apprécié, car contrairement à ce que l'on pourrait croire l'action intense n'empêche pas de beaucoup penser à ceux et celles que l'on laisse et qui nous manquent.
Voilà c'est fini snif, mais je suis content de rentrer et tout particulièrement de retrouver ma chère et tendre Danielle que je remercie du fond du cœur de tolérer mes errances désertiques.
17:19 Publié dans expérience vécue, voyage à vélo | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : atacama, arica, coipasa, uyuni, sud lipez, bolivie, chili, argentine, paso sico, san pedro de atacama, arbol de piedra, laguna colorada, laguna verde
23/11/2010
les salars boliviens, Coipasa et Uyuni
Traversée des salars de Coipasa et d’Uyuni
Ces deux immenses étendues de sel situées à plus de 3600 mètres d’altitude, la première s’étendant sur 2100 km carrés et la seconde sur 12 500, sont des curiosités naturelles qui sont universellement connues. Le salar de Coipasa est moins couru que celui d’Uyuni, en effet ce dernier est la plus grande étendue de sel au monde. Ces deux mers de sel sont de grande ampleur, en effet j’ai constaté que sur Google Earth, alors que l’Amérique du Sud est encore entièrement affichée à l’écran, eh bien deux taches blanches sont déjà visibles.
Au cours de notre périple à travers l’Amérique du Sud à vélo, ce passage est l’un des morceaux de choix. C’est avec un peu d’appréhension que nous allons nous y engager. Nos recherches nous ont permis d’obtenir de nombreux renseignements pas toujours concordants, de plus les cartes que nous avons deux chiliennes et une bolivienne ne donnent pas les mêmes renseignements, n’indiquent pas les mêmes routes, des villages différents, et lorsqu’ils sont positionnés en un même lieu, souvent les noms différent. Tout cela ne fait qu’augmenter le mystère d’une région qui apparaît étrange. Le trajet est long, nous l’estimons à plus de trois cents kilomètres, si toutefois, nous réussissons à passer au plus court. Dans le cas contraire il faudra rajouter une centaine de kilomètres.
Donc fort de tous ces renseignements et de toutes ces incertitudes, notre curiosité et notre envie de découvrir ces particularités de la  nature ne sont que plus fortes. Notre première vision des ces lieux étranges se présente alors que nous terminons la traversée des parcs nationaux du nord Chili. Lorsque la piste amorce la descente finale sur la ville frontière de Colchane, là-bas dans le lointain de l’autre côté en Bolivie je distingue une mince trace blanche nord sud bordée par un grand volcan à l’est. La vue porte loin, très loin, ce volcan doit bien se situer à cinquante kilomètres, mais cela ressemble exactement à ce que représente ma carte du Chili, bien qu’elle ne soit pas très détaillée, en effet échelle 1/ 2 000 000. Imaginez déjà ce que l’on voit sur une carte au 1/ 1 000 000 de la France ? On ne s’en sert pas pour faire de la topographie, mais uniquement pour suivre des routes. En Amérique du Sud, les dimensions de toute chose sont tellement grandes, que l’on pourrait comparer ce que montre ma carte avec une carte au 1/25000 d’un lac des Pyrénées ou des Alpes. La différence, c’est que le lac que je vois fait plus de 2000 km carrés et que le volcan qui le domine culmine à cinq mille mètres et que sa circonférence doit faire une centaine de kilomètres. Tout est vraiment disproportionné comparativement à l’Europe. Aussi la vision est déconcertante, car un relief que l’on perçoit comme proche peut facilement se trouver à 70 kilomètres, voire plus. A la découverte de ce salar, ces notions de distance je les avais déjà bien intégrées depuis plus de deux mois que nous roulions à travers les Andes. Donc cette première vision du salar, ne nous donne pas une réelle idée de ses dimensions, en effet au sud je distingue des reliefs qui de toute évidence marquent la fin de l’étendue de sel. Mais ne nous y trompons pas ces montagnes, délimitant la frontière méridionale du salar se situent à plus de cent kilomètres de mon point d’observation.
nature ne sont que plus fortes. Notre première vision des ces lieux étranges se présente alors que nous terminons la traversée des parcs nationaux du nord Chili. Lorsque la piste amorce la descente finale sur la ville frontière de Colchane, là-bas dans le lointain de l’autre côté en Bolivie je distingue une mince trace blanche nord sud bordée par un grand volcan à l’est. La vue porte loin, très loin, ce volcan doit bien se situer à cinquante kilomètres, mais cela ressemble exactement à ce que représente ma carte du Chili, bien qu’elle ne soit pas très détaillée, en effet échelle 1/ 2 000 000. Imaginez déjà ce que l’on voit sur une carte au 1/ 1 000 000 de la France ? On ne s’en sert pas pour faire de la topographie, mais uniquement pour suivre des routes. En Amérique du Sud, les dimensions de toute chose sont tellement grandes, que l’on pourrait comparer ce que montre ma carte avec une carte au 1/25000 d’un lac des Pyrénées ou des Alpes. La différence, c’est que le lac que je vois fait plus de 2000 km carrés et que le volcan qui le domine culmine à cinq mille mètres et que sa circonférence doit faire une centaine de kilomètres. Tout est vraiment disproportionné comparativement à l’Europe. Aussi la vision est déconcertante, car un relief que l’on perçoit comme proche peut facilement se trouver à 70 kilomètres, voire plus. A la découverte de ce salar, ces notions de distance je les avais déjà bien intégrées depuis plus de deux mois que nous roulions à travers les Andes. Donc cette première vision du salar, ne nous donne pas une réelle idée de ses dimensions, en effet au sud je distingue des reliefs qui de toute évidence marquent la fin de l’étendue de sel. Mais ne nous y trompons pas ces montagnes, délimitant la frontière méridionale du salar se situent à plus de cent kilomètres de mon point d’observation.
Alors que nous contemplons ce spectacle, nous ne savons pas encore si nous pourrons couper au plus court pour rejoindre cette mer immobile qui se drape dans un lointain indistinct. Nous pensons devoir remonter très au nord chercher une piste qui nous ramènera à l’entrée de cette étendue de sel. Pour le moment, rejoignons la ville de Colchane et essayons de nous renseigner. Il s’agit d’une petite ville frontière immobile au milieu du désert. Les montagnes qui la dominent sont d’une grande beauté, en particulier au coucher du soleil, lorsque les multiples couches géologiques et les rejets volcaniques à base de soufre s’enflamment dans la lumière rasante et révèlent à ce moment privilégié toute leur palette de teintes.
Je pars m’informer chez les carabinieros. Ils ne me seront pas d’un grand secours, en effet ils me parlent de la partie chilienne du salar, mais ne savent ou ne veulent rien dire sur sa partie bolivienne, alors que seule cette dernière m’intéresse. Dommage, nos incertitudes ne seront pas levées.
Le lendemain nous repartons après une bonne nuit passée dans un hôtel, dont les propriétaires, un couple d’Indiens était particulièrement hospitalier. Les formalités douanières sont rapidement effectuées, et nous voilà en route pour le village de Pisiga en  Bolivie. D’après la carte il se trouve à dix kilomètres de la frontière. Nous empruntons une magnifique route bétonnée en construction, donc déserte et fonçons vers notre destination. Après une quinzaine de kilomètres, pas de Pisiga. Nous réalisons alors qu’il s’agissait de la ville frontière. Mais nous ne ferons pas demi-tour. Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons aborder directement le salar qui se trouve à quelques kilomètres à notre droite et nous envisageons de remonter à Sabaya qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord et de là trouver une piste qui nous ramènera au salar en une trentaine de kilomètres supplémentaires. Donc si notre ravitaillement est pour le moment incomplet, ayant loupé Pisiga, nous aurons encore la possibilité de le compléter lors de notre passage à Sabaya. Mais je ne me résigne pas et si une possibilité se présente de couper pour rejoindre directement le salar et sa piste d’entrée il ne faut pas la louper, eau et ravitaillement risquant alors d’être courts. Je questionne un ingénieur travaillant sur la nouvelle route, ce dernier me fournit des indications relativement précises nous redonnant quelque espoir de pouvoir passer directement à travers le petit massif qui nous sépare du bord nord du salar.
Bolivie. D’après la carte il se trouve à dix kilomètres de la frontière. Nous empruntons une magnifique route bétonnée en construction, donc déserte et fonçons vers notre destination. Après une quinzaine de kilomètres, pas de Pisiga. Nous réalisons alors qu’il s’agissait de la ville frontière. Mais nous ne ferons pas demi-tour. Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons aborder directement le salar qui se trouve à quelques kilomètres à notre droite et nous envisageons de remonter à Sabaya qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord et de là trouver une piste qui nous ramènera au salar en une trentaine de kilomètres supplémentaires. Donc si notre ravitaillement est pour le moment incomplet, ayant loupé Pisiga, nous aurons encore la possibilité de le compléter lors de notre passage à Sabaya. Mais je ne me résigne pas et si une possibilité se présente de couper pour rejoindre directement le salar et sa piste d’entrée il ne faut pas la louper, eau et ravitaillement risquant alors d’être courts. Je questionne un ingénieur travaillant sur la nouvelle route, ce dernier me fournit des indications relativement précises nous redonnant quelque espoir de pouvoir passer directement à travers le petit massif qui nous sépare du bord nord du salar.
Un chemin doit s’ouvrir deux kilomètres plus loin. Mais nous avons appris à nous méfier des indications données, qu’elles soient kilométriques ou qu’elles qualifient la difficulté des côtes rencontrées ou l’état du chemin. En effet les perceptions à bord d’un véhicule 4X4 et sur un vélo ne sont pas les mêmes. Donc un kilomètre plus loin, un chemin part sur la droite, bien que ce soit proche, il faut tester. Je vois un ouvrier sur le chantier de la route et lui demande. Sans hésiter il me certifie que le chemin mène là où nous voulons aller. Nous entamons la descente, quelques centaines de mètres plus bas une petite maison et le chemin se perd dans une carrière abandonnée. Un petit tertre dominant la région me permet de constater que s’il existe un accès il ne passe pas par là. Je scrute minutieusement les espaces qui s’ouvrent à nous. Le salar n’est pas très loin, mais que le terrain semble tourmenté et instable pour y accéder. Le pire ennemi du cycliste, le sable, règne en maître dans ces contrées. Donc en poussant nos vélos nous rejoignons la route. Je commence à me dire que nous ne couperons pas au détour de 80 kilomètres de piste. En effet la route magnifique en béton que nous suivons depuis une vingtaine de kilomètres a pris fin. Son avancement s’étant arrêté quelques kilomètres auparavant, les cailloux et la poussière ont remplacé cette belle surface lisse et roulante.
Un kilomètre plus loin, alors que je suis presque résigné, Jean voit une piste sableuse qui part dans la direction souhaitée. Nous partons sans conviction sur ce chemin rébarbatif et peu engageant. Rapidement nous devons pousser les vélos, bien que la pente en descente soit assez accentuée, mais le sable ne pardonne rien aux cyclistes. Quelques virages, et notre piste s’engage dans un vallon qui se dessine de plus en plus nettement. Un espoir que cela nous conduise où nous voulons ? Des traces de pneu de véhicules à moteur  nous laissent penser que nous ne sommes pas dans une impasse. En effet si nous devions remonter ce chemin, il nous faudrait développer de sacrés efforts et peut-être se mettre à deux pour pousser les vélos, expérience que nous avons déjà vécue. Mais non la piste descend, parfois plus de trace de pneu, ce qui fait resurgir nos craintes d’erreur. Mais non, un peu plus loin elles réapparaissent et de plus elles semblent venir du bas, ce qui rallume tous nos espoirs. Cela fait plus de six kilomètres que nous poussons nos vélos. Je constate alors que le sol en dehors du chemin est plus solide et qu’il nous permet de rouler. Donc, nous voilà partis à louvoyer parmi une végétation rabougrie sur quelques centaines de mètres, ce qui est très appréciable comparativement au poussage épuisant dans du sable pulvérulent.
nous laissent penser que nous ne sommes pas dans une impasse. En effet si nous devions remonter ce chemin, il nous faudrait développer de sacrés efforts et peut-être se mettre à deux pour pousser les vélos, expérience que nous avons déjà vécue. Mais non la piste descend, parfois plus de trace de pneu, ce qui fait resurgir nos craintes d’erreur. Mais non, un peu plus loin elles réapparaissent et de plus elles semblent venir du bas, ce qui rallume tous nos espoirs. Cela fait plus de six kilomètres que nous poussons nos vélos. Je constate alors que le sol en dehors du chemin est plus solide et qu’il nous permet de rouler. Donc, nous voilà partis à louvoyer parmi une végétation rabougrie sur quelques centaines de mètres, ce qui est très appréciable comparativement au poussage épuisant dans du sable pulvérulent.
Nous atteignons un village, mais généralement il n’y a personne, cela fait maintenant plus de quinze jours que nous traversons des lieux identiques entre Chili et Bolivie. Aujourd’hui miracle, un homme se trouve devant l’une des maisons. Nous allons lui demander conseil. Il nous confirme qu’en suivant la piste qui part à l’ouest nous allons rencontrer dans une dizaine de kilomètres l’accès au salar. Il nous affirme même que l’état du chemin s’améliore, cependant il nous dissuade d’essayer de rejoindre au plus court le salar, à travers de grands prés rabougris sur lesquels paissent des lamas. C’est déjà pas mal, nous faisons nos comptes, cela fera une vingtaine de kilomètres au lieu des quatre vingt prévus. Nous pouvons même gagner une journée et bivouaquer ce soir au milieu du sel.
La pause casse-croûte est la bienvenue, même s’il s’agit d’un bout de pain avec un peu de thon de très mauvaise qualité, et nous reprenons notre chemin. L’état de la piste dans un premier temps n’est pas terrible et ne permet pas de rouler. Nous constatons qu’en restant dans les prés, certes ce n’est pas très confortable, mais nous pouvons pédaler. Un peu plus loin, nous découvrons de très fines pistes de quelques dizaines de centimètres de large, qui autorisent une vitesse dont nous n’avons plus l’habitude. En quelques mètres, nous prenons le coup pour rester sur ces très étroites bandes de roulement et ainsi nous gagnons plusieurs kilomètres.
Les contours de cette première étendue de sel nous dévoilent petit à petit leur immensité. Il est vrai que j’ai besoin de me référer à ma carte pour me persuader que les pics et volcans que je vois au sud sont à plus de soixante kilomètres, car nous allons parcourir cette étendue blanche sur cette distance. Donc le grand volcan que je distingue très nettement plein sud se dresse à plus de quatre vingt kilomètres, stupéfiant, c’est presque la distance Lyon Valence ! Il est rassurant de constater que nous garderons tout au long de cette traversée des repères qui nous éviteront de tourner en rond, car paraît-il la boussole ne fonctionne pas. Quant au GPS que je possédais, on me l’a volé au Pérou. Cependant, nous constaterons que la boussole donne une bonne indication sur les deux salars. Peut-être y a-t-il des points particuliers sur ces surfaces qui perturbent le champ magnétique de façon très locale? Les différents essais que j’ai effectués en relation avec le soleil ou des points topographiques caractéristiques m’ont donné des indications tout à fait conformes aux directions estimées.
Nous arrivons à un petit village en bordure de salar. Nous constatons que dans la partie est de cette immensité il y a une activité liée sans doute à l’exploitation du sel. En effet de temps à autre des camions passent dans le lointain. Ce bourg est habité et un petit attroupement se forme autour de nous. Nos réserves étant assez faibles, il nous faut impérativement un complément au moins en eau. On nous vend péniblement une bouteille de coca cola que nous vidons dans la foulée. Mais nos bouteilles vides, nous pouvons les remplir au puits du village. Notre bilan hydrique se monte à un peu moins de vingt litres à trois. Si nous ne nous perdons pas, cela devrait suffire. En effet les différents renseignements semblent concorder, en matière d’approvisionnement en eau dans tous les villages rencontrés. Lorsque l’on voit l’aspect désertique de la région, on peut en douter. Mais nous aurons l’occasion de constater que c’est bien vrai. Même dans les villages déserts il y a un robinet qui fournit une eau claire fraîche et non salée, mystère des écoulements souterrains.
Les villageois nous indiquent une petite île, distante de dix kilomètres sur laquelle nous trouverons, paraît-il, un hébergement. Incroyable, ce ne sera même plus de l’aventure! Le vent de l’après-midi souffle avec son cortège de poussière. Durant ces trois mois de voyage, la poussière aura été notre lot quotidien. Pour nous en protéger nous allons essayer différents procédés : écharpe, masque de chirurgie, respiration retenue, mais rien ne sera vraiment efficace et nous respirerons de véritables bouffées de terre avec tous les inconvénients que cela génère au niveau du système respiratoire. Le grand air pur des montagnes et des régions inhabitées que nous attendions, nous ne l’avons jamais vu. Par contre, des nuages denses de poussière, soulevée par le vent ou les véhicules, nous ont accompagnés tout au long des milliers de kilomètres de piste.
Nous nous engageons sur le salar par une véritable route, large mais cabossée, très nettement marquée car surélevée par un remblai d’une bonne cinquantaine de centimètres. En effet, nous comprenons bien pourquoi il est nécessaire d’arriver par ce type d’accès aménagé. Autour tout est mou, sable et sel, et le vélo nécessiterait d’être poussé sur des distances infinies. Nous atteignons cette  fameuse île, sans à vrai dire avoir vraiment mis le « pneu » sur le sel. Nous avons parcouru une longue langue de terre qui s’avance sur le salar. Que l’endroit semble désolé ! Quelques maisons abandonnées ou cadenassées résistent tristement aux assauts des bourrasques. Un être vivant en train d’ordonner des briques de terre est la seule présence vivante en dehors de deux chiens qui nous accompagnent de leurs aboiements. Nous nous renseignons auprès de cet homme, qui nous répond sans même lever la tête. Nous ne semblons pas les bienvenus dans ce recoin désolé et lugubre.
fameuse île, sans à vrai dire avoir vraiment mis le « pneu » sur le sel. Nous avons parcouru une longue langue de terre qui s’avance sur le salar. Que l’endroit semble désolé ! Quelques maisons abandonnées ou cadenassées résistent tristement aux assauts des bourrasques. Un être vivant en train d’ordonner des briques de terre est la seule présence vivante en dehors de deux chiens qui nous accompagnent de leurs aboiements. Nous nous renseignons auprès de cet homme, qui nous répond sans même lever la tête. Nous ne semblons pas les bienvenus dans ce recoin désolé et lugubre.
Nous partons à la recherche d’un point de chute pour la nuit. Le soleil décline, et la fraîcheur arrive rapidement à plus de 3600 mètres. Un enclos de pierre à quelques centaines de mètres devrait offrir une assez bonne protection contre le vent. Je traverse à vélo des zones dures pour y jeter un coup d’œil. En regardant par-dessus le mur de pierre, assez haut, je suis aussi surpris que les deux habitants du lieu, qui sont deux gros cochons. Il n’est pas question de leur disputer l’emplacement ! Nous cherchons chacun de notre côté parmi les maisons en ruine, mais toutes sont de véritables dépotoirs et bien souvent elles servent de lieu d’aisance. Vu l’état des lieux, il doit y avoir du passage, car à part l’homme taciturne interrogé pas âme qui vive ici.
Nous finirons par installer nos tentes à l’abri d’un mur sur un replat. Comme chaque fois que nous bivouaquons Jean prépare le repas constitué d’une soupe et d’une platée de nouilles. Alain et moi, par flemme, nous nous satisferions de grignoter quelque chose de froid. Mais il faut bien reconnaitre qu’un repas chaud c’est mieux ! Ces victuailles chaudes vite englouties, nous nous blottissons dans nos sacs de couchage, à l’intérieur de nos abris chahutés par le vent. Heureusement, ce dernier, comme d’habitude, va se calmer peu de temps après l’arrivée de la nuit. Nous passerons une longue nuit presque paisible. En effet plusieurs camions surgis de nulle part nous réveilleront de temps à autre. Heureusement que nous sommes bien serrés contre un mur. Mystère de ces régions presque désertiques où en pleine nuit une circulation improbable vient vous rappeler que vous n’êtes pas si loin de la civilisation.
Le jour se lève, l’air est immobile. Ce matin le lieu nous apparaît moins triste et hostile qu’hier soir. En effet, en fin de journée, la venue de l’obscurité avec un vent furieux, alors que nous sommes fatigués, donc plus sensibles aux basses températures, a un effet non négligeable sur le moral. On a donc tendance à voir les choses de façon plus lugubre. Cette nuit, le froid n’a pas été très intense, quelques degrés en-dessous de zéro. Le soleil se lève sur le salar, spectacle magnifique. Nous déjeunons et enfourchons rapidement nos montures. Nous sommes toujours sur notre langue de terre qui est de plus en plus étroite. Nous essayons de prendre pied sur le salar, mais le premier essai n’est pas le bon. Enfin nous voilà sur le grand tapis blanc. Au début tout va pour le mieux, un vrai billard. Selon  les endroits le sel a des aspects différents mais le roulement est facile. Puis des changements apparaissent. Un peu à la manière d’une calotte glacière, où des plaques se chevauchent, ce qui freine considérablement l’avancement. Mais nous ne voyons pratiquement pas de traces de véhicules. Nous progressons de la sorte en direction du sud, pour le moment en descendant un immense bras de sel de quelques vingt kilomètres de large. Nous arrivons au bout de cette ramification et l’immensité plate s’étale devant nous.
les endroits le sel a des aspects différents mais le roulement est facile. Puis des changements apparaissent. Un peu à la manière d’une calotte glacière, où des plaques se chevauchent, ce qui freine considérablement l’avancement. Mais nous ne voyons pratiquement pas de traces de véhicules. Nous progressons de la sorte en direction du sud, pour le moment en descendant un immense bras de sel de quelques vingt kilomètres de large. Nous arrivons au bout de cette ramification et l’immensité plate s’étale devant nous.
Sur notre droite l’horizon disparaît au-delà de cet infini blanc. Que la sensation est étrange de pédaler dans cet univers plat et blanc, duquel aucun bruit ne monte. Seul le craquement des concrétions salines qui s’écrasent sous nos roues apporte un léger fond sonore. Les aspects que prend la surface de ce sol pétrifié varie à l’infini ou presque, du billard lisse jusqu’au moutonnement en vaguelettes, toute une série de variations s’offrent à nous. Parfois sur quelques mètres et d’autres fois sur quelques kilomètres. Nous apprenons à découvrir un nouveau monde. Mais toujours nous arrivons à rouler au moins à dix ou quinze kilomètres à l’heure. Pour nous ce n’est pas mal, car nous avons expérimenté les trois kilomètres à l’heure de moyenne en développant des efforts considérables. Donc tout va pour le mieux. Nous distinguons un véhicule loin sur notre droite. Nous ne nous risquons pas à estimer la distance, tout est tellement trompeur. On dirait un camion haut perché. Nous interceptons une trace dure, qui manifestement est un axe de passage. Nous la suivons et arrivons à la hauteur du véhicule arrêté. Il s’agit d’une voiture. Les deux occupants en sont descendus, car ils sont en panne d’huile au beau milieu de cette étendue. Ils nous en demandent. A part nos petites burettes pour graisser nos chaînes, nous ne pouvons rien leur offrir. Il faut quand même le faire, venir tomber en panne dans un endroit pareil… La route sur laquelle nous nous trouvons prend une direction bien à l’est. Le chemin le plus court pour nous consiste à partir pratiquement plein sud pour aller intercepter une piste qui borde le salar au sud. Après concertation nous décidons de prendre cette direction au plus court.
Comme c’est étrange, le bord semble tout proche, alors que les informations que nous avons corroborées par la carte nous disent qu’il y a au moins trente kilomètres. Mais si nous avançons correctement nous sortirons du salar dans trois heures maximum. Mais voilà, les choses vont se gâter. Le sol devient mou, la vitesse tombe vers les cinq à l’heure puis nous sommes obligés de mettre pied à terre et de pousser nos engins lourdement lestés. Les vélos ne sont vraiment pas conçus pour être poussés. Dans cet espace immense où la vue porte si loin, se traîner comme des limaces en poussant donne une réelle sensation d’immobilité. Tous les repères auxquels nous pouvons raccrocher notre regard se trouvent à des dizaines de kilomètres.
Vers midi, nous faisons une halte sur un petit bout de terre de quelques dizaines de mètres carrés perdu au milieu de cette surface blanche, éclatante au soleil. Jean fait une platée de pâtes, nous consommons l’eau de cuisson, car nous sentons bien que le piège du salar risque de se refermer sur nous, alors que nos réserves sont faibles. Après le repas, alors qu’il fait une petite sieste, je pars sonder les environs pour essayer de trouver la route la moins difficile, ou plutôt la moins molle. Plein est, je suis une trace d’animaux, sans doute un troupeau de lamas, ce qui me permet de rouler sur un ruban d’une dizaine de centimètres permettant un avancement rapide. Mais après quelque distance je viens butter sur un marais. Voilà pourquoi ça et là des touffes d’herbes apparaissaient, juchées sur de petits monticules de terre. La progression devient impossible. Je rejoins mes camarades et fais un essai plein sud. C’est mou mais en poussant la progression reste possible. Nous décidons d’insister dans cette direction, en espérant que nous ne serons pas arrêtés par des zones marécageuses. De plus avec la chaleur de la journée, des mirages apparaissent et nous avons réellement l’impression d’être entourés de grandes masses liquides. L’impression est inquiétante, car l’illusion prend des airs de réalité. Nous allons pousser durant encore quinze kilomètres, en alternant sel et sable. Lorsque ce dernier prend des teintes sombres nous sommes piégés par un matériau, dans lequel les vélos s’enfoncent parfois jusqu’au moyeu. Dans ce cas, il nous faut  quasiment les porter et alors nous enfonçons jusqu’aux chevilles.
quasiment les porter et alors nous enfonçons jusqu’aux chevilles.
Dans cette immensité où tout nous apparait si proche, mais en réalité où tout se trouve très loin, nous avons une vraie impression d’immobilité. Nous commençons à nous demander si nous allons nous sortir de ce traquenard avant la nuit. Depuis mon retour en France j’ai lu des récits de personnes qui s’étaient perdues dans ce coin. Manifestement elles n’avaient pas persévéré à garder le cap plein sud. Pour ma part je commence à me poser la question, mais je me dis qu’au rythme de trois kilomètres à l’heure, nous pouvons faire une bonne distance avant la nuit qui n’arrivera que vers les vingt heures. Plus le soir se rapproche, plus je me sens motivé pour savoir si nous sommes en mesure de sortir par ce côté. Je suis prêt à marcher tant que c’est possible, même si la nuit arrive. Mais ce n’est pas le cas de Jean qui commence à envisager un bivouac. Cette incertitude m’enlève toute envie d’arrêt avant de savoir si nous sommes capables de passer.
Le sel commence à céder la place à la terre de façon plus régulière. Nous arrivons même à remonter sur nos vélos le long d’une minuscule sente d’animaux. Puis nous coupons des traces de véhicules. Le bord ne doit plus être très loin. D’après ma carte un chemin borde la partie sud du salar. Nous n’avons vu aucun mouvement. Ils sont facilement visibles même de loin, car les véhicules soulèvent de grands nuages de poussière. Jean pense que le chemin ne passe pas là. Si c’est le cas nous sommes dans de beaux draps. Vers dix neuf heures nous sentons que nous approchons de la sortie de ce piège. Là-bas, loin sur la droite un nuage de poussière. Un véhicule ! Manifestement il longe le salar. Le chemin est bien là. Je pousse un ouf de soulagement. Effectivement nous sortons. Le camion passe à quelques centaines de mètres de nous. Le chauffeur freine et nous regarde de loin, sans doute intrigué, car la traversée par cet endroit ne doit pas être très fréquente. Nous trouvons une zone plate.
A deux kilomètres se trouve un petit village perché. Pendant que mes c amarades installent les tentes, je pars à sa rencontre dans l’espoir de ramener de l’eau. Je le rejoins assez facilement, bien que j’aie à pousser dans le sable sur les cinq cents derniers mètres. Il est habité et comme par miracle, un robinet prodigue une eau claire et fraîche. Je reviens avec mes bouteilles pleines, ce qui nous permettra un bivouac confortable. Nous sommes vraiment contents d’être sortis de ce « guêpier ». En regardant au nord nous distinguons très nettement la montagne le long de laquelle nous sommes descendus hier pour rejoindre le salar. Elle est à plus de soixante dix kilomètres, cela paraît à peine croyable, et pourtant le compteur et la carte donnent la même indication.
amarades installent les tentes, je pars à sa rencontre dans l’espoir de ramener de l’eau. Je le rejoins assez facilement, bien que j’aie à pousser dans le sable sur les cinq cents derniers mètres. Il est habité et comme par miracle, un robinet prodigue une eau claire et fraîche. Je reviens avec mes bouteilles pleines, ce qui nous permettra un bivouac confortable. Nous sommes vraiment contents d’être sortis de ce « guêpier ». En regardant au nord nous distinguons très nettement la montagne le long de laquelle nous sommes descendus hier pour rejoindre le salar. Elle est à plus de soixante dix kilomètres, cela paraît à peine croyable, et pourtant le compteur et la carte donnent la même indication.
Assister à la venue de la nuit dans ces lieux retirés est un spectacle fascinant. Le ciel prend des teintes rouges qui contrastent avec le sombre des grandes montagnes en contre-jour. On imagine bien de la sorte les grands espaces préhistoriques seulement peuplés de dinosaures. De plus le vent s’en donne à cœur joie comme chaque soir. Cette nuit je vais bien dormir et le lendemain me réveiller vers les sept heures, alors qu’il fait déjà bien clair, ce qui est exceptionnel.
Le matin, une fois encore l’air est immobile, le silence absolu, presque assourdissant. J’ai envie de retenir mon souffle pour ne pas troubler l’esprit du lieu et rompre l’enchantement. Je pars me promener à pied sur nos traces de la veille, que je ne retrouve pas dans cette immensité. Quelques gros oiseaux s’envolent à mon approche. Une petite rivière, qui court au milieu du sel est en partie gelée, il n’a pas du faire bien chaud cette nuit! De retour aux tentes, je constate que la grosse bouteille d’eau que j’ai oubliée sur mon porte-bagages est un énorme glaçon de plusieurs litres. Heureusement que le contenant est en plastique ! Le changement de température est rapide. Une demi-heure après l’apparition du soleil le thermomètre reprend une vingtaine de degrés.
Aujourd’hui nous espérons une étape facile, en effet une trentaine de kilomètres nous séparent de la petite ville de Llica, point d’entrée du salar d’Uyuni. Les deux kilomètres que j’ai effectués sur cette piste hier pour aller chercher de l’eau m’ont permis de constater qu’elle était en très bon état. Mais je ne l’ai empruntée que sur deux kilomètres. La suite sera toute différente, en effet l’empire du sable va reprendre et nous allons nous battre à pied contre un terrain qui ne nous laissera aucun répit. Généralement les pistes sablonneuses  que nous avons expérimentées jusqu’à présent, présentaient des zones non praticables, mais elles alternaient avec de grandes zones où nous pouvions enfourcher nos vélos. Mais là, non, les parties « roulables »sont quasi inexistantes, et sur quatorze kilomètres nous allons pousser dans un sable qui nous retient comme de la colle. Je maudis cette piste, et l’étape supposée facile se transforme en véritable calvaire, surtout après la gigantesque séance de poussage d’hier.
que nous avons expérimentées jusqu’à présent, présentaient des zones non praticables, mais elles alternaient avec de grandes zones où nous pouvions enfourcher nos vélos. Mais là, non, les parties « roulables »sont quasi inexistantes, et sur quatorze kilomètres nous allons pousser dans un sable qui nous retient comme de la colle. Je maudis cette piste, et l’étape supposée facile se transforme en véritable calvaire, surtout après la gigantesque séance de poussage d’hier.
Lorsque nous arrivons au village de Challacollo, Jean décide de voir si ce village possède un restaurant. Lorsqu’il y pénètre, un pick-up en sort. Je me précipite à grands renforts de gestes, pourvu qu’il m’attende. Le chauffeur m’a remarqué et je cours littéralement, mon vélo à la main. Contrairement à Jean qui lui avait demandé s’il y avait de quoi se restaurer, moi je suis intéressé par sa destination. Il va à Llica, chance ! Immédiatement je lui demande s’il peut me charger avec mon vélo, Alain y est immédiatement favorable. Jean quant à lui est plus réticent, considérant que c’est un peu trahir l’esprit du cyclotourisme. Pour ma part, je considère que pousser son vélo dans le sable, c’est comme naviguer avec une bassine, un engin pas du tout adapté à son emploi. Enfin de compte nous finissons tous les trois sur la plate-forme du véhicule en compagnie d’un couple de vieux Indiens. Les quinze kilomètres nous séparant de Llica nous les parcourons en une demi-heure. Vu l’état de la piste, à vélo il nous aurait bien fallu au minimum quatre heures, avec la grosse chaleur qui montait, nous en aurions vraiment bavé. A treize heures nous sommes installés dans un restaurant sympathique devant une belle assiette de poulet au riz, que je savoure sans remords ni regrets. Alain ne semble pas avoir plus d’états d’âme que moi, ce qui n’est pas le cas de Jean. Je sens dans son  regard une forme de reproche. Nos conceptions divergent quelque peu. Je roule avant tout pour le plaisir, les calvaires interminables, je n’en raffole pas. Pousser son vélo, sans aucun espoir de pouvoir rouler sur la moindre parcelle, ne m’attire pas spécialement et si je peux m’en dispenser je n’hésite pas.
regard une forme de reproche. Nos conceptions divergent quelque peu. Je roule avant tout pour le plaisir, les calvaires interminables, je n’en raffole pas. Pousser son vélo, sans aucun espoir de pouvoir rouler sur la moindre parcelle, ne m’attire pas spécialement et si je peux m’en dispenser je n’hésite pas.
Cette petite ville de Llica est étonnante, comme toutes les agglomérations boliviennes ; des maisons basses qui se serrent dans des rues en pente, avec quelques épiceries toutes semblables qui offrent un choix restreint de nourriture. De ces petites villes se dégagent quiétude et nonchalance. Et toujours à proximité ou sur la « plaza des armas » l’église toujours originale et de couleur vive rappelle que le catholicisme tient une place importante. Une petite auberge nous accueille, le patron est particulièrement bienveillant et attentif à nos demandes, bien que l’établissement soit spartiate. La douche se matérialise par un seau d’eau au milieu de la cour. Heureusement que je n’éprouve plus le besoin de me laver systématiquement. Quelques centilitres pour les endroits vitaux et pour ma part, je fais attention de toujours m’essuyer à la mode musulmane, ce qui est beaucoup plus hygiénique que le papier nommé mal à propos hygiénique.
Une fois bien installés et ayant fait un peu de lessive, je commence à m’inquiéter de l’étape du lendemain, le fameux salar d’Uyuni, le plus vaste du monde. En regardant les chiffres, Coipasa 2100 km2 et Uyuni 12 500, je prends un peu peur, cela fait six fois plus grand. Cette première traversée nous a déjà pas mal étonnés pour ne pas dire impressionnés, j’ose à peine imaginer ce que ce sera sur Uyuni. Avec Alain je pars à pied vers la sortie de la ville essayer de repérer le chemin d’accès au salar. D’un promontoire au niveau des dernières maisons nous avons un excellent point d’observation. A nos pieds s’ouvre un immense espace, duquel surgissent dans le désordre des pics d’origine volcanique. Que c’est immense ! Là, il n’est pas question de voir de l’autre côté. Ma première impression consiste à me dire : mais par où va-t-on bien passer ? Puis nous continuons à marcher et interrogeons un homme qui nous indique le chemin qui donne accès au salar. En effet tout est tellement gigantesque, que nous voyons bien des grands espaces plats mais pas de sel. Cela signifie que ce que notre regard embrasse ce sont les abords de cette mer immobile. Je fais vite la relation avec Coipasa et j’en déduis que les dimensions ne sont pas à la même échelle. Nous avons identifié clairement la route qui nous y conduira, le lieu ne nous livrera pas d’autre indice. Nous retournons en ville boire une bière, dans ce qui est plutôt une épicerie qui vous offre un siège, qu’un bar à proprement parler. Le propriétaire va nous donner quelques indications supplémentaires très intéressantes et qui pour une fois se révéleront parfaitement exactes. La piste passe juste au nord de l’île du Pescado et puis se dirige directement sur celle d’Incahuasi. D’après nos informations la première île est visible au moment ou la piste arrive au salar, il suffit donc de la prendre en ligne de mire, sur la seconde il y a de quoi se restaurer. Donc notre but pour demain consistera à atteindre ce deuxième lieu. J’ai aussi pu observer que le volcan Tunapa, haut de 5321 mètres, donc 1700 mètres au-dessus du salar, pointe comme un phare immense qui sera en mesure de nous indiquer un point de repère au nord durant une grande partie de notre traversée.
Forts de tous ces renseignements, ayant récupéré Jean, nous partons dîner tous les trois dans un petit local tenu par une Indienne. Elle nous propose un excellent poulet grillé. Durant le repas des bruits de musique. Nous allons voir sur le pas de la porte et la stupéfaction nous cueille. Des foules arrivent presque au pas cadencé, descendant en rangs compacts les rues rectilignes. Mais d’où sortent tous ces gens ? Par groupe d’une centaine de personnes, ils arborent des tenues différentes, égayées de lampions et lumières parfois accrochées en haut d’antennes, qui balancent au gré du pas. Les participants de l’un des groupes portent comme un sac à dos, fait d’une petite caisse cubique dans laquelle une bougie tient lieu de lampion. Sur la face arrière de ce sac à dos, la photo très célèbre du CHE, qui, nous l’avons constaté, reste très populaire en Amérique du Sud. Et pour entretenir le rythme, les orchestres, je dis bien les orchestres, car ils sont au moins au nombre de trois, sont répartis tout au long du cortège. Dans ces pays ce qui m’a le plus surpris, ce sont ces défilés festifs quasi permanents. Le spectacle est vraiment étonnant et nous restons médusés à regarder passer dans la nuit cet étrange mais très sympathique cortège. On nous explique qu’il s’agit de l’anniversaire de Potosi. S’agit-il de la ville ? Nous n’en saurons pas plus.
Nous décidons d’un départ très matinal, malgré le froid. Dès sept heures nous sommes en route. La ville est vite traversée, nous passons le poste militaire qui en contrôle l’entrée. La piste sur douze kilomètres va nous servir de prélude à ce site unique. Nous le voyons s’ouvrir devant nous, son immensité toujours plus présente. Pas de véhicule en vue. Est-ce que ce sera aussi désert que Coipasa ? Normalement non. Si, de la poussière monte de la piste en provenance du salar. Un camion nous croise, je fais signe au chauffeur qui s’arrête. Je lui demande confirmation que nous roulons bien sur la bonne piste, et m’assure que l’île que je crois être celle du Pescado est vraiment la bonne. Il me le confirme. En effet, cette île sort comme un point minuscule qui semble danser sur cette surface plane. Elle est située exactement à quarante huit kilomètres du bord du salar, indication qui me sera donnée par mon compteur. Comme pour Coipasa, une piste surélevée sur quelques kilomètres donne accès au sel dur. Nous y voilà. Gigantesque ! D’ouest en est notre traversée va exactement faire 145 km. Aujourd’hui nous en parcourrons 72 et demain 73.
Le soleil est bien en face à l’est. Notre volcan balisant le nord nous domine, l’île du Pescado est bien identifiée, on peut y aller. La direction à prendre est sud-est. La piste que nous suivons part dans la bonne direction. Après une quinzaine de kilomètres elle s’incurve vers le nord. Une discussion s’engage entre nous. Je suis partisan de garder le cap et de ne pas suivre la piste qui semble un vrai  boulevard. En effet, je crois qu’elle part sur le village de Tahua au pied du volcan Tunapa, ce qui n’est vraiment pas notre route, car notre traversée doit nous conduire presque plein est. Nous restons donc sur une trace dans la direction de l’île du Pescado. Mais elle n’est pas bien marquée et de plus à part le camion pas un véhicule. Un petit doute subsiste en moi. Mais sur la droite de notre piste il me semble en voir une autre. Je la rejoins en coupant à travers le sel, qui est très roulant, presque autant que les chemins tracés par les véhicules ; Donc je rejoins cette autre piste, qui est une vraie autoroute lisse et dure. Elle pointe directement sur l’île qui nous sert de balise. Mes doutes commencent à s’estomper. Nous roulons à vive allure, aux environs des 25 à l’heure. A l’est l’étendue de sel disparaît dans le néant. Au sud et au nord d’immenses montagnes en dessinent les contours lointains. Epoustouflant. Je m’arrête et tourne sur moi-même complètement subjugué par ce spectacle quasi irréel. Nous sommes seuls, nous ne verrons aucun véhicule jusqu’à l’île d’Incahuasi. Je suis dans le site le plus exceptionnel et étrange qu’il m’ait été donné d’admirer. Le fait de s’y trouver seul et à vélo, en quelque sorte assez vulnérable donne à l’endroit une dimension véritablement extraordinaire. Se trouver à bicyclette en ce lieu est une expérience inimaginable, qui fait monter des émotions fortes, difficiles à décrire. Toute une foule de photos vues et de reportages lus me viennent à l’esprit. En particulier une photo de la couverture de la revue trimestrielle « carnets d’aventure », sur laquelle on voit au beau milieu du salar trois beaux gaillards blonds et nus, qui cachent leur pudeur, chacun derrière une sacoche de vélo de couleur vive. Elle m’avait beaucoup plu, car outre le côté esthétique indéniable de tous les éléments de la photo, les trois compères rayonnaient de joie. Mais une polémique avait éclaté et les purs et durs, peut-être un peu puritains rigides en avaient fait le reproche à la rédaction, qui avait à mon sens su répondre habilement et très diplomatiquement.
boulevard. En effet, je crois qu’elle part sur le village de Tahua au pied du volcan Tunapa, ce qui n’est vraiment pas notre route, car notre traversée doit nous conduire presque plein est. Nous restons donc sur une trace dans la direction de l’île du Pescado. Mais elle n’est pas bien marquée et de plus à part le camion pas un véhicule. Un petit doute subsiste en moi. Mais sur la droite de notre piste il me semble en voir une autre. Je la rejoins en coupant à travers le sel, qui est très roulant, presque autant que les chemins tracés par les véhicules ; Donc je rejoins cette autre piste, qui est une vraie autoroute lisse et dure. Elle pointe directement sur l’île qui nous sert de balise. Mes doutes commencent à s’estomper. Nous roulons à vive allure, aux environs des 25 à l’heure. A l’est l’étendue de sel disparaît dans le néant. Au sud et au nord d’immenses montagnes en dessinent les contours lointains. Epoustouflant. Je m’arrête et tourne sur moi-même complètement subjugué par ce spectacle quasi irréel. Nous sommes seuls, nous ne verrons aucun véhicule jusqu’à l’île d’Incahuasi. Je suis dans le site le plus exceptionnel et étrange qu’il m’ait été donné d’admirer. Le fait de s’y trouver seul et à vélo, en quelque sorte assez vulnérable donne à l’endroit une dimension véritablement extraordinaire. Se trouver à bicyclette en ce lieu est une expérience inimaginable, qui fait monter des émotions fortes, difficiles à décrire. Toute une foule de photos vues et de reportages lus me viennent à l’esprit. En particulier une photo de la couverture de la revue trimestrielle « carnets d’aventure », sur laquelle on voit au beau milieu du salar trois beaux gaillards blonds et nus, qui cachent leur pudeur, chacun derrière une sacoche de vélo de couleur vive. Elle m’avait beaucoup plu, car outre le côté esthétique indéniable de tous les éléments de la photo, les trois compères rayonnaient de joie. Mais une polémique avait éclaté et les purs et durs, peut-être un peu puritains rigides en avaient fait le reproche à la rédaction, qui avait à mon sens su répondre habilement et très diplomatiquement.
Encore une fois les distances sont gigantesques et la vue porte au-delà. L’île du Pescado grossit, de point elle devient objet allongé un peu à la manière d’un gros poisson. Et puis tout là-bas dans le néant entre blanc du sel et bleu du ciel, un point noir émerge de la piste. L’île d’Incahuasi pointe le bout de son nez. Nous passons au large de la première, exactement quarante huit kilomètres du bord. Maintenant la seconde va se rapprocher lentement et le compteur indiquera vingt quatre kilomètres de plus. L’euphorie qui m’habite annihile la notion de temps et je n’ai vraiment pas l’impression de parcourir de telles distances. De plus lorsque je me retourne je vois en prenant des repères sur les montagnes, assez précisément le lieu où nous sommes entrés sur le sel. Comment imaginer que c’est si loin. D’autres étapes nous avaient demandé beaucoup plus d’efforts et de temps pour un kilométrage bien inférieur !
Incahuasi grossit et la piste arrive droit dessus. Nous constatons qu’il y a pas mal de mouvements. Nous y voici. Comme c’est étrange,  les véhicules 4x4 viennent se garer comme des bateaux viennent à l’attache à l’île verte à la Ciotat ou au banc d’Argun sur le Bassin d’Arcachon. D’autant plus étonnant qu’au beau milieu de l’île se dessine comme un petit golfe, en bordure duquel les voitures se garent sagement. Nous passons du désert à la foule. J’aime bien, cela présente un petit côté réconfortant que je ne saurais expliquer. Dans deux jours je vais parcourir le salar dans un autre sens et cette fois en voiture. Ce sera une autre expérience, mais il est vrai que le vélo représente le moyen le plus adapté pour se faire un immense plaisir et ressentir toute la grandeur du lieu. Je constate qu’il y a beaucoup de Français. Partout où je suis allé ces dernières années le pourcentage de français était important. Alors que j’ai souvent entendu dire que les Français étaient un peuple qui ne voyageait pas beaucoup, je ne trouve pas.
les véhicules 4x4 viennent se garer comme des bateaux viennent à l’attache à l’île verte à la Ciotat ou au banc d’Argun sur le Bassin d’Arcachon. D’autant plus étonnant qu’au beau milieu de l’île se dessine comme un petit golfe, en bordure duquel les voitures se garent sagement. Nous passons du désert à la foule. J’aime bien, cela présente un petit côté réconfortant que je ne saurais expliquer. Dans deux jours je vais parcourir le salar dans un autre sens et cette fois en voiture. Ce sera une autre expérience, mais il est vrai que le vélo représente le moyen le plus adapté pour se faire un immense plaisir et ressentir toute la grandeur du lieu. Je constate qu’il y a beaucoup de Français. Partout où je suis allé ces dernières années le pourcentage de français était important. Alors que j’ai souvent entendu dire que les Français étaient un peuple qui ne voyageait pas beaucoup, je ne trouve pas.
Nous accostons, Alain et moi. Jean est déjà arrivé depuis un certain temps. Que cet endroit est étonnant, îlot perdu dans cette immensité. Les cactus candélabre ont colonisé le lieu. Ce sont de véritables arbres qui montent jusqu’à dix mètres. Les plus vieux sont millénaires. Nous allons déjeuner au restaurant. Bien évidemment les prix sont bien plus élevés que ceux dont nous avons l’habitude en Bolivie, mais cela reste cependant bon marché. On nous apporte le grand livre des voyageurs à vélo, qui tous mettent un mot ou couvrent deux pages. Ils y ont ajouté de nombreuses photos ou des schémas de leur périple. Je constate que nombreux sont ceux qui sont passés par ce point quasi obligé du cyclotourisme au cours d’une traversée des deux Amérique de l’Alaska à la terre de Feu. Nous découvrons qu’étant venus à bicyclette, nous aurons le privilège de pouvoir dormir sur place, alors que ceux qui sont venus en voiture n’auront pas ce privilège.
 Le soir arrivant, les visiteurs véhiculés désertent les uns après les autres, et nous nous retrouvons seuls en compagnie des neuf Indiens qui demeurent ici, afin de gérer le flux touristique. Avec le départ des touristes, la chaleur s’en va aussi. La luminosité aveuglante diminue, l’espace environnant devient plus hostile. Les pierres et la flore de l’île semblent se métamorphoser, changeant de couleurs à la manière d’un caméléon. Les grandes étendues blanches prennent des tonalités plus roses, un peu pastel. Dans le lointain la jonction entre le sel et le ciel s’éteint progressivement dans des teintes bleu profond. Le froid et le vent ajoutent une touche sévère au tableau. Le soleil, pour sa part, dans un dernier effort allume et incendie les nuages épars d’un rouge vif qui fait ressortir la multitude de plans de montagnes qui s’enchevêtrent jusqu’à l’infini. Je pars seul marcher sur le salar, alors que la nuit étend son mystère. Que l’impression est forte ! A part les rafales de vent, plus aucun bruit ne perturbe le lieu. On pourrait se croire sur une calotte glaciaire perdu quelque part au pôle nord ou sud. Un même lieu à différentes heures de la journée, dans différentes conditions, avec plus ou moins de monde et l’impression est totalement modifiée, on pourrait se croire dans des endroits très différents. Ce soir, que cette immensité bordée de pics innombrables m’impressionne dans cette obscurité qui prend possession de l’espace ! Presque à contrecœur je rejoins l’île et mes camarades.
Le soir arrivant, les visiteurs véhiculés désertent les uns après les autres, et nous nous retrouvons seuls en compagnie des neuf Indiens qui demeurent ici, afin de gérer le flux touristique. Avec le départ des touristes, la chaleur s’en va aussi. La luminosité aveuglante diminue, l’espace environnant devient plus hostile. Les pierres et la flore de l’île semblent se métamorphoser, changeant de couleurs à la manière d’un caméléon. Les grandes étendues blanches prennent des tonalités plus roses, un peu pastel. Dans le lointain la jonction entre le sel et le ciel s’éteint progressivement dans des teintes bleu profond. Le froid et le vent ajoutent une touche sévère au tableau. Le soleil, pour sa part, dans un dernier effort allume et incendie les nuages épars d’un rouge vif qui fait ressortir la multitude de plans de montagnes qui s’enchevêtrent jusqu’à l’infini. Je pars seul marcher sur le salar, alors que la nuit étend son mystère. Que l’impression est forte ! A part les rafales de vent, plus aucun bruit ne perturbe le lieu. On pourrait se croire sur une calotte glaciaire perdu quelque part au pôle nord ou sud. Un même lieu à différentes heures de la journée, dans différentes conditions, avec plus ou moins de monde et l’impression est totalement modifiée, on pourrait se croire dans des endroits très différents. Ce soir, que cette immensité bordée de pics innombrables m’impressionne dans cette obscurité qui prend possession de l’espace ! Presque à contrecœur je rejoins l’île et mes camarades.
 Le local qui nous est attribué pour une somme modique est spartiate, mais la vue sur le salar par une grande baie vitrée est absolument sublime. Il est des moments dont on se souvient longtemps, eh bien ce petit refuge me laissera un souvenir durable. Nous aurions aimé que d’autres cyclistes nous rejoignent pour cette nuit. Mais nos espoirs seront déçus, bien que nous ayons estimé à la lecture du livre d’or qu’un jour sur deux, des adeptes du vélo, venant du monde entier, passaient par là.
Le local qui nous est attribué pour une somme modique est spartiate, mais la vue sur le salar par une grande baie vitrée est absolument sublime. Il est des moments dont on se souvient longtemps, eh bien ce petit refuge me laissera un souvenir durable. Nous aurions aimé que d’autres cyclistes nous rejoignent pour cette nuit. Mais nos espoirs seront déçus, bien que nous ayons estimé à la lecture du livre d’or qu’un jour sur deux, des adeptes du vélo, venant du monde entier, passaient par là.
Au matin, je monte au sommet de notre petite île volcanique, afin d’admirer l’apparition du soleil dans ce décor grandiose. Malheureusement une légère brume atténue la grandeur du spectacle. En effet, la lumière solaire lorsqu’elle apparaît tout là-bas à l’est derrière des montagnes situées à une centaine de kilomètres, balaie cette immensité plate et blanche, d’ouest en est, en l’éclairant graduellement. Mais le phénomène sera ténu du fait de la diffusion à travers les légers nuages perturbateurs. Dommage, mais le spectacle n’en est pas moins saisissant. Je reste depuis hier après-midi comme hypnotisé devant cette immensité magique que je contemple du haut de ce tertre peuplé de cactus géants. Je redescends, nous petit-déjeunons et repartons pour notre deuxième étape sur la plus grande étendue de sel du monde.
Le plaisir est aussi intense que celui éprouvé la veille. On avance rapidement sans effort et de toutes parts cette immensité blanche bordée, très loin de pics et de volcans, qui se pressent et se chevauchent dans des baies et des golfes géants, dont on discerne à peine  les contours à l’infini. Par endroits n’étant pas sûr d’être sur la piste la plus directe, je fais des baïonnettes vers la droite afin d’intercepter d’autres routes. Au cours de ces manœuvres, je foule de mes roues un sel vierge de toute trace. Je vois mes deux camarades de profil loin là-bas qui se découpent comme deux minuscules insectes dans ce décor de géants. La fascination joue à fond.
les contours à l’infini. Par endroits n’étant pas sûr d’être sur la piste la plus directe, je fais des baïonnettes vers la droite afin d’intercepter d’autres routes. Au cours de ces manœuvres, je foule de mes roues un sel vierge de toute trace. Je vois mes deux camarades de profil loin là-bas qui se découpent comme deux minuscules insectes dans ce décor de géants. La fascination joue à fond.
Mais tout a une fin, l’extrémité du salar se rapproche et les soixante treize kilomètres sont parcourus trop vite. Il est des endroits dont on ne veut plus s’échapper, pris par un charme puissant. Un peu avant la sortie, un hôtel de sel. Nous nous y arrêtons. Quelques véhicules y stationnent. Nous sommes un peu l’attraction lorsque nous nous approchons. Bien que ces gens soient sympathiques et de plus parlent pour certains, bien notre langue, j’ai un peu la sensation d’être un singe malin que l’on regarde ; j’attends le moment où l’on va me lancer des cacahuètes. Je me rends compte qu’être touriste à pied parmi les touristes, donc incognito ne me dérange pas du tout, mais avec mon vélo cela me particularise trop et me gêne. Autant au cours des deux semaines précédentes à travers les zones désertiques ignorées du tourisme, je me suis senti bien, autant maintenant que nous arrivons dans ces parages très touristiques, j’ai envie d’abandonner mon vélo.
 La sortie du salar est balisée comme l’entrée par une véritable route, large et cabossée sur laquelle de nombreux véhicules soulèvent une poussière dense qui nous titille sérieusement les muqueuses. Encore vingt sept kilomètres d’une piste absolument horrible, tôle ondulée, sable, bosses en tous genres et nous arrivons dans la ville d’Uyuni, que les guides décrivent comme vilaine et sans intérêt. Nous, nous la trouvons sympathique et animée, et son climat soi-disant rude, nous apparaît comme amical, sans doute nos organismes se sont habitués aux conditions rudes depuis trois mois que nous arpentons les Andes à vélo. En ce qui me concerne, je viens d’effectuer la dernière étape sur ma monture, cent kilomètres exactement. En effet, je vais continuer le voyage par des moyens mécaniques. Mais ces 4000 kilomètres à vélo ont été tellement intenses qu’ils m’apparaissent comme dans un rêve. Ai-je vraiment vécu ces trois derniers mois ? Et dans ce rêve, le summum réside dans les trois dernières semaines, dont je reparlerai, avec le bouquet final que je viens de vous narrer, Coipasa et Uyuni.
La sortie du salar est balisée comme l’entrée par une véritable route, large et cabossée sur laquelle de nombreux véhicules soulèvent une poussière dense qui nous titille sérieusement les muqueuses. Encore vingt sept kilomètres d’une piste absolument horrible, tôle ondulée, sable, bosses en tous genres et nous arrivons dans la ville d’Uyuni, que les guides décrivent comme vilaine et sans intérêt. Nous, nous la trouvons sympathique et animée, et son climat soi-disant rude, nous apparaît comme amical, sans doute nos organismes se sont habitués aux conditions rudes depuis trois mois que nous arpentons les Andes à vélo. En ce qui me concerne, je viens d’effectuer la dernière étape sur ma monture, cent kilomètres exactement. En effet, je vais continuer le voyage par des moyens mécaniques. Mais ces 4000 kilomètres à vélo ont été tellement intenses qu’ils m’apparaissent comme dans un rêve. Ai-je vraiment vécu ces trois derniers mois ? Et dans ce rêve, le summum réside dans les trois dernières semaines, dont je reparlerai, avec le bouquet final que je viens de vous narrer, Coipasa et Uyuni.
20:09 Publié dans voyage à vélo | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bolivie, salar, coipasa, uyuni, altiplano